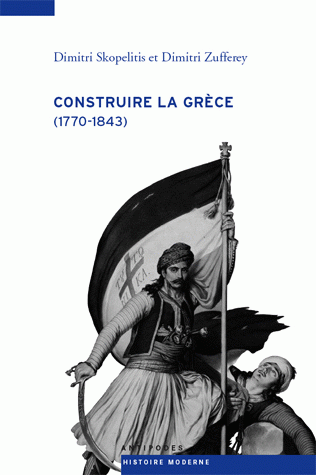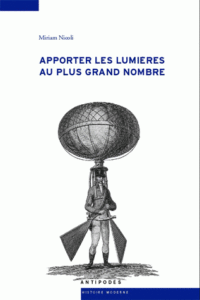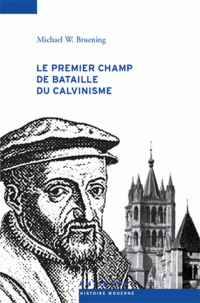Construire la Grèce (1770-1843)
Skopelitis, Dimitri, Zufferey, Dimitri,
2011, 407 pages, 34 €, ISBN:978-2-88901-027-1
La Grèce est le premier État moderne et européen né de l’Empire ottoman. Des mouvements intellectuels comme les Lumières et le libéralisme, ainsi que l’identité nationale naissante, seront le socle à partir duquel les hétairies puis les clephtes partiront au combat qui mènera à l’indépendance.
Ce livre porte sur la naissance et la mise en place de la Grèce moderne dans les années 1770-1843. Il fait la synthèse de cette période dans une perspective de continuité des différents courants et idéologies qui ont mené à la « renaissance » de la Grèce.
Description
La Grèce est le premier État moderne et européen né de l’Empire ottoman. Des mouvements intellectuels comme les Lumières et le libéralisme, ainsi que l’identité nationale naissante, seront le socle à partir duquel les hétairies puis les clephtes partiront au combat. Après la reconnaissance de la légitimité de la lutte et de l’indépendance, avec le soutien philhellène occidentale, la Grèce devient un État reconnu par les Puissances. Tout est européen dans son édification: l’État de droit, les administrateurs bavarois et l’ingérence des Puissances.
Depuis la nomination du premier gouverneur, Jean Capodistrias (1828) jusqu’à l’arrivée du roi Othon (1832), la Grèce s’exerce aux acquis démocratiques. Ces esquisses républicaines seront interrompues par l’assassinat du premier gouverneur. Avec la monarchie, la Grèce prend un virage qui l’éloigne des idéaux de liberté, mais les pressions constitutionnalistes obligeront Othon à accepter le principe d’une monarchie constitutionnelle, le 3 septembre 1843.
Cet ouvrage porte sur la naissance et la mise en place de la Grèce moderne dans les années 1770-1843. Il fait la synthèse de cette période dans une perspective de continuité des différents courants et idéologies qui ont mené à la « renaissance » de la Grèce.
Table des matières
- « Penser la Grèce »: construction idéologique
- « Préparer la Révolution »: construction d’un projet politique et révolutionnaire
- « Libérer les Grecs »: construction d’une indépendance
- « Créer un État »: construction politique
- « Édifier un État »: construction du pouvoir bavarois
- « Établir un territoire »: construction nationale et sécuritaire
- « Régner »: construction monarchique
Presse
Dans Annales. Histoire, Sciences sociales
Depuis quelques décennies, l’abondante bibliographie anglophone sur l’histoire de la Grèce moderne et contemporaine a ouvert de nouvelles pistes de recherche. En Allemagne, une histoire concise de la Grèce a vu le jour récemment1, s’ajoutant à un certain nombre d’éditions originales et de traductions sur ce sujet. En revanche, les ouvrages synthétiques sont rares en français, le meilleur parmi eux datant de 19532. Sous cet aspect, cette monographie arrive à propos. Elle représente, selon la préface de Michel Porret, la « synthèse remaniée d’un remarquable mémoire de maîtrise en histoire moderne » (p. 7), rédigée sous sa direction en 2007.
Centrée sur les « mécanismes essentiels qui, par leur évolution, ont contribué, chacun à sa manière, à la création et à l’édification d’un État » (p. 25), l’étude traite de la formation de l’État-nation grec depuis l’apparition des Lumières néohelléniques jusqu’à l’établissement d’une monarchie constitutionnelle. Le cadre chronologique de cette approche historique du premier État européen « issu d’un empire multiethnique tel que l’empire ottoman » (p. 14) est délimité par des dates conventionnelles: en effet, si l’année 1770 représente, selon Constantin Dimaras, la date de naissance du mouvement des Lumières3, l’année 1843 ne marque pas l’accomplissement ou la fin de ce courant intellectuel, mais la date précise d’une insurrection politique qui vise à l’obtention d’une constitution.
Cette pluralité d’approches correspond à la diversité des champs étudiés qui vont des Lumières (françaises et grecques) à la législation, l’administration et la politique extérieure établies par la Régence à partir de 1833, et du philhellénisme franco-allemand avant et pendant la guerre de l’Indépendance à la querelle des autochtones et hétérochtones. De même que les différents domaines de recherche abordés, les points de vue adoptés se multiplient et se confondent tout au long du récit: tantôt il est question de l’imaginaire identitaire des Grecs, reconstitué selon des sources primaires ou secondaires, tels que des textes historiographiques, politiques, littéraires ou de droit international, tantôt la perspective est celle des Occidentaux, philosophes et voyageurs, hommes d’État et diplomates. Ce pluralisme méthodologique ne facilite ni la lecture ni une interprétation cohérente des faits historiques.
Le livre est composé de sept chapitres allant de la construction idéologique de l’hellénisme moderne au règne absolu d’Othon Ier. Leurs intitulés constitués d’infinitifs (« Penser la Grèce », « Préparer la révolution », « Libérer les Grecs », etc.) révèlent la méthode globaliste et par conséquent schématique de présentation de cette longue période. Car comment exposer en quelques pages seulement la perception de la Grèce ottomane par les voyageurs français du XVIIIe siècle ? Comment résumer dans un chapitre l’histoire diplomatique de la Révolution grecque ou le mouvement « polymorphe » du philhellénisme en passant de l’Hypérion de Friedrich Hölderlin à la Scène héroïque d’Hector Berlioz, et de François-René de Chateaubriand aux Légions des philhellènes et aux Propylées de la ville de Munich? Comment maîtriser la bibliographie sur les Lumières grecques qui regroupe, de 1945 à 1995, « plusieurs centaines de monographies » (p. 26) sans réduire leur réception à trois tendances principales rattachées, à tort, à la question de la langue? Finalement, comment traiter, dans le même ouvrage, de la vie intellectuelle au sein de l’empire ottoman, des projets révolutionnaires, du gouvernement de Ioannis Capodistrias, de la Régence et du roi Othon Ier, sur les plans politique, diplomatique, administratif et culturel?
Le travail de Dimitri Skopelitis et Dimitri Zufferey demeure impressionnant par la richesse de son matériau, l’ampleur de la recherche et de la bibliographie consultée, et les traductions effectuées à partir du grec et de l’allemand. Cependant la période en question est trop longue, trop complexe et trop connue pour permettre une présentation approfondie, puisqu’elle couvre non seulement le processus du passage difficile de l’empire ottoman à la guerre d’Indépendance, puis la construction de l’État, et l’établissement ainsi que la chute de la monarchie absolue, mais aussi une multitude de questions relevant de disciplines diverses. Or un aperçu pertinent de soixante-dix ans d’histoire « pré-nationale » et nationale, politique et culturelle présuppose une méthodologie impeccable, un choix minutieux des références et surtout une longue pratique d’historien.
Ainsi ce n’est pas un hasard si plusieurs études cruciales n’ont pas été prises en compte, si l’historiographie grecque est représentée par des ouvrages souvent surannés et des manuels scolaires, si l’image orientaliste de la Grèce ottomane est fondée sur deux récits de voyage (Charles de Sainte-Maure en 1724 et Pierre Augustin Guys en 1783) et quelques articles d’encyclopédie, si les activités éditoriales et éducatrices dans les Principautés danubiennes sont passées sous silence, si le rôle d’Adamante Coray est réduit à l’invention de la katharevoussa, si l’archevêque Eugène Voulgaris devient « le symbole de la lutte grecque contre l’occupant » (p. 57) et si Missolonghi est mentionné parmi les grands centres intellectuels de la fin du XVIIIe siècle!
Ce livre, ambitieux dans son dessein, présente d’évidents problèmes de synthèse, des faiblesses et des contradictions. Il souffre de répétitions, surtout dans sa première partie qui porte sur la construction idéologique et politique de la Grèce prérévolutionnaire. Le lecteur averti tombe sur des anachronismes, par exemple lorsqu’il est question d’ »empire grec » ou « byzantin » au sein du projet « grec » de Catherine II de Russie ou de la société secrète Philiki Hétairia, bien avant l’irrédentisme gréco-bavarois. L’ouvrage véhicule les images stéréotypées des Grecs « éternels » au travers d’aphorismes tels que « l’amour que les Grecs portent à leur pays » (p. 13), « un peuple sans cesse en rébellion […] contre la puissance ottomane » (p. 15), « La Grèce est l’Europe » (p. 24), etc. Enfin, il recèle des fautes ou des interprétations erronées: ainsi le jacobin grec Rhigas Velestinlis aurait conçu non pas l’idée d’une république multinationale, mais celle « d’un État pour les Grecs » (p. 17); sa Carte serait le « manifeste cartographique de la future Grande idée » (p. 104 et 304); les Phanariotes auraient occupé des postes importants « au sein même du Patriarcat » (p. 32); le meurtre du premier gouverneur Jean Capodistrias aurait marqué « la fin de la République révolutionnaire » (p. 21); les combattants de l’Epanastasis étaient tous des klephtes et la détermination de la nationalité grecque serait due aux grandes puissances – pour ne citer que quelques-unes de ces erreurs. Il faudrait, malgré tout, signaler que les meilleurs pages du livre sont celles consacrées à la « Bavarocratie ».
Dans son ensemble, cet ouvrage témoigne d’une conception linéaire du temps historique sans ruptures apparentes et sans nuances. D. Skopelitis et D. Zufferey ont pris le risque de publier un travail, certes de longue haleine, qui aurait pu être précieux s’il avait été réalisé dans d’autres conditions.
Marie-Élisabeth Mitsou, Annales. Histoire, Sciences sociales, 2014/3, pp. 832-833
1. Ioannis Zelepos, Kleine Geschichte Griechenlands: von der Staatsgründung bis heute, Munich, C. H. Beck, 2014.
2. Nicolas G. Svoronos, Histoire de la Grèce moderne, Paris, PUF, 1953.
3. Constantin Dimaras, La Grèce au temps des Lumières, Genève, Droz, 1969 [éd. grecque en 1989].
Dans le Le Cartable de Clio
Dimitri Skopelitis et Dimitri Zufferey viennent de publier aux Éditions Antipodes un volume très fourni qui traite de l’indépendance de la Grèce et de la construction d’une structure étatique moderne, entre 1770 et 1843.
Très précis, fourmillant de détails, l’ouvrage est néanmoins clairement problématisé, dépassant en cela le stade de la « simple » monographie. Le livre est en effet principalement axé selon deux lignes de problématique: l’étude de la lutte pour l’indépendance et l’affirmation d’un nationalisme sont exposés sur un premier plan; à un second niveau, on voit comment le désir de liberté d’un peuple s’est aussi manifesté face au roi que la Sainte-Alliance avait imposé aux Grecs.
Dans les premiers chapitres, les deux universitaires s’efforcent d’évaluer l’impact des Lumières – en montrant leur rôle de catalyseur – dans le désir de faire naître un État indépendant de l’Empire Ottoman. Véhiculant l’image d’un lieu mythique, la Grèce ne peut manquer d’attirer l’attention des philosophes, et d’être l’objet de leurs discours. Sujets de la Sublime Porte, les Grecs font de plus en plus figure de peuple asservi aux yeux des intellectuels français, allemands ou anglais. Sous leur influence, l’apparition des premiers penseurs nationaux hellènes va avoir pour effet d’impulser un mouvement culturel patriotique, mais également un courant intellectuel que l’on pourrait qualifier de « pré-démocratique ». La Révolution française va en effet transformer les idéaux des Lumières: au projet nationaliste s’ajoutera un projet national. Les deux objectifs vont aboutir au déclenchement de la Guerre d’indépendance en 1821.
Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles les îles ioniennes vont jouer un rôle pivot: conséquemment aux guerres napoléoniennes, elles vont se trouver sous contrôle français, puis anglais. Pour des raisons pratiques évidentes, les administrations étrangères vont laisser aux habitants une marge de manoeuvre dans la gestion de leurs affaires courantes. Cette autonomie va servir de laboratoire pour le reste du pays.
La révolte victorieuse des Serbes en 1821 va servir de catalyseur. Peu après, le monde hellénique prend les armes, et la répression turque y répond. Si l’Europe chrétienne de la Sainte-Alliance ressent une sympathie pour les insurgés, ses monarques sont surtout soucieux de conserver les acquis du Congrès de Vienne, et notamment le droit des souverains. Il s’agit par conséquent d’assurer la stabilité du pouvoir du Sultan dans les Balkans. En plus, les velléités démocratiques, révolutionnaires, des Grecs ont tout pour déplaire et inquiéter les rois et empereurs européens. Mais, peu à peu, les choses évoluent: en Occident, l’opinion, qui s’émeut des massacres dont sont victimes les civils, est sensible aux témoignages et au destin de certains idéalistes (Lord Byron); les gouvernements français et anglais s’inquiètent de voir « l’ombre » de la Russie se profiler du côté des insurgés. Tout cela aboutit à une intervention militaire des grandes puissances et à la reconnaissance de l’indépendance en 1830.
Les historiens, dans un long développement, montrent ensuite que les gouvernements de l’Europe monarchique ont oeuvré contre les institutions républicaines naissantes, elles-mêmes fragilisées par une conception clanique du pouvoir qui avait abouti à l’assassinat du premier dirigeant, Jean Capodistrias. Le mécanisme vers la monarchie absolue aboutit avec la désignation d’un prince de Bavière, Othon Ier, à la tête du pays naissant. L’instauration de ce type de pouvoir royal a été justifiée à l’époque par la nécessité de construire un État cohérent et unifié. Les auteurs insistent aussi, de façon presque amusée, sur l’entourage très bavarois que le souverain s’est donné dans son gouvernement et son administration, qui n’est pas sans faire penser – les allusions sont claires – à l’interventionnisme américain au XXe siècle! Même si la conscience démocratique et les idées héritées des Lumières n’étaient pas encore très fortes, l’opinion grecque va progressivement se mobiliser, au bout d’une dizaine d’années, pour obtenir, en 1843, un système constitutionnel. Les chercheurs y voient le début d’un processus qui a fait des Grecs un peuple oriental, une nation tournée vers l’Europe, et l’Occident en général.
Lors de l’indépendance, il était difficile de fixer les frontières. À beaucoup d’endroits, dans le nord et en Asie mineure (sans parler de Constantinople), les gens étaient mélangés. De plus, le royaume né de l’indépendance ne regroupait qu’un tiers des populations qui s’estimaient certes grecques, mais qui n’avaient pas encore vraiment le sentiment de former une nation. La fixation des frontières a permis la définition de l’État, mais elle a aussi et surtout posé la question de la nationalité et de l’identité. Qui est grec? celui qui est de religion orthodoxe? qui parle la langue? qui a immigré dans la partie devenue indépendante? Ces discussions ont néanmoins permis de définir ce qu’était ce peuple. Mais ensuite, la réunion de tous ces gens sous le même drapeau a été longue à faire aboutir, puisque la réunion de l’archipel du Dodécanèse n’a eu lieu qu’en 1947… sans parler de la question de Chypre!
Tout en narrant de manière parfois fort – trop? – détaillée les péripéties politiques qui ont donné lieu à la naissance de la Grèce moderne, les auteurs montrent des enjeux que l’on retrouve dans la naissance de tout État moderne et démocratique. Là réside la qualité première de cet ouvrage, passionnant dans son questionnement. Mais il aurait été plus captivant encore de dépasser ces aspects étatiques, présentés parfois un peu « à la façon du XIXe siècle », et de mieux explorer dans cette évolution le rôle de la culture – le mot étant compris dans un sens très général –, que ce soit au travers de la littérature, des expositions, des musées, de la musique ou des manifestations culturelles au sens large. Mais, sans doute, les deux universitaires genevois, épris d’ »histoire politique », ont-ils voulu rester cohérents. On ne peut pas forcément le leur reprocher.
Pierre Jaquet, Le Cartable de Clio, no. 12/2012, pp.241-242
La Grèce et l’Europe: une histoire longue
Depuis mardi 24 juillet, une équipe d’inspecteurs internationaux est de retour en Grèce avec pour mission de décider si le plan d’aide de 130 milliards d’euros reste ou non valable. Et dimanche dernier, Phillip Rösler, le ministre de l’économie et vice-chancelier allemand, a envisagé publiquement une sortie de la Grèce de l’Euro.
Mais, alors que l’on s’interroge sur la place de la Grèce dans l’Union européenne, les liens entre Athènes et l’Europe ne peuvent se comprendre selon des modalités seulement économiques. La construction de l’État grec moderne, au XIXe siècle, comme l’intégration du pays à la CEE en 1981, ont aussi obéi à des motifs politiques et symboliques, fondés notamment sur l’image que les Européens ont construite de ce pays comme du « berceau de la démocratie », en confondant parfois Grèce antique et Grèce moderne.
Ainsi, la construction d’un État national, issu d’un empire multiethnique tel que l’Empire ottoman, a été le triple fruit d’une projection intellectuelle de la Grèce, d’une activité diplomatique par le rôle primordial joué par les puissances européennes dans la planification et l’indépendance du jeune État et d’une manière de concevoir et d’établir la chose publique, notamment pendant les années de la guerre d’indépendance.
Existe-t-il alors, du fait de cette histoire particulière, une exception grecque, que ce soit dans le rapport à l’État ou dans la situation géographique et géopolitique, à la fois balkanique et européenne, qui expliquerait la crise actuelle? Comprendre les bases sur lesquelles a été bâti l’État grec moderne permet d’appréhender de nombreuses questions d’actualité, en particulier la place de la Grèce en Europe, le lien entre l’Église et l’État, ou la question de l’identité nationale.
C’est ce qui ressort de l’ouvrage de Dimitri Zufferey et Dimitri Skopélitis, Construire la Grèce (1770-1843) paru aux éditions Antipodes. Entretien avec Dimitri Skopélitis, historien et enseignant à Genève.
La création de l’État grec moderne au XIXe siècle doit-elle être comprise comme une entreprise identitaire européenne? Et sur quelles bases les Européens ont-ils alors « rêvé » la Grèce?
Je dirais qu’il s’agit plutôt de la conséquence d’un long processus intellectuel et identitaire lié à la représentation mythifiée de l’Antiquité en Europe occidentale. Les Européens ont commencé à rêver de la Grèce, bien avant de « redécouvrir » les Grecs modernes au cours du XVIIIe siècle. Une fois cette rencontre aboutie, ils ont commencé à projeter sur les Grecs leur représentation du passé hellénique, dans l’espoir de le faire renaître à nouveau.
Comment les Grecs ont-ils été nourris par cette mythification européenne de leur région? Dans quelle mesure cela a-t-il joué dans leur lutte d’indépendance nationale?
Certains dirigeants des grandes puissances de l’époque–comme la tsarine Catherine II-ont envisagé la création d’un État hellénique ou orthodoxe, mais la voie vers l’indépendance de la Grèce débute avec l’appropriation, par les Grecs, du discours des Lumières, qui dit que les Grecs ne peuvent retrouver leur « gloire antique » qu’en recouvrant leur liberté. Les Grecs ont donc totalement intégré, dans la construction de leur identité nationale, les idées essentielles véhiculées par les Lumières. Il existe un courant intellectuel en Grèce–les Lumières néo-helléniques–, qui a préparé le terrain argumentatif aux Sociétés révolutionnaires secrètes du début du XIXe siècle, qui ont déclenché la guerre d’indépendance en 1821.
Sans la construction intellectuelle, issue notamment des Lumières et du romantisme européen, de la Grèce moderne au prisme de la Grèce ancienne, est-ce que ce pays aurait rejoint la CEE en 1981 ? Autrement dit, l’Europe s’est-elle permis d’intégrer la Grèce pour des raisons politiques, historiques et symboliques, sans trop se soucier de l’économie du pays, qui ne représentait que 3% du PIB de l’Europe?
Qu’aurait été la Grèce sans ce processus? Quel aurait été son visage? Il est difficile, voire impossible de refaire l’Histoire. Mais il semble clair que les Lumières occidentales, puis néo-helléniques, ont forgé le lien entre l’Antiquité et le présent. C’est sur cette base qu’à été construite la Grèce moderne. Dès lors, dans le cadre de la construction européenne des années 1980, difficile d’imaginer symboliquement une Europe sans la Grèce.
La Grèce est-elle uniquement le résultat d’une implantation européenne en Orient ou les Grecs se sont-ils redécouverts européens?
Les deux, mais à des niveaux différents. La Grèce, en tant que modèle étatique, est le résultat d’une implantation occidentale en Orient: le système de gouvernance républicain puis monarchique, l’établissement d’un État de droit, le système fiscal… En ce qui concerne les Grecs, ils ont renoué, à travers leur contact avec l’Europe, avec une partie de leur identité. Mais affirmer qu’ils se sont redécouvert simplement « européens » serait osé.
La place, aujourd’hui difficile, de la Grèce en Europe est-elle, sinon une anomalie, peut-être une exception? Géographiquement, c’est le seul membre de l’Europe qui n’est pas relié territorialement au reste de l’entité européenne et c’est aussi le seul des pays balkaniques qui est intégré à l’Europe. Comment l’expliquer?
En effet, jusqu’en 2007 et l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la Grèce a été le seul pays de la péninsule balkanique de l’Union européenne. Même si son adhésion à la CEE en 1981 est souvent présentée comme le résultat des relations privilégiées avec l’Europe occidentale et notamment la France de Valéry Giscard d’Estaing, son adhésion est également due à d’autres facteurs. Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait, pendant la Guerre froide, du seul pays des Balkans qui n’appartenait pas au bloc de l’Est. Elle fait partie de l’OTAN depuis 1952. D’autre part, le pays sortait aussi d’une dictature. Il s’agissait donc de consolider une démocratie encore fébrile. D’ailleurs, le Portugal et l’Espagne, qui étaient dans des situations similaires, ont rejoint la CEE en 1986.
À en croire certains responsables et journaux européens, les Grecs sont au mieux des irresponsables et des dépensiers, au pire des tricheurs et des paresseux. Cette stigmatisation n’est-elle pas l’envers de l’idéalisation de la Grèce comme berceau de la démocratie?
Il n’a pas toujours existé, en Europe, une seule et unique image de la Grèce. Par exemple, après la période du philhellénisme européen, pendant la guerre d’indépendance, il y a eu ce que les Grecs nomment les « mishellènes » : ceux qui n’aiment pas la Grèce. Certains, comme l’historien Jakob Philipp Fallmerayer au XIXe, ont farouchement combattu ce lien de la Grèce à l’Antiquité. Plus tard, il y a eu également une grande inimitié vis-à-vis de la Grèce à cause des affaires de brigandage.
L’idée de la paresse est démentie par Eurostat, qui place les travailleurs grecs parmi les premiers des classements européens en la matière. Est-elle alors le fruit d’un stéréotype habituel de l’Occident laborieux sur l’Orient langoureux? La Grèce est à la fois orientale et méridionale, elle cumule donc les images négatives… Ces clichés existent-ils dès la période de construction de la Grèce moderne?
Les stéréotypes sont toujours une réponse facile pour expliquer des situations complexes. On retrouve toutefois des éléments comparables dans les descriptions online australian casinos des voyageurs européens de la première moitié du XVIIIe siècle: les Grecs sont présentés comme vils, orgueilleux, ignorants et miséreux (Pierre-Augustin Guys), mais on leur concède toujours (Charles de Sainte Maure) l’amour du travail et la patience dans les persécutions…
La Grèce, du fait de son histoire, peut-elle éviter d’être un enjeu politique et démocratique, au-delà d’un enjeu économique?
L’implication, voire l’ingérence, des grandes puissances successives depuis la création de l’État grec en 1830, et l’histoire particulièrement mouvementée du pays au cours des XIXe et XXe siècles, ont démontré que la Grèce ne peut et ne pourra éviter d’être un enjeu. J’ai l’impression de ne pas prendre énormément de risque en disant que d’autres bouleversements ou revirements politiques en Grèce sont à venir.
Les différends actuels entre la Grèce et l’Allemagne trouvent-ils certaines de leurs causes dans le fait que les Européens ont « donné » à l’État grec moderne naissant une monarchie d’origine germanique?
Même si la période de la « Bavarocratie » reste une période essentielle de la construction de l’État grec, notamment avec le lancement de grands chantiers (administration, armée, éducation, etc.), peu nombreuses sont les références à cette période. On retrouve plus souvent la période de la Seconde Guerre mondiale. Certains ouvrages n’hésitent pas à parler d’un « Quatrième Reich » économique.
Quelles sont les conséquences de la manière dont s’est construite la Grèce moderne sur le rapport que le peuple grec a, aujourd’hui, à l’État?
S’il est vrai qu’une partie de l’élite grecque de l’époque avait intégré les idées et les principes politiques occidentaux, il n’en demeure pas moins que la construction de l’État grec a été l’implantation d’un modèle occidental en Orient. La différence de culture politique–ou l’absence de culture–d’un peuple, qui avait vécu, des siècles durant, dans un mode de fonctionnement oriental, très local, basé sur le clientélisme et pour lequel l’État n’était qu’une vague entité représentant « l’autre », n’est pas entrée dans l’équation. Le rapport si particulier des Grecs à leur État est en grande partie lié à ce double héritage.
En d’autres termes, est-ce parce que la nation, le peuple et le territoire sont insuffisamment unifiés ou homogènes, ou encore trop récents, que la Grèce se trouve en première ligne d’une crise qui est européenne et mondiale?
Non, aucun de ces éléments ne pose problème dans la crise actuelle. Le Grèce rencontre d’énormes problèmes de gestion au niveau étatique ou de clientélisme, qui sont le fruit de son évolution, de son histoire et de la mentalité des classes politiques et du peuple. Des problèmes qu’elle aurait dû résoudre et qui surgissent au grand jour avec la crise. Mais la dette actuelle du pays est davantage liée aux conditions de son intégration dans la construction économique européenne et dans le grand marché européen, pour lesquels, il lui manque–et lui a toujours manqué–les fondamentaux.
Récemment, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a demandé aux Grecs de payer leurs impôts. Beaucoup lui ont répondu qu’avec un taux de prélèvement fiscal de près de 41% du PIB en 2011, la Grèce se situe dans la moyenne européenne et que c’est plutôt le double effet des intérêts de la dette sur un PIB contracté par les politiques d’austérité qui plombe les comptes du pays. Néanmoins, est-ce qu’il existe en Grèce un rapport particulier à l’impôt qui serait le fruit d’un rapport spécifique, distant, à l’État?
Oui, le rapport à l’impôt, et plus généralement au bien public, a toujours été particulier en raison du rapport à l’État que j’ai mentionné auparavant. Sous l’Empire ottoman, le « haratz », impôt spécial prélevé par tête auprès des populations chrétiennes uniquement, a toujours été comme un symbole de « l’oppression » d’un État central distant. Tout était géré au niveau local. Dès lors, même une fois la Grèce indépendante, certaines régions ou certains chefs locaux ont refusé de reconnaître l’État central en payant l’impôt. Cela a même amené à l’assassinat du premier gouverneur de la Grèce, Jean Capodistrias, qui a été tué pour avoir emprisonné un chef de la région du Magne qui refusait de payer l’impôt.
Pourquoi l’Église grecque échappe-t-elle en grande partie aux mesures d’austérité qui touchent violemment le peuple grec?
Pour de multiples raisons qui relèvent–et à juste titre–de l’incompréhensible pour tout observateur externe. La place de l’Église grecque est centrale et il n’y a pas de séparation entre l’Église et l’État, chose qui a été décidée en France depuis plus d’un siècle. Pourquoi? Je dirais que cela relève du plan symbolique. À travers les siècles, c’est à travers la religion orthodoxe qu’ont été entretenues la langue et l’identité. L’administration ottomane ne reconnaissait pas des minorités ethniques, mais religieuses: les Grecs étaient dès lors placés sous l’autorité et la responsabilité du Patriarche de Constantinople. D’ailleurs, au moment de la déclaration de l’indépendance, celui-ci a été pendu devant le Patriarcat pour n’avoir su maintenir sa communauté en paix. L’orthodoxie est donc perçue par une partie des Grecs comme un élément essentiel de leur identité nationale. Il n’a pas encore existé de gouvernement qui se soit osé à l’exercice d’imposer l’Église, de peur de perdre une partie de sa base électorale.
Joseph Confavreux, Médiapart, publié le 29 juillet 2012
Le printemps grec
En 1821, l’Europe embrassait la cause des Grecs en lutte pour l’indépendance. Mais la démocratie était encore loin…
« Nauplie, capitale de la Grèce, dimanche 27 septembre 1831, six heures et demie, Jean Capodistria est assassiné. » C’est ainsi que commence le récit de l’échec de la première tentative démocratique moderne des Hellènes. Les Grecs avaient rêvé d’une république; ils hériteront d’une monarchie absolue imposée par les trois grandes puissances d’alors: la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Le meurtre de Jean Capodistria, le premier chef d’État de la Grèce émancipée de la tutelle turque, marque symboliquement la fin de l’essai démocratique qui avait débuté dix ans plus tôt.
En janvier 1822 près d’Épidaure, dans le Péloponnèse, « les représentants légitimes réunis en Assemblée nationale », insurgés contre « l’horrible despotisme » des Ottomans, déclaraient l’indépendance du pays et promulguaient une Constitution. Les députés se voulaient les dignes héritiers des Grecs du temps de Périclès. Cette filiation entre Grèce moderne et Grèce antique fut forgée au XVIIIe siècle par les philosophes des Lumières comme Voltaire ou Montesquieu, avant d’être reprise par des penseurs grecs comme Adamance Coray, initiateur de la katharevoussa, une forme de grec moderne, et Rigas Velestinlis, révolutionnaire et traducteur. Puis, sous l’influence et l’impulsion des révolutions américaine et française, la démocratie était devenue un modèle pour la nation hellène.
Comme l’exprimera en 1844 le député Colletis: « Ayant l’Orient à sa droite et l’Occident à sa gauche, [la Grèce] est prédestinée par sa renaissance à éclairer l’Orient comme elle le fut par son essor à éclairer l’Occident. » Éveillés par les Lumières européennes, les Grecs puisaient leurs ressources dans l’imaginaire antique pour construire leur nouvel État et pour lui donner une légitimité historique dans une europe alors majoritairement monarchique.
Le « printemps grec » avait débuté en 1821, lorsque, le 25 mars, l’archevèque de Patras Germanos avait soulevé l’étendard de la liberté marquant, symboliquement, le départ du soulèvement dans le Péloponnèse. Au nord, dès le mois de juin, les combattants du prince Alexandre Ypsilantis furent massacrés par les Turcs. Forts du soutien égyptien à partir de 1824, les ottomans, supérieurs en nombre, dominaient le terrain dans le reste du pays où les Grecs durent opter pour la guérilla.
Si l’Assemblée d’Épidaure en 1822 avait donné un gouvernement aux révolutionnaires, celui-ci peinait à s’imposer. Les Grecs se divisaient en factions politiques: la guerre d’indépendance fut ponctuée de deux guerres civiles qui mirent à mal ce premier exercice démocratique.
En Europe occidentale, l’opinion publique fut rapidement sensible à la cause des Grecs, à l’image en France de Victor Hugo et Benjamin Constant ou en suisse du banquier genevois Jean-Gabriel Eynard. Ce mécène fournissait armes et fonds pour que la lutte puisse se poursuivre. De jeunes libéraux français, anglais ou suisses firent même le voyage vers la Grèce pour combattre aux côtés des révoltés. Le plus célèbre d’entre eux, le poète anglais lord Byron, mourut de la malaria en avril 1824 à Missolonghi. Son « martyre » réveilla la conscience européenne.
Sous la pression des mouvements philhellènes et pour soutenir leurs « frères chrétiens », les grandes puissances décidèrent d’intervenir: les Ottomans et les Égyptiens furent vaincus à la bataille de Navarin et signèrent leur défaite en 1828 à Andrinople. La Grèce était officiellement reconnue comme État indépendant, à Londres, le 3 février 1830. Pendant ce temps, les Grecs parvinrent à s’entendre et désignèrent, dès 1827, Jean Capodistria comme « gouverneur » à Trézène. L’année suivante, cet ancien diplomate à la cour du tsar, et originaire de Corfou – qui n’avait pas connu l’occupation turque, mais celles des trois grandes puissances –, débarquait en Grèce continentale.
Très vite, Capodistria réalisa que l’unité nationale n’était que façade. Une nouvelle guerre civile menaçait. La Grèce était dévastée physiquement et financièrement par sept ans d’un conflit qui n’avait pu se faire que par le biais d’emprunts onéreux. La mission du gouverneur était titanesque. Capodistria prévoyait de moderniser le pays: il souhaitait centraliser l’administration et lancer de vastes programmes de réformes agraires. En tentant d’imposer un système de taxation, il se heurta aux magnats locaux: au printemps 1831, il fit emprisonner Petros Mavromichalis, un magnat du Magne, parce qu’il refusait de reconnaître le pouvoir central et la nouvelle fiscalité. En représailles, le gouverneur fut assassiné en septembre.
Le pays sombra dans une période d’anarchie. La tentative démocratique inspirée de l’imaginaire lié à l’Athènes antique avait échoué.
Le destin politique de la Grèce s’éloigna alors de son idéal républicain de départ. En effet, les nouveaux monarques à la tête des puissances européennes ne voyaient pas d’un bon oeil l’existence d’une république dans les Balkans. Il fallait trouver un roi pour ce jeune pays. Le premier candidat retenu, Léopold de Saxe-Cobourg, déclina la proposition, estimant que la Grèce n’était tout simplement pas viable pour des raisons territoriales et financières. Il deviendra, en 1831, le premier roi des Belges.
Le second choix se porta sur Othon de Wittelsbach, cadet du roi de Bavière. Louis Ier, en grand philhellène, accepta que son fils devienne roi des Grecs. Ce choix fut entériné en août 1832, à Nauplie, avec la promesse d’une Constitution.
Le jeune monarque débarqua dans son nouveau pays en 1833, accompagné de 3500 soldats bavarois. Ses troupes remplacèrent celles de la France, restées sur place pour maintenir l’ordre. Encore mineur, Othon ne put régner directement. Un Conseil de régence bavarois lui fut donc adjoint. Un de ses membres, Georg von Maurer, instaura un tout nouvel appareil législatif. Certains des codes de lois entrés en vigueur vers 1835 ne seront abrogés qu’en 1950.
Pendant la Régence (1833-1835), les Grecs réclamèrent, en vain, la Constitution promise. L’intronisation d’Othon les déçut encore davantage puisque celui-ci transforma le régime en monarchie absolue de droit divin. Il faudra encore des décennies d’instabilité politique, de restaurations monarchiques et de coups d’État militaires (le dernier a lieu en 1967) pour que la Grèce renoue avec la démocratie.
Dimitri Skopelitis et Dimitri Zufferey, L’Histoire, N°373, mars 2012, pp.20-21