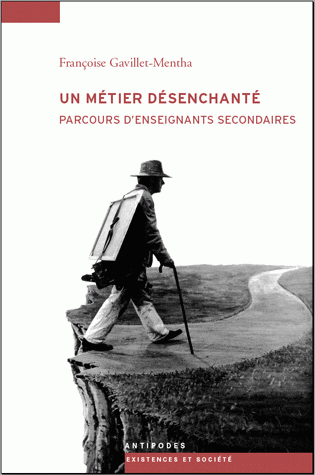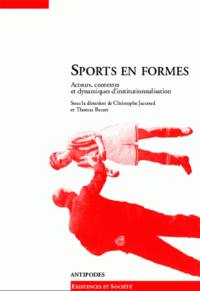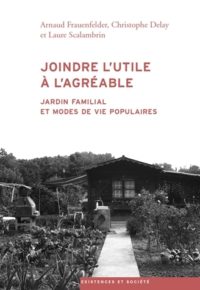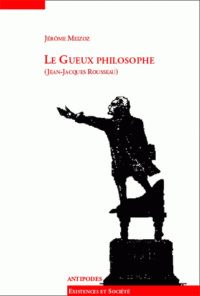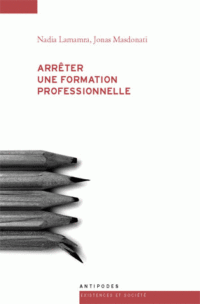Un métier désenchanté
Parcours d'enseignants secondaires (1970-2010)
Gavillet-Mentha, Françoise,
2011, 189 pages, 18 €, ISBN:978-2-88901-001-1
Depuis les années 1970, l’école secondaire a profondément changé, dans le prolongement des mutations sociales. L’école d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier; et le métier d’enseignant non plus. Or, la génération des enseignant·e·s qui ont vécu l’ensemble de ces transformations arrive actuellement en fin de parcours professionnel. Sur la base d’entretiens, l’ouvrage présente et analyse les dimensions essentielles des changements intervenus: évolution de la relation aux élèves, des rapports avec les parents, pressions sociales croissantes sur l’école, perte de prestige du métier. Le désenchantement est général, mais demeure le sens que chacun·e continue à donner au travail quotidien avec les élèves.
Description
Depuis les années 1970, l’école secondaire a profondément changé, dans le prolongement des mutations sociales. L’école d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier; et le métier d’enseignant non plus.
Or, la génération des enseignant·e·s qui ont vécu l’ensemble de ces transformations arrive actuellement en fin de parcours professionnel. Sur la base d’entretiens, l’ouvrage présente et analyse les dimensions essentielles des changements intervenus. La perspective est sociologique et l’approche compréhensive. Il n’est pas question de méthodes d’enseignement, mais bien de ce qui constitue le cur du métier, sa nature relationnelle: évolution de la relation aux élèves, des rapports avec les parents, pressions sociales croissantes sur l’école, perte de prestige du métier.
C’est l’écoute de ces enseignant·e·s qui est ici première, et qui fonde la réflexion. Ce parti est conforté par le constat qu’on entend rarement les enseignant·e·s s’exprimer sur leur pratique quotidienne du métier. A travers les nombreux extraits des entretiens, on mesure à la fois le socle commun de l’expérience professionnelle et la diversité des vécus individuels.
L’ouvrage dessine ainsi l’esquisse d’une biographie sociale de cette génération d’enseignant·e·s. Le désenchantement progressif qu’elle a éprouvé est celui de l’institution scolaire et du métier. Mais demeure le sens que chacun·e continue à donner au travail quotidien avec les élèves.
Presse
Dans la revue en ligne Lectures / Liens Socio
Comme à chaque campagne électorale, la compétition pour figurer en tête de l’agenda politique bat son plein. Talonnant l’emploi et la fiscalité, l’éducation occupe cette année une place de choix, même si, il faut bien l’avouer, elle est souvent réduite à la question des « 60’000 postes » dans l’Éducation nationale supprimés lors du quinquennat de l’actuel président de la République et qu’il s’agirait ou non de rétablir. Reste qu’à cette approche purement « quantitative », certaines voix font valoir la nécessité de réfléchir également à la dimension qualitative du métier d’enseignant. Son contenu a en effet été également ébranlé au cours des cinq dernières années, notamment pour les nouveaux entrants, avec la suppression du stage et la nécessité de disposer désormais d’un Master pour se présenter au concours. Et de même que les analystes des mouvements sociaux rappellent combien il est illusoire de chercher à séparer revendications « expressives » et « matérielles »1, de même est-il trompeur de distinguer revendications de « postes » et protestation de conditions de travail dégradées dans le cas enseignant. Si, proximité sociale aidant, les sociologues ont beaucoup enquêté sur les métiers éducatifs – enseignant, chefs d’établissement, mais aussi élèves dans leurs multiples dimensions2, il n’est donc pas inutile pour autant aujourd’hui de continuer à labourer ce champ, tant son terreau ne cesse de se renouveler.
C’est ce que propose ce (court) ouvrage de Françoise Gavillet-Mentha, avec néanmoins plusieurs spécificités qui mérite qu’on s’y arrête. Tout d’abord, celui-ci se situe dans le contexte suisse, romand pour être précis et vaudois pour l’être encore davantage, permettant un dépaysement et donc une mise à distance autant qu’un point de comparaison appréciables. Ensuite, son auteure a elle-même longtemps exercé la profession d’enseignante de lettres avant de reprendre des études de sociologie – et ce livre est en fait tiré de son (remarquable) mémoire de diplôme d’études approfondies (dirigé par Franz Schultheis), et livre de ce fait ici une enquête nourrie de sa propre expérience. Enfin parce qu’elle propose de questionner la thèse aujourd’hui répandue de la « crise des vocations » dans cette profession en partant de l’analyse d’une cohorte – non pas celle des nouveaux entrants, mais au contraire celle des « baby-boomers » en fin de carrière, ce qui permet ce faisant d’articuler l’analyse des conditions macrosociales d’exercice du métier à la trajectoire biographique de ces derniers. Exercice dont l’auteure montre tout l’intérêt heuristique. Du fait du faible nombre des entretiens avec des enseignants – neuf, cinq femmes et quatre hommes nés entre 1945 et 1955 – et même si l’auteure oscille entre la reconnaissance de cette limite et la défense de la représentativité malgré tout de son échantillon compte tenu de la faible taille de la cohorte considérée-, ce travail revêt une dimension davantage exploratoire qu’il ne fournit de résultats robustes, mais il soulève et étaye cependant un certain nombre d’intuitions qui, sans être toutes réellement originales, n’en méritent pas moins d’être prolongées.
L’ouvrage est composé de six parties distinctes: la première propose un panorama des transformations sociohistoriques qui ont affecté le contexte suisse entre 1945 et 2010, et de l’école en particulier. Si la fédération helvétique et son école ont connu une évolution générale en bien des points semblables à ses pays voisins (« Trente glorieuses », choc pétrolier, montée de la précarité, mais aussi « libération culturelle » de « Mai 68 » et « démocratisation » scolaire, etc.), les lecteurs étrangers pourront toutefois découvrir au passage quelques spécificités du cas suisse, telles que le fichage des citoyens « de gauche » dans le contexte de la Guerre froide, la mise en place dans la deuxième moitié de la décennie 1960 d’un Conseil de la réforme et de la planification scolaire (le CREPS) ou la mise en place de Hautes écoles pédagogiques (HEP) en 2000 pour organiser la formation des enseignants. Autant d’évolutions qui vont évidemment avoir une influence sur les conditions d’exercice du métier d’enseignant.
Les chapitres qui suivent correspondent aux différentes rubriques de la grille d’entretien de l’auteure: le « choix » et l’entrée dans le métier tout d’abord. Où l’auteure vient nuancer l’idée selon laquelle l’entrée dans l’enseignement aurait longtemps résulté d’une vocation qui se serait aujourd’hui érodée. Or, loin de cette image vocationnelle, ses enquêtés confessent plutôt être entrés dans ce métier par atavisme familial, sinon par hasard, et si « déclic » il y a, celui-ci se produit davantage lors des premiers contacts avec les élèves. Un bonheur immédiat dont témoignent la plupart des enquêtés mais que l’auteure met en doute, celui-ci pouvant relever soit de l' »illusion biographique »3, soit de biais dans la constitution de l’échantillon, dans la mesure où les enseignants rencontrés ont accompli toute leur carrière dans cette profession – et plus encore ici dans le même établissement, qu’ils ont du reste connu dès sa création pour beaucoup. Les deux chapitres suivants sont pour leur part consacrés aux multiples interactions dans lesquelles sont impliqués les enseignants, avec les élèves, les parents, les collègues, leur hiérarchie, mais aussi plus généralement « la » société dans son ensemble. Un aspect évidemment central du métier puisqu’il fait partie des professions emblématiques du « travail sur autrui », que François Dubet – référence abondamment convoquée par l’auteure – a placé au cur de ses récents travaux, en les analysant comme pris par une nécessité de se réinventer en profondeur face au « déclin des institutions »4. L’auteure restitue ainsi les diverses tensions qui se font jour dans ces relations, et qui donnent notamment lieu à la déploration d’une perte de reconnaissance sociale de la profession5. Autant de manifestations que l’auteure impute à une évolution que l’on peut résumer par une « porosité » croissante de l’école et du métier d’enseignant vis-à-vis du reste de la société et de ses attentes.
Contre l’idée, popularisée notamment par Howard Becker6, selon laquelle le statut d’enseignant imposerait une absence de perspectives professionnelles, une carrière « plate » (« flat career ») montre à travers l’examen des trajectoires individuelles que différentes tactiques sont possibles pour « évoluer » dans ce métier, en diversifiant son activité ou en adoptant d’autres objectifs pédagogiques suivant la conception que l’on se fait de son rôle, entre transmission de connaissances et éveil de l’esprit critique de ses élèves. Des évolutions de toute manière rendues nécessaires par la « démocratisation » scolaire et les transformations des « publics » d’élèves qu’elle a induites. La dernière partie enfin revient plus directement sur ce phénomène qui donne son titre à l’ouvrage: celui d’un « désenchantement » du métier d’enseignant, que l’on peut entendre à la fois comme une dégradation de son « prestige » vis-à-vis de l’extérieur, et la dégradation de ses conditions vécues de l’intérieur comme autant d’épreuves. Là encore, l’auteure soulève un certain nombre de pistes intéressantes, tout en apportant quelques nuances. Car les intéressés font eux-mêmes nettement la part des choses entre la déstabilisation de l’institution scolaire et du métier d’enseignant dans son ensemble et leur propre expérience de l’autre. Ce phénomène général devenu une quasi-vulgate produisant de réels effets, à commencer par une « crise des vocations » qui se traduirait par la nette réduction des effectifs de candidats aux concours de recrutement ces dernières années – encore que celle-ci ait des causes institutionnelles beaucoup plus pragmatiques (« mastérisation » et quasi-suppression de la formation professionnelle pour les stagiaires), est ainsi diagnostiqué et vécu de diverses manières par les enquêté-e-s, qui traduisent bien l’écart maintes fois rappelé par les sociologues du travail entre « travail prescrit » et « travail réel ». En d’autres termes, que les uns et les autres sont bel et bien obligés de « bricoler » et de se réinventer quasi quotidiennement7. C’est ce qui fait sans doute la difficulté d’un tel métier8, mais aussi une bonne part de son intérêt.
1. Voir notamment Lilian Mathieu, La démocratie protestataire. Mouvements sociaux et politique en France aujourd’hui, Paris, Presses de Sciences Po, 2011: http://lectures.revues.org/6814
2. Voir entre (beaucoup d’) autres les travaux d’Anne Barrère, par exemple: Travailler à l’école, Rennes, PUR, 2003.
3. Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Raisons pratiques, Sur la théorie de l’action. Paris, Seuil, 1994: disponible en ligne à ce lien: http://homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/raisons/illusion.html
4. Voir François Dubet, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.
5. Sur la question de leur image comme objet et instrument de stratégies des groupes professionnels, voir notamment Régine Bercot, Alexandre Mathieu-Fritz, Le prestige des professions et ses failles. Huissiers de justice, chirurgiens et sociologues, Paris, Hermann, 2008: http://lectures.revues.org/629
6. « The Career of the Chicago Public School Teacher », American Journal of Sociology, n°57, 1952, pp. 470-477.
7. Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, tome I. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1980.
8. À propos duquel l’auteure, par un certain ethnocentrisme de classe, ne cesse de souligner qu’il est le seul à ne pas disposer d’espace de travail individualisé – oubliant ce faisant un grand nombre de professions d’exécution, dans l’industrie et les services qui sont dans le même cas (mais aussi un nombre croissant de consultants soit dit en passant…).
Regard de Françoise Gavillet sur l’image de l’enseignant
Licenciée en Lettres de l’Université de Lausanne, Françoise Gavillet-Mentha a enseigné avec bonheur pendant 25 ans le français au gymnase (secondaire 2), avant de s’investir, par souhait de changer d’interlocuteurs et de niveau d’intervention, dans la formation continue et complémentaire des enseignants, devenant responsable de cette section dans la HEP du canton de Vaud. Au terme de son parcours professionnel varié, elle a éprouvé le besoin d’approfondir, sociologiquement, certains aspects observés au fil de ses rencontres avec les enseignants. C’est ainsi que Françoise Gavillet-Mentha a obtenu un diplôme postgrade en sociologie des Universités de Genève et Lausanne. L’ouvrage qui paraît aujourd’hui est fondé sur la recherche menée dans le cadre de cette formation. Il s’agissait d’entendre des enseignants arrivant en fin de parcours professionnel sur l’évolution de leur métier et de son image, à travers leurs perceptions des mutations sociales fortes des 40 dernières années. Pour traiter son sujet, l’auteure a focalisé son attention sur le métier au secondaire I, voulant prendre un peu de distance par rapport à son expérience personnelle de l’enseignement.
Françoise Gavillet-Mentha, qu’est-ce qui vous a motivée à vouloir dessiner une esquisse sociale du métier d’enseignant?
Je reste attachée à ce métier et je suis régulièrement agacée par tous les « y’a qu’a » adressés à l’école. Il y a chez certains une méconnaissance consternante et prétentieuse de ce qu’est la profession, aussi avais-je l’envie de montrer une part de la réalité du travail scolaire en donnant la parole à des enseignants, via des entretiens.
Entre le métier choisi et le métier vécu, la distance est-elle systématiquement conséquente?
Les enseignants que j’ai rencontrés disent en substance que ce n’est plus le même métier. Ce sentiment d’une rupture, et non pas seulement d’une évolution, est très présent et je pense que ce constat ne concerne pas que les enseignants vaudois. Dans leur discours, on observe que leur envie d’exercer cette profession avait été nourrie en partie par ce qu’ils avaient eux-mêmes vécu en tant qu’élèves et qu’ils ont assez vite découvert une réalité différente et qui s’est encore modifiée avec les années.
Vous consacrez tout un chapitre à ce contexte social et historique, entre 1950 et 2010…
Oui, et pour faire simple, on peut y voir deux grandes périodes. La première, celle des « Trente Glorieuses » correspond pour l’école à un puissant « appel d’air », avec l’engagement de nombreux enseignants, une massification des effectifs et une démocratisation des études. Dès la fin des années 70, le contexte est plus oscillant, entre difficultés économiques avec les conséquences des chocs pétroliers, ou plus récemment la crise financière de 2008, mais aussi des moments de reprise, même si la Suisse a toujours été relativement épargnée par le chômage. Reste que l’école doit de plus en plus faire face à des élèves dont les situations personnelles sont précaires, à des élèves ayant d’autres repères culturels, etc. Naguère les valeurs familiales et sociales étaient les mêmes que celles de l’école, d’où ce tiraillement de plus en plus ressenti.
Diriez-vous que cela a une incidence sur les mutations du métier?
Absolument. Très vite, les enseignants que j’ai interrogés et qui ont commencé à enseigner au début des années 70 ont découvert que leur métier ne ressemblait déjà plus à celui de leurs maîtres. Ceux que j’ai rencontrés ont su s’adapter et ont continué à éprouver du plaisir à enseigner au secondaire I, même s’ils ont expérimenté un désenchantement progressif, avec une école devenue plus « poreuse » aux exigences ou aux demandes sociales et qui doit faire face à une certaine désillusion en ce qui concerne la visée de l’égalité des chances. Cette prise de conscience est douloureuse, car pour plusieurs générations d’enseignants une réussite possible pour tous a été un moteur puissant.
Le métier d’enseignant serait-il devenu un métier comme les autres?
Oui et non. Même si certains décrochent du métier, nombreux sont les jeunes à fréquenter les différentes HEP. Cependant, ceux qui choisissent cette profession ont d’autres attentes et un autre contexte culturel. Peut-être se sentent-ils moins investis d’une « mission » que leurs aînés. Dans le même temps, ce métier garde des spécificités extrêmement importantes et qu’il doit préserver, étant donné que cela représente une condition sine qua non pour la réussite des élèves.
Pourrait-on dire que l’image du métier s’est ternie?
Le principal problème, c’est que tout le monde croit connaître ce métier puisque chacun est allé à l’école. L’enseignant est perçu comme bénéficiant de nombreux avantages, ayant de longues vacances, et plus vicieux à mes yeux, ne connaissant pas la vraie vie – et néanmoins beaucoup de jugements extérieurs sont ambivalents face à ce métier. Comme me l’a dit un enseignant, le métier est soit envié, soit plaint, et l’un n’est pas mieux que l’autre, car ne correspondant pas à la réalité. Les enseignants, si on les écoute, ont vite fait de montrer les problèmes auxquels ils se heurtent tous les jours et qui sont précisément ceux du monde réel et de la société actuelle. Dire que c’est un métier désenchanté, cela me paraît évident, mais ce désenchantement inéluctable n’est pas foncièrement négatif. Pour prendre un exemple, auparavant l’autorité de l’enseignant allait de soi, en raison d’un prestige social, même s’il en abusait, alors qu’aujourd’hui il doit construire son autorité, et ce changement, un parmi d’autres, me semble constituer un progrès.
Pour revenir à l’image parfois caricaturale de l’enseignant, qu’est-ce qui serait à entreprendre pour la rendre plus juste?
A mon sens, l’école et les enseignants devraient encore davantage s’ouvrir sur la société, tout en se protégeant de certains impacts négatifs et en n’oubliant pas que les conditions d’apprentissage impliquent une forme de retrait, puisqu’il est impossible d’enseigner si l’on est en butte à l’agitation sociale et aux attentes contradictoires. Je pense que les enseignants devraient par ailleurs prendre plus souvent la parole dans les médias pour mieux faire connaître leur métier. Tout cela est plus facile à dire qu’à faire, car c’est complexe de permettre aux autres de découvrir un métier de l’intérieur.
Au terme de votre ouvrage, vous évoquez la nécessité d’un investissement de soi pour développer une autonomie assurant une solidité accrue face aux mutations lourdes du métier. Est-ce l’une des spécificités du métier d’enseignant?
C’est l’une des spécificités de tous les métiers où la relation humaine prime. L’enseignant, plus spécifiquement, est toujours dans une double relation, face au collectif et à l’individu, et gérer les deux n’est pas chose aisée, mais c’est aussi dans les échanges avec les élèves que l’enseignant puise son énergie et ses petits bonheurs. Il est constamment appelé à prendre des décisions qui sont déterminantes pour les élèves, d’où une indispensable autonomie.
Ne nous acheminons-nous toutefois pas vers une standardisation et une volonté de contrôle qui pourraient conduire à une diminution de l’autonomie des établissements et des enseignants?
Les harmonisations actuelles sont nécessaires et se situent au niveau du système. Qu’il y ait une volonté de contrôle, c’est patent, mais les moyens de l’exercer ne sont pas adaptés aux spécificités du monde scolaire. C’est le travail en équipe et les concertations entre enseignants qui me paraissent gages de qualité. J’ai d’ailleurs le sentiment qu’en Suisse le fédéralisme, contrairement à la centralisation française, laisse cette marge de manuvre indispensable à l’école et aux enseignants.
Peut-on dire que le métier d’enseignant est désenchanté, mais que ce processus de désillusion n’est pas forcément pessimiste?
Si c’était à refaire, je choisirais à nouveau le métier d’enseignante – et savoir que ce n’est pas l’école à elle seule qui va faire évoluer la société dans un sens plus égalitaire, c’est faire preuve de réalisme. Pour moi, il est primordial de concentrer l’effort ces prochaines années sur l’école primaire et le secondaire I, parce que c’est là que se situent les enjeux essentiels. On ne peut pas accepter, dans un pays aussi riche que la Suisse, qu’un pourcentage élevé de jeunes se retrouve sans formation et donc sans perspective d’avenir professionnel. Il faut davantage d’enseignants de façon à mieux soutenir les élèves en difficulté. La professionnalisation du métier d’enseignant est par ailleurs cruciale.
Propos recueillis par Nadia Revaz, Résonances, juin 2011
Les enseignants vaudois à l’heure des réformes
Françoise Gavillet-Mentha analyse, dans un livre, l’impact des réformes et de l’évolution sociale et sur la vie et le travail des enseignants du secondaire obligatoire
L’école devient l’objet de débats enfiévrés. Qu’il s’agisse de ses structures, de ses méthodes, de ses plans d’études, tout est sujet à controverses. La confiance qu’on lui témoignait jadis s’érode, rongée par les doutes sur sa véritable vocation et sur sa légitimité démocratique. Les enseignants ne se font guère entendre dans ces tumultes; ils sont sur la réserve. Françoise Gavillet-Mentha a décidé de leur donner la parole et d’enquêter sur la manière dont ils vivent ces changements (Un métier désenchanté. Parcours d’enseignants secondaires, 2011, Editions Antipodes).
Pour cela, il fallait du recul. C’est pourquoi elle a opté pour une cohorte qui a traversé l’ère des grandes réformes du collège, c’est-à-dire le premier cycle secondaire dans le canton de Vaud. Elle a conduit des entretiens approfondis avec neuf enseignants et enseignantes qui ont commencé à travailler dans les années 1970.
Une succession de réformes
Les personnes interrogées ont fait des études universitaires et appartiennent à cette génération dite dorée qui a grandi durant les années fastes où l’économie était en pleine croissance. Toutefois, dès les années 1970, avec le premier choc pétrolier (1973), les choses se gâtent et la parenthèse des « Trente Glorieuses » se referme. On pénètre alors dans une période d’incertitudes qui se traduit aussi par une perte de confiance dans l’école et dans sa capacité de promouvoir une véritable égalité des chances.
Dès lors les réformes se succèdent. Elles vont changer radicalement les conditions de travail des enseignants et enseignantes. En 1986, les traditionnels examens de 5e année qui décidaient d’une entrée ou non au collège sont supprimés. Tous les élèves de ce degré pénètrent désormais dans l’enseignement secondaire. Les classes perdent donc de leur homogénéité et le corps enseignant se trouve investi d’une mission d’orientation.
Quelque dix ans plus tard, en 1997, les diverses sections (latine, scientifique, économique, moderne) de la filière qui conduit au lycée (gymnase dans le canton de Vaud, collège dans celui de Genève) sont supprimées et les classes deviennent encore plus hétérogènes.
Enfin, dès 1990, dans le sillage d’une certaine libéralisation de la formation, les établissements gagnent en autonomie et sont considérés comme des petites entreprises éducatives. Les directeurs et directrices deviennent en quelque sorte des managers chargés de promouvoir une meilleure qualité des prestations. Il s’agit avant tout de s’assurer de la rentabilité des investissements consentis.
Une génération bousculée
Les enseignants n’ont, en général, guère apprécié ces changements. Ils s’en sont toutefois accommodés et ont fait de leur mieux. Pour eux, ce qui compte avant tout c’est la classe et la qualité des relations qu’ils y entretiennent avec les élèves. Ces relations, soulignent-ils, sont à la fois individuelles et collectives. C’est là toute la difficulté du métier. Il faut s’adapter aux variations de la chimie des classes tout en restant attentif à la personnalité de chaque élève.
Cette exigence professionnelle est soulignée par toutes les personnes interrogées. Celles-ci relèvent aussi que depuis quelque quinze ans, cette double tâche devient de plus en plus complexe et requiert de nouvelles compétences éducatives. Il ne s’agit plus seulement d’instruire, de jouer ce rôle de « passeur culturel » tant prisé des enseignants mais aussi d’éduquer, de faire apprendre les codes sociaux à certains élèves déboussolés. Cette fonction prend de l’ampleur et se heurte souvent à la désinvolture de certains parents qui ne respectent guère les règles d’usage et n’hésitent pas, par exemple, à faire manquer l’école à leurs enfants pour des motifs souvent futiles.
Cette évolution pèse sur certains enseignants qui regrettent le temps de la sélection précoce et de l’autorité incontestée. Elle en stimule d’autres, qui déclarent que le fait de devoir gagner le respect des élèves les incite à innover et à renouveler leurs pédagogies. Les relations qui se tissent ensuite sont plus riches et plus satisfaisantes qu’elles ne l’étaient lorsque l’autorité du maître allait de soi.
Il est clair que la concurrence des nouvelles technologies rend l’enseignement traditionnel plus difficile. Les enseignants ne sont plus une des sources privilégiées du savoir. Loin s’en faut. Finalement, la conjugaison de ces divers phénomènes qui affectent le statut de l’école conduit à une dévalorisation, à une perte de prestige du métier d’enseigner. C’est sans doute ce que les enseignants interrogés ressentent le plus douloureusement.
Un regard sociologique
Le grand mérite de l’ouvrage de Françoise Gavillet-Mentha est sans aucun doute son regard sociologique et son souci d’inscrire l’évolution de l’école et du métier d’enseignant dans l’histoire sociale. Elle ne cède pas à la facilité de la simple description d’une « génération désenchantée » qui voit ses idéaux s’effriter mais qui résiste et s’accroche à la vision de sa mission: celle d’une transmission réussie de connaissances et du « partage d’uvres culturelles » qu’elle juge importante.
Elle montre que l’école, comme tout autre service public, vit à l’heure de la libéralisation. Elle est de plus en plus soumise aux lois du marché et de la concurrence. Il lui faut désormais arriver à une meilleure qualité, à une meilleure efficacité tout en poursuivant une politique affirmée d’égalité des chances. C’est là que le bât blesse, car l’école – et les recherches le montrent – ne parvient pas à corriger les inégalités sociales.
A cet égard, Françoise Gavillet-Mentha relève l’ambiguïté de la mission du collège: obéir au souci d’une société démocratique en intégrant tous les élèves, et répondre aux besoins du marché du travail en les sélectionnant rapidement, dès les premiers degrés de ce cycle secondaire. Une gageure en un mot et c’est sans doute le mot qui résume le mieux tout ce qu’on attend aujourd’hui de l’école.
Simone Forster, Domaine Public , 21.05.2011
L’école du désir d’avenir, non du passé idéalisé
Excellemment présentée par Pascale Burnier le 12 avril dans ce journal, l’étude sociologique de Françoise Gavillet-Mentha sur une génération d’enseignants stimule la réflexion en ces temps de débat sur l’école vaudoise. Son titre éclaire un aspect important de la question: Un métier désenchanté (Ed. Antipodes).
« Désenchantement » de l’institution scolaire – à ne pas confondre avec des enseignants désabusés! Eux demeurent convaincus et motivés, c’est la fonction qui a perdu son piédestal. La société a transformé sa relation à l’ensemble des institutions; autrefois héritières laïques d’instances de droit divin, elles ont été dépouillées de l’autorité indiscutable qu’on leur reconnaissait. L’ère de l’individualisme et de l’efficacité à court terme a ainsi ramené l’école à un rôle sans mystère que l’on entend formater et remodeler sans cesse.
Une société de consommation habituée à la notion de client-roi considère comme de simples fournisseurs de prestations les enseignants, dépossédés depuis des lustres de l’aura du « régent » d’antan. A chacun de construire son autorité en tant que personne et enseignant compétent, capable de justifier ses exigences.
A l’affirmation individualiste se sont ajoutés un métissage multiculturel croissant et une perte de repères, si bien qu’au nom des « chances égales pour tous », on attend de l’école qu’elle compense à la fois les inégalités sociales, les différences culturelles et les carences éducatives de parents toujours plus nombreux à se trouver dépassés ou désorientés. Mission contradictoire: socialiser les enfants et les sélectionner! Tout en les rendant aptes à s’adapter aux changements aussi imprévisibles qu’incessants que leur imposeront des métiers en évolution accélérée.
Le ton du débat sur l’école le montre, l’enjeu symbolique est bien plus vaste que la formation des jeunes. Auteurs d’initiatives populaires, parents d’élèves, politiciens, experts: tous les discours en disent peut-être moins sur le bien des enfants que sur la société idéale qu’imaginent ces intervenants. On projette sur les générations à venir beaucoup d’attentes déçues et de craintes
Rien d’étonnant à ce que des générations en proie à l’angoisse aient tendance à vouloir se réfugier dans le passé, à revenir aux systèmes qu’elles ont connus (et qu’elles idéalisent). Lorsque l’avenir n’est plus perçu comme porteur de chances mais de dangers, les vieilles recettes inspirent davantage confiance que l’exploration.
Pourtant, c’est l’ouverture, la soif de découverte que l’école doit instiller. Encourager le goût de la recherche et donc du risque: non la crainte, mais le désir. Par exemple, ce n’est pas en collant des notes à des enfants pour les formater dans l’adaptation à ce qui est qu’on les stimulera à faire advenir ce qui n’est pas encore – par eux-mêmes et en toute responsabilité.
En quarante ans, la profession d’enseignant a perdu de son aura
En plein débat, une étude analyse les mutations de l’école
Diplômée en sociologie, Françoise Gavillet-Mentha publie un ouvrage qui retrace le parcours d’enseignants secondaires vaudois.
En quoi le métier d’enseignant est-il désenchanté?
Longtemps, l’enseignement a été affaire de l’Eglise. Quand l’école obligatoire pour tous et toutes a été instituée par l’Etat, elle est restée marquée de ce prestige. Le maître était estimé, respecté, et son autorité n’était pas contestée. Aujourd’hui, l’image sociale de cette profession a changé, parce que la société a profondément changé. Amener les élèves à apprendre est devenu plus difficile. Malgré tout, ces mutations n’ont que peu affecté la vocation des maîtres. Car la relation avec les élèves leur permet de donner du sens à leur travail.
On dit souvent que les jeunes profs manquent d’autorité. N’est-ce qu’une image sociale?
La jeune génération d’enseignants a grandi dans un autre environnement culturel et appréhende donc différemment les élèves. Le maître ne peut plus s’appuyer autant sur la famille. De plus, c’est le cas depuis les années 70, il doit construire son autorité non pas sur son titre, mais sur la qualité de son enseignement. Une évolution positive selon moi puisqu’elle évite les abus de certains maîtres de l’époque.
Comment l’école a-t-elle perdu sa légitimité en 40 ans?
Le boom économique et démographique des Trente Glorieuses a massifié l’école: entre 1950 et 1976, les élèves vaudois ont augmenté de 50%. A cela s’est ajoutée la libération des moeurs. Des jeunes de divers milieux socio-économiques, avec d’autres repères culturels, sont arrivés. La bonne volonté des élèves face à l’apprentissage n’allait plus de soi. Ensuite, à partir des années 1980-1990, l’école a eu de plus en plus de peine à résister à certaines logiques sociales; la demande d’intégrer les règles de l’échange marchand dans l’école, par exemple (le travail de l’élève, quelle qu’en soit la qualité, doit être « payé » d’une bonne note). Enfin, la plus grande désillusion est venue de la prise de conscience progressive de l’efficacité limitée de l’école à promouvoir l’égalité des chances. L’école vaudoise est restée très élitiste, même si, c’est un progrès réel, la proportion d’élèves en voie prégymnasiale a plus que doublé par rapport aux années 70.
Les enseignants consacrent toujours plus de temps à l’éducation. Est-ce leur rôle?
Cela fait une vingtaine d’années que l’éducation a progressivement pris de l’importance dans ce métier. Parfois, les maîtres n’ont pas le choix s’ils veulent pouvoir donner leur cours. Mais je ne pense pas qu’il y ait pour autant démission des parents. Ils continuent à avoir beaucoup d’attentes par rapport à l’école, qui doit permettre à leur enfant de trouver sa place dans une société toujours plus dure.
L’école ne se concentre donc plus autant sur la transmission des savoirs…
Le niveau de compétence est aussi élevé qu’avant. Certes, l’orthographe, par exemple, baisse. Mais cela vient aussi du fait qu’elle a perdu de l’importance dans notre société. Les élèves d’aujourd’hui maîtrisent d’autres domaines que nous ne connaissions pas à mon époque, comme les nouvelles technologies.
Aujourd’hui, certains souhaitent un retour à l’école de grand-papa. Réaliste?
Je pense que la nostalgie ne mène à rien. Les conditions de vie et la société ont changé; un retour à une école d’antan n’est pas envisageable. Il faut plutôt s’inquiéter de la manière dont l’école échoue à aider des élèves de milieux défavorisés à trouver une bonne insertion sociale. Aujourd’hui, en fin de scolarité, plus de 15% des élèves sont sans solution (ni diplôme ni apprentissage). Je trouve choquant qu’on les laisse sur le bord de la route. Il s’agit là du principal défi de l’école de demain.
Pascale Burnier, 24Heures, 12.05.2011
Enseignants, aux racines du désenchantement
L’école occupe une large place de la discussion publique. Mais les enseignants sont le plus souvent absents du débat, devoir de réserve oblige. Comblant cette lacune, le livre de Françoise Gavillet-Mentha donne la parole à des profs vaudois, qui ont commencé leur carrière dans les années 1970 et qui révèlent les causes de leurs désillusions
Notes, pédagogie, plan d’études, orientation, sélection, égalité des chances, incivilité… Depuis plusieurs années, l’école occupe une large place de la discussion publique. Les sujets chauds bousculent l’agenda politique, des initiatives sont lancées, des contre-projets forgés, la population est appelée à voter. Comme dans le préau, celui qui crie le plus fort maximise les chances d’être entendu. Les jugements à l’emporte-pièce éclipsent habituellement les appréciations nuancées et documentées.
Si l’on met beaucoup en avant les avis d’experts (reconnus ou autoproclamés…), les grands absents du débat sont les enseignants, astreints au devoir de réserve. C’est frustrant si l’on songe qu’ils restent les acteurs clés du processus scolaire. Un des mérites de la contribution de Françoise Gavillet-Mentha est de combler ce vide. Une longue carrière d’enseignante derrière elle, l’auteure a recueilli le témoignage d’une douzaine de maîtres de l’école secondaire vaudoise. Ces professionnels racontent comment le métier a changé depuis qu’ils ont entamé leur carrière, à l’aube des années 1970. Tous témoignent, à des degrés divers, d’un désenchantement progressif du métier dont l’ouvrage analyse les ressorts.
Génération désillusionnée
Bien qu’en empathie avec ses sources et son sujet, Françoise Gavillet-Mentha évite le piège du plaidoyer corporatiste. Citant Pierre Bourdieu (« Comprendre, c’est comprendre d’abord le champ avec lequel et contre lequel on s’est fait »), l’épigraphe donne le ton. Les outils d’analyse sont empruntés à la sociologie. L’objet de recherche est le cur du métier d’enseignant -cette relation sur et avec les élèves et son évolution dans un contexte mouvant, avec des attentes de la société qui ont changé radicalement et à vitesse accélérée.
Le canton de Vaud, estime l’auteure, est un lieu privilégié pour observer ces fluctuations. Les débats idéologiques à propos de l’école y perdurent depuis les années 1950. L’ouvrage brosse ainsi, avec efficacité, les étapes de la mutation du système éducatif vaudois, sans ignorer le contexte national.
Les enseignants entendus appartiennent tous à cette génération privilégiée qui a grandi et s’est formée dans les années 1950 et 1960, « âge d’or » de l’éducation. L’économie croissait vite, l’ascenseur social fonctionnait et un solide consensus social entourait l’école, chargée d’élever le niveau général de formation. Les parents étaient alors persuadés que leurs fils et leurs filles auraient « une vie meilleure que la leur ». Et la réalité les a confortés dans cet optimisme.
La situation s’inverse dans les années 1980, quand la croissance se met à hoqueter et que l’Etat devient la cible d’attaques aussi féroces que systématiques. Rançon d’une précarité nouvelle, des parents déstabilisés perçoivent désormais l’avenir de leurs enfants comme un risque et non plus comme un progrès. L’école devient alors une des institutions étatiques les plus ébranlées: on attend toujours davantage d’elle tout en contestant son autorité et en l’attaquant dans ses missions et ses résultats.
Françoise Gavillet-Mentha montre bien la relation étroite entre ce contexte d’affaiblissement de l’Etat, la remise en cause de l’école et les trois grandes révisions à l’origine du désenchantement pour leur métier d’une génération d’enseignants. Première révision: l’école dans laquelle ils exercent n’a plus rien à voir avec celle dans laquelle ils ont été élèves. La massification de l’instruction a changé la donne. L’individualisme dominant et la révolution numérique ont encore approfondi le fossé. La bonne volonté des élèves face aux apprentissages ne va plus de soi; la motivation doit être construite, les tâches d’éducation deviennent indispensables. Bref, les conditions d’un exercice paisible du métier n’existent plus.
La deuxième révision: l’impératif de contrôle, de concurrence, d’évaluation de l’école et du travail d’enseignant est vécu comme la négation de la spécificité du métier. Celui-ci se vit dans la relation avec l’autre, il nécessite par nature une adaptation permanente, on est dans le registre de l’intuition. L’ampleur de cette résistance à une exigence contemporaine illustre à quel point l’école et une partie de ses acteurs « sont encore attachés à la conception sanctuarisée de l’institution », souligne opportunément l’auteure.
Et la relève?
Troisième révision, présentée comme « la plus douloureuse »: l’efficacité limitée de l’école, voire son échec à promouvoir l’égalité des chances et à réduire les inégalités sociales -les études sont là pour le prouver-, fait naître doute, déception et parfois même agressivité chez les enseignants. Le constat de désillusion face à la mission et au statut du métier ne contamine pourtant guère la pratique au quotidien. Pour ces professionnels, la primauté de la relation aux élèves, construite dans une relative autonomie et dans l’intimité de la classe, apporte son lot de satisfactions fugaces et inattendues. C’est cela qui préserve le sens du métier.
Cette distinction entre métier prescrit et métier réel est présentée comme rassurante. Mais la relève est-elle préparée à exercer le métier, devenu bien plus difficile, dans le contexte social contemporain que l’on sait? C’est la limite de cette intéressante biographie d’une génération d’enseignants: éclairant un processus historique, elle ne s’aventure pas sur le terrain prospectif.