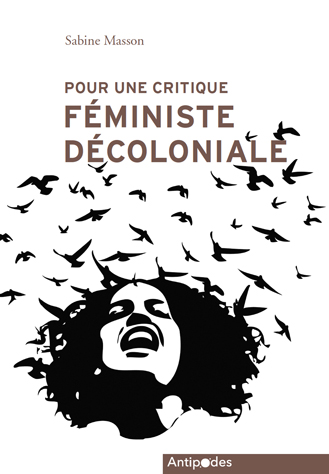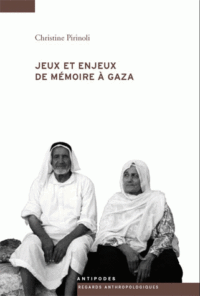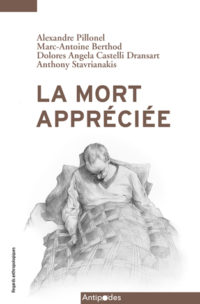Pour une critique féministe décoloniale
Réflexions à partir de mon engagement avec des luttes indigènes
Masson, Sabine,
2016, 259 pages, 29 chf, 23 €, ISBN:978-2-88901-120-9
Comment se façonne « l’Autre » dans les politiques de développement vis-à-vis des populations indigènes rurales au Mexique et au Honduras? Comment interviennent les rapports sociaux de sexe et de race dans cette construction? Que dit-elle de l’actualité des relations coloniales de pouvoir? En se fondant entre autres sur son expérience de recherche-action dans ces pays d’Amérique latine, l’auteure analyse quelques-uns des mécanismes de construction sociale de l’altérité sous l’angle du genre et du racisme. Un ouvrage qui s’inscrit dans les débats contemporains sur la question des héritages coloniaux, évoqués aussi en rapport au contexte européen de racisme et de sexisme, d’islamophobie et de répression des migrant·e·s.
Description
À partir des recherches et de l’engagement militant de l’auteure avec des mouvements indigènes au Mexique et au Honduras, ce livre développe une critique féministe des relations coloniales de pouvoir.
Il s’intéresse aux politiques néolibérales de développement dit durable ou ethnique, traversées par le genre, le racisme et la colonialité. Ces politiques, contre lesquelles des organisations et des communautés se mobilisent, menacent les terres et les cultures de populations indigènes.
Sur la base de ce terrain de luttes, mais aussi de contributions féministes antiracistes et postcoloniales – les apports en particulier de féminismes noirs, indigènes, chicanos ou subalternes – cet ouvrage s’inscrit dans les débats contemporains sur la question des héritages coloniaux, qu’il évoque aussi en rapport au contexte européen de racisme et de sexisme, d’islamophobie et de répression des migrant·e·s.
Enfin, l’auteure engage une réflexion sur la transformation décoloniale des pratiques, des connaissances et des recherches féministes. Se fondant entre autres sur son expérience de recherche-action au Mexique, elle revient sur les enjeux de la décolonisation de l’anthropologie féministe, et plus largement sur la concrétisation d’une perspective plurielle et décentralisée des luttes des femmes.
Table des matières
Préface. A todas las bertas
Introduction. Défaire la colonialité aujourd’hui
- Mon cheminement vers une approche décoloniale
- Actualité de la colonialité
- Racisme, sexisme et répression de l’immigration en Europe
- Altérité et colonialité en Suisse
- Colonialité sans colonies
- Impérialisme, homonationalisme et migrant·e·s indésirables
- Des discours et des politiques de pouvoir
1. Critiques décoloniales
- Féminismes et antiracisme
- La simultanéité des oppressions: féminismes noirs aux États-Unis et en Angleterre
- « Noircir le féminisme »: féminismes noirs en Amérique latine et aux Caraïbes
- Féministes chicanas: penser la frontière
- La percée de « l’intersectionnalité »
- Rapports sociaux imbriqués, articulation des luttes
- La modernité et la colonialité: vers une histoire globale
- « L’envers » de la modernité
- Esclavage et pensée des Lumières
- Représentations contemporaines du « manque » de modernité
- République, universalisme et colonisation
- Au-delà des temporalités coloniales
- Tournant décolonial de la pensée critique?
- Émergence d’une « question postcoloniale »?
- Que signifie « postcolonial »?
- Les Subaltern Studies
- La critique de l’orientalisme
- Genre et postcolonialisme
2. Critiques de la colonialité et géopolitique du genre en Amérique latine
- Études subalternes et critiques décoloniales latino-américaines
- Féminismes autonomes et décolonisation du genre
- Institutionnalisation du féminisme et politiques de développement
- Le genre: un concept colonisateur de la pensée féministe latino-américaine?
- Féminismes et colonialisme interne
3. Colonialité et politiques néolibérales de développement
- Capitalisme et développement « durable »
- Le contexte des politiques néolibérales au Mexique et en Amérique centrale
- Chiapas: assistance, développement et répression
- Répression politique et programmes assistantialistes
- « Catastrophe naturelle » et contrôle des populations rurales
- Honduras: développement « durable », racisme et appropriation des terres
- La Ruta Lenca et le développement ethno-touristique
- Indura Resort: l’écologie et la culture garífuna dans un projet non durable
- Folklorisation versus autodétermination
4. Résistances indigènes
- Décolonisation politique et mouvements indigènes
- Mouvements de femmes indigènes: le genre et la décolonisation
- Les soulèvements de femmes indigènes
- Une action de la décolonisation
- La diversité des positions politiques des femmes indigènes
- Le croisement des appartenances et la lutte intégrale
5. En guise de conclusion: pratiques et recherches féministes décoloniales
- Pour une géographie décoloniale des luttes des femmes
- Repenser l’universalisme
- Contre le multiculturalisme libéral
- Politique de la position et féminismes transnationaux
- Vers une recherche féministe décoloniale?
- Institutionnalisation des approches postcoloniales et intersectionnelles
- Transformer les savoirs féministes
- Méthodologies et langages décoloniaux
Bibliographie
Presse
Sabine Masson nous parle de son ouvrage dans Sortir du capitalisme : Ecouter l’émission
Une émission de présentation du féminisme décolonial, féminisme anti-colonialiste poussant à une décolonisation du féminisme (et de l’anticapitalisme), autour de Pour une critique féministe décoloniale (Éditions Antipodes, 2016) – avec l’autrice, Sabine Masson, sociologue, juriste et surtout militante féministe engagée auprès des femmes du Honduras et du Chiapas, également co-directrice de Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes (Nouvelles Questions Féministes, 2005)
Avec une présentation de l’origine de ce livre comme produit d’une rencontre de Sabine Masson, « féministe blanche » suisse, avec des femmes indigènes et leurs problématiques spécifiques ; une définition du féminisme décolonial comme critique du féminisme blanc, centré sur une universalisation abusive de l’expérience (prise comme norme) des femmes blanches de classes moyennes des centres capitalistes occidentaux, aveugle à ses privilèges de dominants de « race » et aux formes contemporaines de colonialisme, et potentiellement porteuse de discours islamophobes, racistes et néocoloniaux ; avec une critique de la « culturisation du patriarcat », vu comme une oppression extra-occidentale ; avec une critique du regard du féminisme blanc vis-à-vis des « femmes du Tiers-monde » comme catégorie homogénéisée, essentialisée et orientalisée de manière misérabiliste ; avec une présentation des mouvements de femmes indigènes, leur critique des permanences des rapports coloniaux de pouvoir et du racisme colonial, leurs rapports vis-à-vis du féminisme comme concept et comme mouvement et vis-à-vis du mouvement indigène masculin ; avec une discussion du « féminisme communautaire » bolivien, critique en même temps du néolibéralisme, du patriarcat occidental et du patriarcat indigène ; avec une analyse du clivage entre « féminisme institutionnel », proche des politiques de développement de l’ONU spécifiques aux femmes, et « féminisme autonome », s’opposant à ce processus de cooptation et de neutralisation du féminisme ; avec une critique de l’ethno-tourisme, son essentialisation, altérisation et traditionalisation des populations indigènes, sa promotion d’une marchandisation des rapports sociaux, et son rôle d’occultation des violences accompagnant tout projet de développement contesté ; et un appel à une décolonisation du féminisme et de l’anticapitalisme.
Féminisme décolonial et luttes indigènes au Mexique et au Honduras
Sabine Masson a effectué un travail de terrain au Mexique et au Honduras avec des collectifs de femmes indigènes en lutte. Cela l’a amenée à critiquer les relations coloniales de pouvoir au sein des politiques de développement et à mettre en lumière des courants féministes qui déconstruisent ces rapports de pouvoir. Entretien.
Silence: Dans votre livre, vous expliquez que des féministes noires, chicanas, indigènes, etc., ont fissuré l’idée d’un féminisme universel en montrant qu’il s’agissait en réalité d’un « féminisme blanc » qui ne prenait pas en compte l’expérience de toutes les femmes. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de positionnements faussement universels?
Sabine Masson: Les luttes des femmes indigènes au Chiapas (Mexique), où j’ai été amenée à réfléchir sur ces thématiques, ont interpellé le féminisme construit sur la base de l’expérience de femmes aux positions dominantes (dans les rapports de race, de classe, ville/campagne, Nord/Sud). Faisant écho à de précédentes interventions de femmes racisées (1), l’auto-organisation des femmes indigènes au Chiapas a conduit au questionnement de certaines revendications féministes. Partant de leur « triple oppression » (comme femmes, pauvres et indigènes), les militantes ont par exemple souligné les violences sexistes et racistes sur leur corps, et complexifié le thème du droit à la contraception et à l’avortement. Elles ont dénoncé les cas de stérilisations forcées et le fait qu’aujourd’hui elles continuent, à travers des programmes d’assistance dans le monde rural ou lors de séjours à l’hôpital, de se voir proposer ou imposer des méthodes définitives de contraception. Il importe donc de penser la contraception dans une perspective de genre, de race et de classe, car comme l’a exprimé Angela Davis aux États-Unis: « alors que les femmes de couleur sont poussées à tout bout de champ à devenir définitivement infertiles, les femmes blanches qui ont une condition économique prospère sont enjointes par les mêmes forces à se reproduire ».
Pourquoi selon vous est-il nécessaire de considérer la question du genre de manière forcément imbriquée avec d’autres rapports de pouvoir (de classe, de « race »,etc.)?
Parce que les catégories de pouvoir et les rapports qui s’y rattachent ne fonctionnent jamais seuls, ils sont co-construits et s’articulent. Dès lors, si l’on veut s’y attaquer, sans ignorer voire reproduire un axe de domination, il convient de les considérer conjointement. Pour ne prendre qu’un exemple, dans le contexte européen actuel, le racisme contre des groupes minoritaires (migrants, non blancs, musulmans, descendants de colonisé-es) s’appuie notamment sur des discours et des lois se rapportant à des « questions de genre » (violences sexuelles et sexistes, traitement et place des femmes, etc.). Pensons en particulier aux multiples législations interdisant le port du hijab et du niqab qui se font écho en France, en Belgique, en Suisse: elles ciblent le statut des femmes au sein de ces minorités, tandis que le groupe majoritaire (occidental, blanc, national, chrétien) apparaît comme étant porteur de « valeurs » d’égalité. Cette manière de faire renforce la subordination des groupes minoritaires en utilisant, entre autres, un registre du genre. On est donc bien en présence de rapports de pouvoir imbriqués.
Pourquoi écrivez-vous que le genre et la diversité sont utilisés comme des « concepts colonisateurs » en Amérique latine, en lien avec les politiques de développement?
Je me suis penchée sur des travaux féministes qui incitent par exemple à réfléchir sur la manière dont certains organismes de développement ont introduit une perspective de genre ethnocentrée et institutionnelle, qui a marginalisé une partie plus radicale des féminismes latino-américains. (2)
Mon terrain d’étude montre entre autres comment certaines politiques de développement dans le monde rural indigène utilisent le genre et l’ethnicité pour légitimer des projets touristiques désastreux pour les communautés. La commercialisation d’un folklore indigène aux abords de complexes touristiques est par exemple mis en avant comme une opportunité de développement, alors qu’elle véhicule une image sexiste et raciste des cultures indigènes (le « sourire des femmes », leurs « habits colorés », les « danses typiques », etc.) et que ce tourisme met en danger l’autosubsistance des communautés (privatisation des terres et expulsion des habitant· es, problèmes liés à l’environnement, à la souveraineté alimentaire, etc.).
Vous appelez les féministes à opter pour une « politique de la position ». Qu’est-ce que cela signifie et comment des solidarités entre les femmes du monde sont-elles possibles si l’on renonce à un féminisme universaliste?
La politique de la position peut se comprendre comme une approche féministe qui situe son discours, nomme sa partialité et sa subjectivité politiques. Elle permet d’appréhender la position de chacun et de chacune en termes de rapports de pouvoir, prenant acte qu’aucun groupe en lutte n’est homogène et qu’il peut reproduire des formes d’oppression. Cette reconnaissance des divisions peut constituer le point zéro d’une solidarité féministe renouvelée, pensée non pas à partir d’un modèle particulier présenté comme universel (telle que la conception occidentale et libérale de l’égalité) mais comme des alliances possibles entre des résistances plurielles, autodéterminées, entre des actrices aux positions divergentes. Il n’existe donc pas de « sororité » a priori mais un travail « àfaire » de coalitions face aux diverses oppressions de genre, dans lequel aucune position n’est représentative de toutes et qui ne peut se faire qu’en conscience de ces divisions. Dans cette optique, il s’agit en effet de rompre avec un féminisme à vision universaliste abstraite, qui masque sa position dominante et prétend parler pour toutes. Cela ne veut pas dire pour autant renoncer aux solidarités, au contraire, mais ancrer celles-ci dans une approche concrète et non hiérarchisée des histoires et des luttes des femmes dans différentes parties du monde.
Propos recueillis par Guillaume Gamblin, Silence, No 460, octobre 2017, pp. 30-31.
(1) Comme celles des féministes noires aux États-Unis.
(2) Cette réflexion s’inscrit dans le fil conducteur de mon livre, qui traite de la question des héritages coloniaux et de l’actualité de relations coloniales de pouvoir au Mexique et au Honduras. Je m’inspire en particulier d’interventions et de théories mettant en lumière la « colonialité du pouvoir et du savoir ».
Cette idée vise un système de hiérarchisation des cultures et des connaissances issu de la colonisation, interpellé dans l’actualité notamment par des luttes indigènes et des courants critiques comme les études subalternes latineaméricaines.
Ces travaux articulent la critique « décoloniale » des relations sociales et des connaissances avec une analyse des rapports de genre.
Féministes aux colonies
Sociologue et juriste, Sabine Masson mène depuis des années ses recherches au Honduras et au Mexique. Elle y est engagée auprès d’organisations indigènes, où elle contribue à une action d’éducation populaire. Son livre part de cette expérience pour explorer avec précision les conséquences des politiques néolibérales dans différents pays latino-américains. Le coeur de son ouvrage repose dans l’analyse des résistances indigènes, notamment des soulèvements de femmes qui mêlent rapports au genre et à la décolonisation.
Un autre grand apport de son livre réside dans les allers et retours entre travail de terrain et réflexion théorique: les deux chapitres consacrés aux critiques décoloniales et à la géopolitique du genre sont de remarquables synthèses des travaux en cours. Pour une critique féministe décoloniale se révèle dès lors très précieux comme état des lieux sur les luttes indigènes, les savoirs féministes et les méthodologies décoloniales. Au final, cette approche très utile sait combiner perspectives pragmatiques et théorie politique.
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2017/4 (N° 136), pp. 175-182.
Pour un féminisme « décolonial »
A travers son travail avec des femmes autochtones du Mexique et du Honduras, la Suissesse Sabine Masson propose une critique féministe des relations coloniales de pouvoir.
Forte de son militantisme et de ses recherche-actions avec des femmes indigènes d’Amérique centrale durant plusieurs années, Sabine Masson livre un ouvrage passionnant intitulé Pour une critique féministe décoloniale1. De quoi dégommer nombre de préjugés, qu’ils soient encore ceux de certains acteurs de la coopération au développement ou de milieux féministes euro-centrés. Interview de cette militante féministe et docteure en sociologie, devenue juriste.
Qu’entendez-vous par critique féministe décoloniale?
Sabine Masson: Le terme « décolonial » est utilisé par certains des collectifs et mouvements indigènes avec lesquels j’ai travaillé au Mexique et au Honduras et aussi par des militantes et des chercheuses féministes. L’impulsion vient notamment de femmes indigènes, qui font partie des groupes dominés et racisés dans ces pays. Elles questionnent la continuité des rapports sociaux marqués par l’histoire coloniale. Les relations économiques, culturelles et politiques y sont empreintes de ce que certains auteurs ont appelé la « colonialité du pouvoir et du savoir », autrement dit un ordre matériel et idéologique issu de la colonisation. La colonialité hiérarchise des collectivités et des cultures entre elles, participant d’une stigmatisation des populations indigènes réduites à des stéréotypes, ce qui permet de faire perdurer des formes de domination et d’exploitation. On continue à percevoir «l’Autre», «l’Indigène », comme devant passer d’une civilisation perçue comme «archaïque» à une civilisation dite «moderne» et du progrès, en abandonnant des pratiques collectives pour aller vers des modalités plus individuelles ou marchandes de leurs économies. Par exemple, j’ai analysé dans mes travaux comment certaines politiques de développement d’orientation néo-libérale, notamment dans le tourisme, utilisent un registre de l’ethnicité («les cultures vivantes», les «danses typiques», les «femmes indigènes aux habits colorés de tradition ancestrale», etc.) tout en implantant des projets et des infrastructures portant atteinte au droit à l’audodétermination des peuples, favorisant la privatisation des terres, des services et des biens communs naturels.
En quoi cette critique est-elle spécifiquement féministe?
Elle est notamment portée par des femmes qui mettent en cause l’imbrication des dominations: non seulement racistes et postcoloniales, mais également au plan des rapports de genre. Par exemple, les collectifs de femmes indigènes avec lesquelles j’ai travaillé font l’expérience du poids de l’histoire coloniale et postcoloniale locale, marquée par des rapports de servitude (domestique, agraire, etc). Elles doivent ainsi mener des luttes sur plusieurs fronts. Elles se confrontent à des structures patriarcales et racistes de la société mexicaine ou hondurienne qui les a assignées au statut de « petites servantes », elles luttent en créant des coopératives en vue d’une autonomie alimentaire, elles combattent des formes de recolonisation de leurs territoires causées par des « grands projets » (barrages, exploitations minières, infrastructures touristiques, déforestation, etc.), mais elles cherchent aussi à transformer les rapports de genre dans leurs organisations et dans leurs communautés. Par ailleurs, ces collectifs de femmes indigènes ont aussi des positions critiques face à certains courants féministes dominants, lorsqu’ils reproduisent des formes de domination marquées par le racisme et la colonialité.
Vous racontez que votre propre regard féministe s’est transformé auprès de ces femmes indigènes.
Oui, je me suis considérée auprès d’elles comme une apprentie. J’ai été amenée à prendre conscience de ma position de femme blanche, dominante parce que venant d’un pays riche, associé à l’impérialisme, et aux rapports géopolitiques inégalitaires. J’ai alors cherché à écouter de ce qu’elles avaient à me dire, y compris sur mon propre racisme et ma position dominante. Car si nos propres privilèges restent impensés, on reproduit les rapports de domination qu’on prétend vouloir éradiquer.
Le fait d’avoir fait partie de collectifs féministes ou d’avoir travaillé entre autres dans les études genre n’entraînait évidemment pas une réflexion autocritique automatique. J’ai donc tenté de réfléchir à ces impensés, en particulier d’analyser plus en profondeur les imbrications du racisme et du sexisme. Dans le sud du Mexique, ces collectifs indigènes montrent en particulier le continuum des violences à l’encontre des femmes, qui se manifestent dans la famille mais qui sont aussi liées aux difficultés de l’accès à la terre, à la militarisation des villages, à la répression des organisations politiques, au racisme et au sexisme présent dans les institutions, les commerces et l’espace public en général.
Le regard féministe « occidental » n’est donc pas toujours adapté pour travailler dans ce contexte?
Je poserai la question autrement: comment décoloniser certains regards féministes « occidentaux » à partir de ces critiques? Dans mon expérience, il s’agit par exemple de comprendre comment certaines pratiques ou visions du développement sont rejetées par les femmes avec lesquelles j’ai travaillé, parce qu’ils nient leur histoire et leur subjectivité ou reproduisent la colonialité du pouvoir. Par exemple, certains programmes de contrôle des naissances constituent une nouvelle violence sur le corps des femmes pauvres. Ou encore, certains projets de développement se centrent sur l’émancipation individuelle par le travail, l’entreprenariat indigène ou le microcrédit, souvent sans consultation préalable et en contradiction avec les approches basées sur l’accès collectif à la terre, le maintien de pratiques d’échanges solidaires et les luttes pour les droits. Autant d’idées mises de côté par certaines approches «genre et développement» qui ne tiennent pas compte des situations sociales plus globales auxquelles ces femmes sont confrontées, et qui ne cherchent pas à transformer cette globalité des rapports sociaux (capitalistes, racistes, patriarcaux).
Le travail des ONG n’est pas exempt de ce regard et de ces pratiques hérités du colonialisme…
En effet, souvent portés par des ONG occidentales mais aussi locales, urbaines, au Mexique par exemple, qui véhiculent encore des représentations sur ce qui est bon pour « les femmes indigènes, pauvres, paysannes ». Au contraire, il conviendrait de décoloniser les politiques de développement et déconstruire le paternalisme dont sont empreintes ces approches. A cet égard, j’encourage à prendre connaissance et lire les paroles, interventions et écrits des militantes, des chercheuses et des intellectuelles indigènes avant de mener tout travail anthropologique à partir de pays dominants.
Les rapports doivent être rééquilibrés pour que les femmes indigènes puissent être les actrices principales de leur devenir. L’approche top-down (du haut vers le bas) doit être abandonnée au profit de solidarités qui partent des désirs et des projets des premières intéressées.
La coopération au développement n’a-t-elle pas appris la leçon?
Beaucoup de politiques de développement, notamment celles centrées sur l’accès au commerce comme moyen de « lutte contre la pauvreté », poussent les communautés vers des formes économiques individualistes et marchandes qui ne répondent pas aux aspirations et visions de nombreuses populations, reven-diquant la redistribution des terres ou la souveraineté alimentaire. Il est important de nous préoccuper en priorité de ce que ces femmes indigènes nous disent, de reconnaître leurs savoirs historiquement disqualifiés (dans le domaine de l’agriculture, de la santé, entre autres), ainsi que leurs combats interreliés: contre le patriarcat mais aussi par exemple pour pouvoir parler leur propre langue, historiquement discréditée, et obtenir leur autodétermination sur leurs territoires. Car nos identités sont toujours multiples, nous ne sommes pas que « femmes ».
Propos recueillis par Christophe Koessler, Le Courrier, 8 mars 2017
Qu’est ce qui constitue une oppression, pour qui, dans quel contexte et comment échanger en tenant compte de cette complexité
« Au moment de publier cet ouvrage, le Honduras est secoué par un nouvel assassinat politique. Berta Cáceres, militante indigène lenca, cofondatrice et coordinatrice du Conseil civique d’organisations populaires et indigènes du Honduras (Copinh)… » Sur cet assassinat: « Mission internationale justice pour Berta Cáceres« ; Face à l’assassinat de notre camarade Berta Cáceres (Trois textes).
Dans son introduction « Défaire la colonialité aujourd’hui », Sabine Masson rappelle que la question coloniale est bien d’actualité, dans les pays anciennement colonisés, mais aussi, me semble-t-il dans les pays colonisateurs. Elle parle d’ »une véritable décolonisation des rapports sociaux (économiques, géopolitiques, culturels) », des marques de la violente déshumanisation des colonisé-e-s, des héritages coloniaux, des formes actuelles de domination. « Ce livre se propose d’explorer cette question en partant de l’idée suivante: un ordre matériel et idéologique issu de l’histoire coloniale moderne resurgit dans l’actualité politique, souligné et combattu par divers mouvements sociaux et courants critiques en sciences humaines et sociales. »
Elle souligne, entre autres, les présupposés eurocentriques en sciences sociales et humaines, la disqualification des savoirs historiquement minorisés ou des subjectivités non-occidentales, les « relations coloniales de pouvoir », la « colonialité du savoir », l’empreinte coloniale dans « les schèmes de pensée, même critique, de gauche, progressistes, féministes ». Elle annonce qu’elle traitera « de la colonialité dans une perspective simultanément antisexiste et antiraciste ». Il est difficile dans les analyses de prendre en compte l’ensemble des rapports sociaux et leur imbrication, il est donc légitime de choisir de limiter les axes de travail. Mais cela n’est pas sans conséquences ici par la mise « à l’écart » des rapports sociaux de classe. Ce qui ne veut pas dire que l’auteure ne traitera aucunement de cette dimension qui n’est pas réductible aux dominations « occidentales ». L’auteure parle de « repolitiser la question de l’altérité, de défaire les constructions duales et hiérarchisées entre ‘eux’ et ‘nous’ et la projection d’une altérité perçue comme la négation de l’Europe, montages exacerbés par des politiques migratoires répressives ». Elle lie les constructions de l’altérité à la mondialisation capitaliste et aux politiques néolibérales.
Féminisme, féminismes, pluralité des femmes pour leur autodétermination, action collective et reconstruction de savoirs, alliances et solidarités féminines. Si l’universel n’est jamais un donné et peut couvrir de réelles dominations, je reste dubitatif sur l’expression « féminisme non universalisant ».
L’auteure explicite ses réflexions sur le colonialité, ses critiques féministes et antiracistes, ses engagements et ses recherches au Mexique et au Honduras, « les luttes des femmes indigènes apportent une perspective sur l’articulation du sexisme, du racisme et de la colonialité », son cheminement…
Divisions sexuelles du travail, modalités de l’emploi féminin, travaux invisibles et déqualifiés des femmes, lutte pour l’autodétermination des peuples indigènes, « invisibilité des lieux, des pratiques, des travaux des femmes », entrelacement des résistances, interrelation des rapports sociaux de race et de sexe…
« C’est donc en me trouvant décentrée d’un ancrage culturel occidental, forcée de voir ma blanchité comme une couleur qui pour une fois sautait aux yeux et n’était plus cette norme invisible ne différant de personne (contrairement à l’altérité intrinsèque des groupes minoritaires), que j’ai abordé la particularité de mon féminisme, sa position de race, vis-à-vis des femmes qui luttaient au Chiapas. » L’auteure parle, entre autres, des conceptions faussement universelles, de la critique des Black Féminists, des appartenances antagoniques et de celles qui rassemblent, du climat raciste culturalisant des pratiques sexistes, de l’intersectionnalité, des expérience subjectives et politiques, de dépolitisation, de l’actualité de la colonialité, de la répression de l’immigration en Europe, des discours et mesures racistes, de ce qui est considéré « comme intangiblement distantes des ‘valeurs’ nationales et/ou européennes, chrétiennes ou laïques », du discours racialisant, de l’invention d’une « européanité ». La notion de valeur en elle-même me semble très discutable. Une nation, un État, un continent, une religion ne saurait avoir des valeurs, ce sont les individu-e-s et leurs actions historiquement contextualisées qui développent et pensent des « valeurs » et les projettent éventuellement sur un cadre national, religieux, etc.
Sabine Masson aborde particulièrement le racisme s’appuyant sur la « culture », la différenciation culturelle, la catégorisation des comportements humains ou des appartenances sociales prêtées à d’autres, la réduction des individu-es à un critère arbitraire (comme un foulard porté), la fabrication de différences culturelles sexuées présentées comme essentielles, le masculinisme comme marqueur culturel des hommes migrants, l’altérité et la colonialité en Suisse, les comportements pris de manière a-historique et décontextualisés, la racialisation des étranger-e-s, la hiérarchisation des groupes humains ou de leurs expressions sociales, la notion de devoir d’intégration, la construction de critères d’évaluation des « collectivités entre elles », la « racialisation des sexualités », les discours et les « régimes de vérité »… « La force de beaucoup de questionnement féministes décoloniaux, qui abordent les représentations de l’altérité, du progrès ou du développement sous l’angle critique du genre et du racisme, réside dans le fait d’inscrire ces constructions dans un contexte mondialisé de dominations matérielles et symboliques. »
J’ai fait le choix de m’attarder sur cette introduction. Je ne signale que les titres trois parties suivantes: 1. Critiques décoloniales; 2. Critiques de la colonialité et géopolitique du genre en Amérique latine; 3. Colonialité et politiques néolibérales de développement.
Avant d’aborder le chapitre 4. Résistances indigènes, avec mes propres considérations et vocabulaires, je fais un détour, qui n’est pas vraiment un pas de coté.
Certaines organisations sociales n’ont pas été déstructurées ou réorganisées par les logiques internes aux dynamiques capitalistes. En particulier, restent vivantes des organisations du collectif, du non individualisé marchand. Non pas par une non-inscription dans l’histoire ou une « stagnation », mais par leurs dynamiques propres et les résistances des populations. Et si les politiques néolibérales de développement décrites par l’auteure au chapitre précédent se heurtent à de si fortes résistances, la raison en est bien ces « communs » (dans leurs dimensions matérielles et idéelles, comme par exemple une cosmologie puissante). Ces phénomènes n’existent pas seulement en Amérique centrale ou du sud. Ces organisations sociales doivent aussi être comprises, loin des étapismes développementalistes, y compris de marxistes) comme des possibles d’émancipation (voir sur ce sujet, Kevin B. Anderson: Marx aux antipodes. Nations, ethnicité et sociétés non occidentales, contre-le-determinisme-prendre-en-compte-les-contradictions-presentes-au-sein-de-chaque-structure-sociale/).
Quoiqu’il en soit, le chapitre sur les résistances indiennes me semble très important. « Les mouvements indigènes en Amérique latine sont particulièrement actifs dans la confrontation de la globalisation et des politiques néolibérales, non seulement par leurs résistances locales contre de grands projets (tourisme, barrage, mines, exploitation des forêts, etc.), mais également par la coordination nationale et internationale de leur lutte pour l’autodétermination » (lire, par exemple, Que tremble la terre jusque dans ses entrailles; José Carlos Mariategui, Alvaro Garcia Linera: Indianisme et paysannerie en Amérique latine. Socialisme et libération nationale, croire-que-le-probleme-indien-est-un-probleme-ethnique-fait-partie-du-plus-vieux-repertoire-des-idees-imperialistes/; les travaux de Jules Falquet ou ceux des féministes chicanas).
Sabine Masson parle de contestation globale, du colonialisme interne aux nations, de remémoration des résistances historiques, des luttes anti-coloniales, de l’EZLN et du Chiapas, du zapatisme et des guérillas paysannes, de la « visibilité inédite des peuples indigènes », de l’exigence de la reconnaissance des inégalités sociales racisées, des mouvements d’autodétermination, des mouvements de femmes indigènes, des alliances possibles sur « la base très concrète de la construction de l’autonomie », de la Loi révolutionnaire des femmes (EZLN janvier 1994), de politisation du « privé », de réappropriation de l’espace productif assigné aux femmes paysannes, des diverses positions politiques des femmes indigènes, de l’articulation de droits individuels et collectifs, de la mise en cause des approches essentialistes et hétéro-normatives de « l’identité ethnique et de la cosmologie indigène », du machisme des hommes de « leurs propres communautés », des violences sexuelles, de lutte intégrale…
En conclusion, Sabine Masson indique, entre autres, « le point zéro de la solidarité passe par la reconnaissance d’une tension dans l’action collective, entre l’éventualité d’un dénominateur commun d’une part, et les divisions qui traversent tout groupe, de l’autre, afin d’amorcer, peut-être, des alliances entre des résistances plurielles et autodéterminées », l’importance du point de vue situé ou d’ »une approche réflexive et décentrée qui localise son discours, nomme sa partialité et sa subjectivité politique », la nécessité de dépasser la posture de l’universalisme abstrait… Il convient de prendre en compte les contradictions « au sein des identités politiques » (habiter la contradiction dirait Geneviève Fraisse), de s’opposer à « l’institutionnalisation d’un certain multiculturalisme libéral et mercantile », de « dire d’où nous parlons »…
« Autrement dit, il s’agit de contextualiser des luttes pour l’autodétermination, dont les symboles et les pratiques de libération se définissent et n’ont pas à être définies de l’extérieur » et de transformer les savoirs féministes…
Le titre de cette note est inspirée d’une phrase de l’auteure dans cette conclusion.
J’ai laissé de coté les vocabulaires choisis. Si l’auteure souligne les sens multiples de certains termes, les utilisation dépolitisantes d’autres, je pense qu’il vaut mieux parler de luttes anti-coloniales et dé-coloniales, de rapports sociaux et de leur imbrication, de luttes de femmes ou des termes utilisés par les principales intéressées.
La notion de blanchité ne me paraît toujours exempte d’essentialisation. Cette blanchité est l’autre face asymétrique des rapports sociaux de racialisation, dont la dimension d’invisibilité, de soit disant neutre référentiel doit être dénoncée comme le fait l’auteure. (En complément possible,Rokhaya Diallo: Racisme mode d’emploi, Le sens que nous donnons à l’ordre que nous créons n’est que pure invention et Maxime Cervulle: Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias, la-blanchite-comme-mensonge-socialement-partage-comme-oeilleres-cousues-de-fil-dor/). Cette blanchité est « traversée » par l’ensemble des autres rapports sociaux, elle ne peut donc être posée là sans contextualisation ou historicisation. Par ailleurs, mais ce n’est pas l’objet du livre, les droits acquis par les « femmes blanches », comme tous les droits acquis – par ailleurs pouvant être remis en question -, l’ont été par des luttes (« reconnaître toutes les femmes dont les luttes concrètes ont été à la base de toutes les théories »), ou dit autrement, arrachés aux systèmes de domination et aux dominants. Ils ne sont pas consubstantiels à une organisation sociale. Tout droit conquis peut servir de référence pour son extension, quelqu’en soit le calendrier ou la forme choisie. En cela il y a bien une dimension universalisante aux luttes et aux droits.
Il s’agit bien de mettre l’accent sur l’auto-organisation des personnes et des groupe sociaux dominés. Et malgré leurs éventuelles instrumentalisations par des tiers (par exemple « homo-nationalisme » – voir Nicolas Tristan: Lutter contre l’homophobie, c’est lutter contre l’impérialisme – pour prendre un exemple de l’auteure), ne pas transiger sur le soutien à leur apporter. Il s’agit bien ici d’un choix politique. Les droits des un-e-s ne peuvent être exclusifs des droits des autres.
Didier Epsztajn, Entre les lignes et les mots, 31 janvier 2017
Dans la revue en ligne Lectures/Liens Socio
Engagée depuis une quinzaine d’années dans la « recherche-action », une pratique participative « tournée vers [la] transformation sociale » (p. 20), Sabine Masson nous propose dans cet essai une approche novatrice sur la manière dont les rapports de force hérités de l’époque coloniale continuent de déterminer des formes de domination, notamment sur les femmes issues de milieux minoritaires (noires, indigènes, chicanas…). Son ouvrage articule, en effet, un travail de terrain mené au Mexique et en Amérique centrale depuis les années 1990 avec ses recherches sociologiques inscrites dans les courants postcoloniaux et du féminisme noir et chicano. Par là même il donne corps et sens à des concepts théoriques (intersectionnalité, colonialité, décolonisation…) que l’auteure a « appris » dans l’action et le dialogue avec des femmes indigènes en lutte1.
Rocío Munguía Aguilar, Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016, mis en ligne le 23 novembre 2016, URL: http://lectures.revues.org/21800.
Notes :
1. Le travail ethnographique et pédagogique (coordination d’ateliers d’alphabétisation) que Masson a entrepris avec la coopérative de femmes tojolabales « Tzome Ixuk », dans l’état de Chiapas (sud du Mexique), a constitué pour elle un espace privilégié pour une meilleure compréhension de l’imbrication d’oppressions et des différentes manières d’y faire face.
2. Soulignons l’importance que l’auteure accorde à la pluralité des féminismes ainsi qu’à la notion de « décolonial » formulée par des militantes féministes latino-américaines dont elle s’inspire et qui s’ancre dans une « perspective de transformation sociale et de connaissance » (p. 78). À son sens, le « décolonial » caractérise mieux le « processus inachevé de décolonisation des rapports sociaux, des pratiques et des représentations » (p. 101), contrairement au terme « postcolonial » avec lequel « la définition d’un ‘après’ est problématique » (p. 86).
3. Kimberlé W. Crenshaw, « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, n° 6, 1991, p. 1241-1299.
4. Masson ne manque pas de rappeler l’implication de la Suisse dans l’entreprise coloniale, pays où les études sur cette question restent marginales.
5. Proposée par le sociologue péruvien Aníbal Quijano, le terme de « colonialité » renvoie à « l’empreinte coloniale » qui continue de dicter les rapports sociaux mais aussi les mentalités (p. 12-13).
6. À propos des travaux pionniers de ces trois critiques, l’auteure renvoie à Mónica Cejas, « Desde la experiencia », Entretien avec Ochy Curiel, Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 8, n° 17, 2011, p. 181-197.
7. Lélia Gonzalez, « Por un feminismo afrolatinoamericano », Isis internacional, n° IX, juin 1988, p. 133-141.
8. La communauté garífuna se situe dans la partie nord-occidentale du littoral atlantique hondurien et se caractérise par la double discrimination qu’ils subissent, se revendiquant afro-descendants et indigènes.