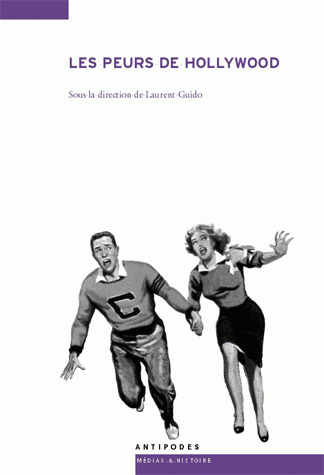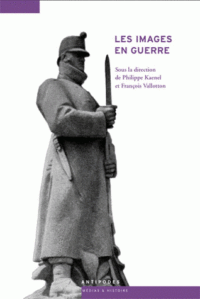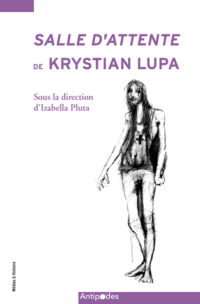Les peurs de Hollywood
EPUISE
Guido, Laurent,
2006, 275 pages, 22 €, ISBN:2-940146-62-4
Les Peurs de Hollywood recueille une série d’études sur les représentations dans le cinéma fantastique américain, associant l’analyse des films à l’histoire culturelle. Son objectif est de porter un regard critique sur la problématique de la peur telle qu’elle apparaît dans les images véhiculées depuis plus de 80 ans par la production hollywoodienne. Dominant les écrans internationaux dès l’entre-deux-guerres, cette cinématographie joue en effet un rôle essentiel dans la constitution des imaginaires culturels à une échelle mondiale, tout en renvoyant à des traditions iconographiques et sociales proprement américaines. Ces dernières années, la part active prise par les États-Unis dans la mise en place d’une culture « globalisée » n’a cessé d’augmenter, rendant nécessaire une réflexion qui puisse aider à comprendre ce phénomène, hors des idées reçues.
Description
CE TITRE EST EPUISE
Les Peurs de Hollywood recueille une série d’études sur les représentations dans le cinéma fantastique américain, associant l’analyse des films à l’histoire culturelle. Son objectif est de porter un regard critique sur la problématique de la peur telle qu’elle apparaît dans les images véhiculées depuis plus de 80 ans par la production hollywoodienne. Dominant les écrans internationaux dès l’entre-deux-guerres, cette cinématographie joue en effet un rôle essentiel dans la constitution des imaginaires culturels à une échelle mondiale, tout en renvoyant à des traditions iconographiques et sociales proprement américaines. Ces dernières années, la part active prise par les États-Unis dans la mise en place d’une culture « globalisée » n’a cessé d’augmenter, rendant nécessaire une réflexion qui puisse aider à comprendre ce phénomène, hors des idées reçues.
L’ouvrage discute d’une part la thèse traditionnelle selon laquelle les figures monstrueuses des films d’horreur ou de science-fiction signaleraient le refoulement de cauchemars collectifs. Il souligne d’autre part l’importance de certains modes de discours exprimant une vision paranoïaque de l’emprise sociale des pouvoirs politiques ou scientifiques, comme la technophobie ou le populisme. De King Kong aux XMen, ce livre considère de nombreux films mettant en scène les mutations physiques, les invasions extraterrestres, les catastrophes, l’univers des cyborgs ou encore les agressions de fantômes ou de morts-vivants.
Table des matières
- Entre « cauchemar » et « paranoïa »: une introduction aux représentaions de la peur dans le cinéma fantastique hollywoodien (Laurent Guido)
- King King: de la Grande Dépression à la regression présymbolique (François Bovier)
- Un nouveau « règne de la terreur »? La voix de L’Homme invisible et les mythes de la dictature radiophonique (Laurent Guido)
- Quand la femme grandit, l’homme rétrécit: la symbolique du corps à géométrie variable dans Attack of the 500 Foot Woman et The Incredible Shrinking Man (Mireille Berton)
- « C’est ce regard-là qui a disparu! » Invasion of the Body Snatchers et l’alteration du même (Richard Bégin)
- Mauvais rêves. George A. Romero, les morts-vivants et le cauchemar américain (Francesco Pitassio)
- « Don’t Panick! »: stratégies de la peur dans les films-catastrophe (François-Xavier Molia)
- The Stepford Wives ou l’enfer conjugal. La peur de l’automatisation des femmes américaines (Rachel Noël)
- Les fantômes de l’Amérique. Le spectre de l’Indien chez John Carpenter et dans le cinéma d’épouvante de la fin des années 70 (Alain Boillat)
- Un vampire peut en cacher un autre (Vincent Verselle)
- Starship Troopers, fin de l’histoire ou fin des idéologies (Sylvestre Meininger)
- Des Machines et des Hommes. D’une peur de la modernité technologique déclinée au féminin (Charles-Antoine Courcoux)
- Mutatis Mutandis: les spectacles du corps paranoïde. Renouveau des agents mutagènes à Hollywood (Dick Tomasovic)
Presse
Cauchemars à l’américaine
Partant du postulat défini par Kracauer à propos du cinéma allemand de l’entre-deux-guerres selon lequel « les films fantastiques reflètent spontanément certaines attitudes symptomatiques du malaise collectif », cet ensemble d’articles, dirigé par Laurent Guido, enseignant en cinéma à l’université de Lausanne, se propose « d’interroger la problématique de l’angoisse sociale telle qu’elle se (re)formule dans le cinéma américain, de ses origines à nos jours ». Programme ambitieux s’il en est. Deux aspects principaux s’en dégagent: la technophobie empreinte de misogynie et la peur de l’Autre sous toutes ses formes.
L’Homme invisible (The Invisible Man) réalisé par James Whale en 1933 est l’une des premières incarnations de l’angoisse générée par le progrès scientifique et technique. Tourné dans les premières années du cinéma sonore, au moment même où la radio devient omniprésente aux États-Unis, ce film met en scène la figure archétypale d’un savant fou, une voix sans corps. Médium acousmatique, la radio y est représentée dans toute l’ambivalence qui la caractérise: outil de communication au service de la démocratie et instrument potentiel de propagande dans les mains d’apprentis dictateurs.
Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le statut de la femme américaine se modifie, on assiste à la combinaison des thèmes liés aux craintes du développement scientifique sur fond de guerre froide à ceux ouvertement misogynes produits par une société patriarcale et puritaine en perte de repères. Enième avatar des films de monstres des années 1950, Attack of the 50 Foot Woman de Nathan Hertz, revisite l’abondante thématique du « corps à géométrie variable ». Le personnage féminin central (riche, névrotique, marié sans enfant) qui figure déjà l’anormalité devient, après un contact radioactif extraterrestre, un être gigantesque semant la terreur sur son passage. « Symbole d’une sexualité libre et gratuite », cette surfemme est vue comme une menace réelle pour la norme que l’ordre patriarcal voudrait imposer.
Dans les années 1960-1970, la seconde vague du féminisme américain s’attaquent aux représentations d’une femme passive pur objet sexuel. En 1975, The Stepford Wives de Bryan Forbes, adaptation du roman d’Ira Levin, prend pour cadre une communauté (idéale?) où les maris tentent de reconquérir leur rôle traditionnel en transformant leurs épouses en robots. Cette vision paranoïaque des mécanismes rétrogrades à l’œuvre dans la société américaine a été revisitée en 2004 par Frank Oz. Le Backlash, mouvement idéologique des années 1980 alléguant le fiasco des idées féministes, est passé par là. Pas étonnant alors que le concepteur de la robotisation se révèle être une femme. Le 21e siècle hollywoodien semble toujours friand du discours associant peur des machines et haine des femmes. Terminator 3 et I, Robot « reconduisent les mécanismes projectifs et la vision paranoïaque d’une masculinité épouvantée à l’idée d’être dépossédée de sa souveraineté » et proposent « une réponse imaginaire à une réalité précise ».
Si la peur de l’autre n’est en rien une forme de représentation spécifiquement américaine, elle adopte néanmoins dans le cinéma hollywoodien des aspects propres à la culture outre-atlantique. En 1956, Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel, met en scène une « communauté consensuelle imaginaire » menacée par l’altération insidieuse de certains de ses membres qui se manifeste par le regard. Ce fantastique « sans monstre » est symptomatique de la désagrégation de valeurs communes à l’origine du rêve américain: la menace est endogène, tout front commun contre l’ennemi est par essence impossible.
Les États-Unis forment aussi « Nation bâtie sur un génocide ». La culpabilité collective originelle transparaît dans la peur de l’Indien qui trouve son expression par exemple dans Fog de John Carpenter où la possession spirituelle par les fantômes n’est que la juste conséquence de la dépossession territoriale dont les Amérindiens ont été victimes. Cette forme d’aliénation se manifeste par « une régression à l’état sauvage » et la « libération de l’agressivité refoulée sous le vernis de la civilisation ». The Amityville Horror ou Shining expriment aussi « cette terreur de se voir posséder par l’Autre […] révélatrice de la mythologie construite autour de l’Indien ».
Ce dernier n’est pas le seul représentant de l’altérité dans la société américaine. Au cours des années 1990, la firme Marvel propose différentes adaptations cinématographiques de ses héros de bande dessinée. Il est intéressant de se rappeler que les X-Men ont fait leur apparition en 1963 après la marche pour les droits civiques et de fait, la problématique raciale y est très explicite. Les mutants sont craints et persécutés car différents, ils sont prêts à se sacrifier pour défendre leurs valeurs.
La crainte a souvent été exploitée par le cinéma hollywoodien pour inviter le spectateur à tirer un enseignement, une leçon de morale. Les films catastrophe peuvent ainsi montrer la « fragilité des entreprises humaines » face aux éléments naturels (Poséidon, La Tour infernale…) tout en étant l’occasion de valoriser le courage individuel et le dépassement de soi, deux thèmes chers à l’imaginaire américain. Quant à la figure du vampire (Entretien avec un vampire, La Reine des damnés) tout en symbolisant le danger de l’Autre et l’emprise sociale d’une élite sur les couches populaires, elle permet de démontrer que la non-adhésion aux normes est porteuse de souffrance et que l’assouvissement des passions est une menace pour la civilisation.
Le large panorama offert par Les peurs d’Hollywood met en évidence que les angoisses d’hier et d’aujourd’hui sont principalement les mêmes. De l’icône King Kong, « film corvéable à merci », que l’on peut interpréter comme le reflet de la Grande Dépression, la figure fantasmatique du Noir ou un monstre freudien, au plus contestable Starship Troopers qui pourrait être l’émanation cinématographique de « la fin de l’histoire » prônée par Fukuyama, une charge contre l’impérialisme américain ou l’expression d’un anarchisme de droite, les films fantastiques hollywoodiens véhiculent des angoisses consubstantielles de l’environnement politique et social où ils ont vu le jour. Le spectateur européen trouvera ici sans nul doute matière à réflexion sur ce qui caractérise ses propres peurs ou sur la contamination de son imaginaire par des thématiques endogènes.
Emmanuelle Romeyer, critikat.com, automne 2006
Pas de panique!
Dossier cinéma, par Nicole Duparc
Avec Laurent Guido, auteur du livre et enseignant en cinéma à l’Université de Lausanne et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Alain Boillat, maître assistant à la section Histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne et fondateur de la revue Décadrages et Mireille Berton, assistante diplômée à la section d’Histoire et esthétique du cinéma.
Radio suisse romande – Espace 2, Dare-dare, 13 septembre 2006
Les monstres bavards de Hollywood
Les films fantastiques, des révélateurs sociaux? L’idée est souvent admise. La thèse remonte à certaines analyses des oeuvres expressionnistes allemandes, Mabuse ou Caligari, qui auraient reflété le malaise collectif ayant conduit à la catastrophe nazie. Les monstres, quels qu’ils soient, exprimeraient les peurs d’une époque, voire préfigureraient leurs conséquences.
Cette idée sert de point de départ à un ouvrage collectif stimulant dirigé par Laurent Guido, qui enseigne le cinéma à l’Université de Lausanne et à l’EPFL. Abordant tour à tour les registres du fantastique, de la science-fiction (SF) ou du film catastrophe, Les Peurs de Hollywood détaille le sens de la monstruosité dans le cinéma hollywoodien. Des significations forcément multiples, tant les films émanent d’une industrie chaotique: « Il est de plus en plus vain d’appréhender Hollywood comme un ensemble homogène, en particulier si l’on se replace dans la perspective d’une analyse des modes de discours qui le traversent », prévient Laurent Guido.
Pour évoquer l’ancrage social de certaines oeuvres, ce dernier convoque ainsi L’Homme invisible, de James Whale (1933). Il met en relief le lien entre le personnage principal et la figure du savant fou. Surtout, alors que le cinéma parlant est encore jeune, l’auteur replace le film dans le contexte de la montée en puissance du media radiophonique. Après tout, l’homme invisible est une voix. Or, sur fond d’instrumentalisation de la radio comme vecteur publicitaire, puis au service des idéologies fascistes, L’Homme invisible exprimerait ainsi une « méfiance profonde à l’égard des nouvelles techniques de communication » qui s’accorde « à la vision paranoïaque d’une prise de pouvoir autocratique »-le savant fou.
Dans un autre article, François Bovier, de l’Université de Lausanne, se penche sur le premier King Kong, de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack (1933, aussi). Il montre en quoi le film propose, parmi ses innombrables lectures possibles-du surréalisme à la psychanalyse-une mise en cause du spectacle marchand. « Le rapport à l’attraction est au centre du fil », dit l’auteur, King Kong formant « un retour du refoulé du capitalisme » en mettant en scène un « monde prélogique », au-delà, ou en deça, de la parole.
Le film fantastique est aussi souvent décrit comme puritain, puisqu’il tend vers le rétablissement de l’ordre après la crise provoquée par le monstre. Également à l’Université de Lausanne, Mireille Berton écorche un peu ce cliché en revoyant Attack of the 50 foot Woman (Nathan Herz, 1958), dans laquelle une femme, au demeurant riche et délaissée par son mari, devient immense à la suite du contact avec un extraterrestre et ses émissions radioactives. On a souvent glosé sur la paranoïa anticommuniste et la phallocratie de ces fictions des années 1950. L’auteure soutient qu’une telle série B est plus complexe qu’il n’y paraît, car elle véhicule « une image ambivalente des rapports de sexe, se faisant ainsi l’écho d’une déstabilisation systématique des notions de féminité et de masculinité après la Seconde Guerre mondiale ».
Le masculin bousculé, Charles-Antoine Courcoux, doctorant en histoire du cinéma à Zurich, le voit aussi dans des films de SF tels que I, Robot, Matrix ou Terminator 3. Ceux-ci reflètent une technophobie associée à une peur, ou une méfiance, de la figure féminine, souvent associée à la machine, robot, ordinateur ou matrice. De fait, ils expriment une crainte « moins liée à une peur de la modernité technologique qu’à celle des changements qu’elle peut engendrer, notamment dans le cadre des rapports sociaux de sexes. »
Le sommet de la richesse des significations-ou du cynisme des cinéastes-semble atteint par Starship Troopers, histoire d’une lutte contre d’affreuses sauterelles dans un futur dictatorial. Décrit à sa sortie comme un brûlot fascisant, ou au contraire une formidable ironie post-première Guerre du Golfe, le film « s’adresse à des publics si différents qu’ils devraient s’exclure mutuellement », relève Sylvestre Meininger, qui a enseigné à l’Université de Rennes 2.
Mi-horrifié, mi-fasciné, il note que le réalisateur Paul Verhoeven « méprise la culture de masse, mais utilise ses pires conventions ». Liant le film à la théorie de la fin de l’histoire et à la « disparition du réel » selon Jean Baudrillard, l’auteur fait de Starship Troopers une sorte de manifeste postmoderne « prisonnier de contradictions insolubles ». Les Peurs de Hollywood sont vraiment de toutes natures, comme le prouve cette étude collective.
Nicolas Dufour, Le Temps, 30 septembre 2006.
Chaque nouveau film d’épouvante invite à s’interroger: quelle peur sociale, ou politique, voire spirituelle reflète-t-il? L’hypothèse est en effet séduisante: tant les monstres envahisseurs que les morts (-vivants) ou telle créature issus de quelque dérapage de laboratoire scientifique (avec le savant fou comme « maître du monde »), qu’ils appartiennent au genre fantastique ou science-fiction, tous exprimeraient, plus ou moins explicitement, les craintes d’une époque et les angoisses intérieures de ses contemporains, jusqu’à susciter autant le dégoût que la fascination.
Mais-et c’est tout l’intérêt de ce recueil d’articles-l’ensemble n’est pas homogène et bien plus riche que supposé. A l’immense variété de films produits par le cinéma fantastique américain correspondent en effet des lectures socio-politiques du monde très différentes que révèlent fort bien l’ensemble des auteurs réunis autour de Laurent Guido, qui enseigne le cinéma à l’Université de Lausanne et à l’EPFL. Ainsi, du King Kong de 1933 aux récents X-Men, les productions d’Hollywood attestent que les peurs d’hier sont analogues à celles d’aujourd’hui: l’autre génère l’angoisse au point que, comme le relève Dick Tomasovic, « la hantise d’un pays construit sur l’anéantissement de l’autre, sur le génocide indien (une espèce en remplaçant une autre) est inlassablement et paradoxalement reformulée et métaphorisée dans des produits de divertissement ».
Les fines analyses de King Kong (1933), L’Homme invisible (1933), Attack of the 50 foot woman (1958), The invasion of the body snatchers (1956), La nuit des morts-vivants (1968) ou de films-catastrophe comme L’Aventure du Poséidon (1972) ou La Tour infernale (1974), qui s’offrent en réalité come des films-purge des maux de société, appellent finalement à ne pas considérer comme un genre mineur le film jouant avec les peurs collectives ou les angoisses individuelles. Au contraire, à l’inverse d’un scénario qui parfois prête à sourire, le miroir de la société qu’il tend au spectateur renvoie parfois une image d’une grande complexité.
Serge Molla, Ciné-feuilles no 534, Octobre 2006.
Quand l’Empire est attaqué…
Les peurs de Hollywood, tel est le titre du recueil de textes paru aux éditions Antipodes, et qui nous propose de revisiter certains classiques du cinéma d’horreur, de science-fiction ainsi que du « cinéma-catastrophe » américains.
L’ouvrage engage une relecture de ces œuvres qui va bien au-delà de la critique artistique, et plonge le lecteur dans une analyse de la société américaine, de ses peurs ou phobies les plus profondes, des personnages ou événements qui génèrent ces craintes, et la manière dont ceux-ci sont mis en scène. Percevoir ce qui faisait peur aux américains à une époque donnée, pour comprendre mieux l’histoire récente des Etats-Unis, tel est l’objectif audacieux des auteurs. Et ce cadre d’analyse n’est pas dénué d’intérêt en regard de la période actuelle…
L’étude s’attache à démontrer comment l’émancipation féminine, les luttes des classes défavorisées, l’immigration, la guerre froide etc… sont, de manière subtile, au cœur même de nombreuses œuvres du cinéma fantastique américain. D’œuvres de « cautionnement » de certaines décisions politiques par exemple, ou d’avertissement contre d’éventuelles dérives de la société américaine et de ses valeurs traditionnelles, on passe à des travaux plus subversifs, dénonçant en finesse l’ordre établi, fustigeant les répressions, prenant la « défense » des opprimés.
Morceaux choisis
Ainsi, on apprend comment King Kong (1933) montre les conséquences désastreuses du capitalisme, et de la « Grande Dépression »: Kong est donc « l’Américain traditionnel, épris d’une liberté sans freins, et qu’il s’agissait de mettre à la raison ». Ce film pose également une analogie entre la loi de la jungle et la logique du capitalisme, avec des espaces qu’il parcourt de la même manière (montagnes et buildings), des adversaires qui l’attaquent de la même manière (ptérodactyles et avions). Il évoque également une série de questions intéressantes sur le rapport à l’ « autre » et la relation homme-femme.
La question de l' »autre », du différent est encore à l’honneur dans The attack of the 50 feet woman (1958), dans lequel une femme exposée à des rayons extraterrestres atteint une taille stratosphérique et détruit tout sur son passage. L’analyse croisée de ce film et du long-métrage The incredible shrinking man (l’homme qui rétrécit, 1957) met en lumière les rapports de genre, et la menace que représente la progressive émancipation féminine des années cinquante pour le mâle dominant et sa société patriarcale, qui voit ses privilèges « rétrécir ». Des rapports de genre également décortiqués au travers de Stepford Wives (1974), une fiction où les femmes d’une bourgade se transforment en robots-ménagers…
Le cinéma « gore » est aussi passé au peigne fin, et il est toujours agréable de se rappeler le génie de films comme la quadrilogie des « morts-vivants » de G. Romero. Dans le même style, une mention particulière pour Massacre à la tronçonneuse (1974), dont il est question dans l’introduction à l’ouvrage, et dans lequel « l’aliénation tayloriste des ouvriers y est effectivement présentée comme source d’une monstruosité exclusivement masculine, envisageant la sexualité sous l’angle de la perversion sadique ».
Sans peur, mais…
Le panel de films choisis est extrêmement vaste, et cet aperçu n’en est qu’un maigre échantillon. Le connaisseur averti de ce type de production redécouvre avec plaisir ces œuvres, alors que le profane, peut-être même réticent à ce genre cinématographique, apprend à considérer ces films comme autre chose qu’un simple bain de sang ou débauche d’effets spéciaux, plus ou moins réussis selon les époques d’ailleurs…
Toutefois, il est franchement regrettable que le langage utilisé, soit par trop « académique », voire « scientifique », renvoyant le lecteur à des concepts sociologiques, artistiques ou méthodologiques que chacun-e n’aura pas la capacité de cerner. Et cette idée qu’il faille à tout prix posséder une maîtrise universitaire pour avoir le privilège de se documenter sur des films fantastiques est regrettable.
Cela dit, la curiosité que suscite cette étude permet de passer outre ce malaise. A lire donc, sans peur.
Maurizio Colella, Pages de gauche no 49
Le cinéma est bigger than life, il nous narre les histoires hors normes de personnages eux aussi hors norme. La réalité est incontrôlable. Elle ne connaît pas de happy end, pas de personnages adjuvants salutaires, pas de retounements de situations inespérés. Il semble donc que fiction et réalité, cinéma et monde, ne doivent pas être confondus. Plutôt que de considérer les deux univers comme étanches,certains présupposent cependant que le cinéma représente la société qui l’a engendré. C’est la thèse défendue par Laurent Guido et les auteurs qui collaborent à son ouvrage. Ce genre de postulat n’est pas neuf. Siegfried Kracauer (De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand, trad. de l’anglais par CI. B. Levenson, Lausanne: L’Âge d’Homme, 1947[ 1973]) a ouvert le champ de recherche en 1947 en analysant les films allemands de l’époque de Weimar et en démontrant qu’ils annonçaient la montée du nazisme. Laurent Guido s’inscrit explicitement dans cette veine, tentant de dégager la manière dont les films américains mettent en scène l’angoisse sociale. Les textes s’intéressent plus particulièrement au cinéma d’horreur, de science-fiction ou au film catastrophe, « des genres qui thématisent, voire problématisent la question de la peur » (p.8).
Robin Wood, cité dans l’introduction, désigne le cinéma d’horreur comme un « cauchemar collectif » (p.9). Dans cette vision, le cinéma (et la fiction en général) fonctionne comme le rêve: il puise dans le réservoir des peurs plus ou moins conscientes pour les incamer dans le phénomène effrayant. L’adulte qui va au cinéma posera donc un acte proche de celui de l’enfant qui élabore ses jeux autour des situations qui l’effraient afin de contrôler son angoisse. La menace a pris des visages différents selon les temps: savants fous, extraterrestres, monstres, menace nucléaire, désordres mentaux, satanisme, cannibalisme, catastrophes, technologies incontrôlables…
Les auteurs explorent chacun des thèmes (fantômes, vampires, robots…), des films (King Kong, La nuit des morts vivants, La tour infernale, X-Men) de périodes très différentes. Il n’est donc pas aisé de tirer un enseignement global de la lecture de cet ouvrage. Pourtant l’on ne peut manquer d’être frappé par la récurrence de certaines idées. La plupart des contributions démontrent que ce qui est mis en scène est principalement la peur de l’Autre. C’est finalement assez commun. Michaël Rogin a établi un parallèle entre cette tendance lourde du cinéma et de la politique américaine qui « consiste à diaboliser ses adversaires, que ce sort en les caricaturant, en les stigmatisant, ou encore en les déshumanisant » (cité dans l’introduction, p.16). Mais l’Autre symbolisé par le cinéma d’horreur provient finalement moins de l’extérieur (de l’Union soviétique, du cosmos) que de l’intérieur. Finalement, et nous en revenons ici aux théories de Robin Wood (Hollywood from Vietnam to Reagan, New York: Columbia University Press, 1986), l’Autre est tout ce qui ne cadre pas avec la nomne. Or, selon le cinéma hollywoodien, la norme est définie par un univers bourgeois, capitaliste, patriarcal et hétérosexuel: « Selon ce point de vue les femmes, les ouvriers, les étrangers, tout comme celles et ceux qui adhèrent à des idées politiques contestataires ou appartiennent à des minorités ethniques ou sociales, pourraient ainsi être représentés sous les traits de figures monstrueuses suscitant l’effroi des protagonistes et, via divers processus d’identification ou de mise à distance, l’intérêt des spectateurs des films d’horreur » (p.9).
Très vite, on se rend compte que les films d’horreur se concentrent sur quelques peurs majoritaires: l’Indien (traduisant la mauvaise conscience face au génocide), la technologie et les processus de déshumanisation qu’elle induit (ce qui est paradoxal puisque le cinéma, notamment fantastique, emploie de plus en plus les effets spéciaux) et la femme. Dans Attack of the 50 Foot Woman (Nathan Juran, 1958), La femme doit être contrôlée en raison du danger castrateur qu’elle représente parce qu’elle refuse sa position sociale et qu’elle dépasse l’homme (au sens propre comme figuré dans le cas de ce film). La femme dort être changée en robot, automatisée parce qu’elle est indépendante dans The Stepford Wives (Bryan Forbes, 1975). King Kong (Merian C. Cooper, Emest B. Schaodsack, 1933) perd de sa superbe machiste quand il est enchaîné sur scène comme la femme était attachée sur l’autel du sacrifice. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si le cinéma d’épouvante connaît un âge d’or au moment où se développent les mouvements féminins. C’est d’ailleurs à la fin des années 70 que se développeront les films les plus sanglants (le gore, le slaptick). Mais la femme vue comme une menace est toujours d’actualité au début du XXIe siècle. Dans I Robot (Alex Proyas, 2004), l’ennemi est Viki, un ordinateur surpuissant caractérisé comme féminin. Dans Terminator III (Jonathan Mostow, 2003), T-X a l’apparence d’une belle blonde. Si Alien (Ridley Scott, 1979) met en scène une héroïne, garante du bien et de la survie de l’humanité, il faut admettre qu’elle est très masculine et, surtout, qu’elle s’oppose à une « super méchante » qui est d’ailleurs résumable à une « super matrice ».
La question qui surgit inévitablement à la lecture du livre est: « Le cinéma d’horreur n’évolue-t-il pas? ». Les auteurs font référence à des époques différentes, à des sous-genres variés, à des thématiques diverses, mais on a cependant l’impression de toujours lire les mêmes constats. Le cinéma américain raconte-t-il fondamentalement la même chose depuis un siècle à savoir que les hommes ont peur d’être castrés par les femmes? Le corpus étant aussi étendu, ne devrait-on pas y déceler des variations, ne fut-ce que subtiles? Si l’ouvrage offre bien une analyse minutieuse, texte par texte, il manque peut-être une exploration plus approfondie de cette impression de statu quo. Finalement, l’ouvrage souffre d’un défaut qu’ont souvent les recueils d’articles, il manque d’une conclusion qui se dégage de l’ensemble. Si l’introduction est un texte riche, elle ne parvient pas à pallier cette carence.
Sarah Sepulchre ORM, université catholique de Louvain-la-Neuve, Questions de communication