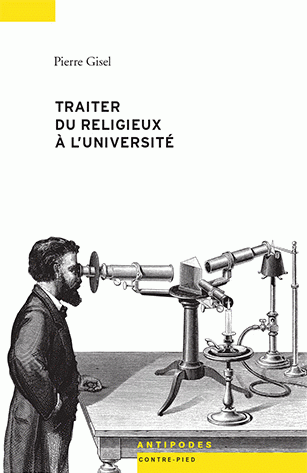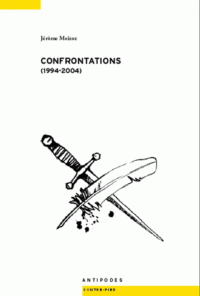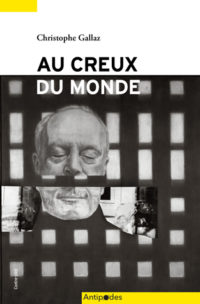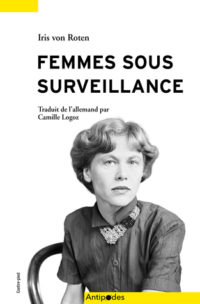Traiter du religieux à l’Université
Une dispute socialement révélatrice
Gisel, Pierre,
2011, 174 pages, 18 €, ISBN:978-2-88901-068-4
Traiter du religieux à l’Université; le gérer en société contemporaine: deux registres différents, mais mêmes changements, et mêmes difficultés. Cet ouvrage raconte, pris sur le vif, des événements qui ont durement occupé l’Université de Lausanne. Il tente d’y saisir des déplacements et d’en expliciter des enjeux, et ouvre ainsi plus largement, le débat sur l’enseignement du religieux à l’Université.
Description
Traiter du religieux à l’Université; le gérer en société contemporaine: deux registres différents, mais mêmes changements, et mêmes difficultés.
Cette question est relancée par l’éclatement du religieux: pluralité de traditions (christianisme, islam, bouddhisme), avec leurs modifications internes, fondamentalistes ou libérales, et les nouvelles formes de leurs positionnements sociaux; mouvements religieux récents (scientologie, Ordre du Temple solaire, raëliens); religieux « diffus », visant équilibres de vie, voire spiritualités sans Dieu, dont on ne sait plus s’ils sont ou non religieux.
Le religieux est pris ici comme « scène », symptomatique, où les questions ne sont pas réductibles à des différences de conviction, ni à l’opposition entre compréhension interne et neutralité; pas non plus entre théologies et sciences des religions. Or, c’est ainsi que tout le monde le voit spontanément. Mais c’est une dimension à ne pas évacuer, en rester là empêche de voir des des mutations et des enjeux plus profonds qui traversent les savoirs (sciences sociales, anthropologie, histoire) comme la société: son présent, ce qui s’y montre et ce qui y est dénié, des boucs émissaires trop vites identifiés, des processus inaperçus.
Le livre raconte, pris sur le vif, des événements qui ont durement occupé l’Université de Lausanne. Il tente d’y saisir des déplacements et d’en expliciter des enjeux, et ouvre ainsi plus largement, le débat sur l’enseignement du religieux à l’Université.
Presse
Dans la revue Études théologiques et religieuses
Voici un document rare, un traité à la croisée de l’analyse institutionnelle et de la critique épistémologique de la manière d’enseigner le religieux à l’Université. Il part de l’analyse d’une crise qui secoua la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne en 2007-2008. L’auteur en fut un acteur majeur et expose à la fois les éléments du dossier et la démarche d’objectivation réflexive qu’il porte afin de saisir toutes les dimensions d’une interrogation féconde. Il retrace l’origine de la réorganisation de la Faculté (protestante) de théologie due à deux faits majeurs des années 1990: la chute considérable du nombre d’étudiants inscrits dans la discipline et la demande croissante de la part d’autres facultés d’un enseignement auxiliaire en sciences des religions, faisant de la Faculté de théologie un prestataire de services plus qu’un centre de formation de spécialistes. Ceci amena à reconsidérer au sein de l’institution le rapport de forces entre enseignants de disciplines théologiques et enseignants de sciences des religions qui s’intensifia avec la création de nouveaux postes dans le cadre de la mise en réseau de compétences complémentaires des trois Facultés romandes de théologie (Lausanne, Neuchâtel et Genève). À Lausanne, devenu pôle d’excellence en sciences des religions, ce redéploiement introduisit une tension entre héritiers d’une faculté implicitement confessionnelle et enseignants nouveaux venus, extérieurs à l’éthos de référence. Ces derniers commencèrent à exiger la déconfessionnalisation de l’institution en réseau, la moitié du Conseil de fondation à Genève étant constitué de délégués de l’Église nationale protestante. Le conflit s’inscrivit dans une revendication de laïcisation des institutions universitaires d’enseignement consacrées à l’objet religieux, afin que puisse éclore une recherche débarrassée de toute suspicion d’allégeance à une tradition religieuse spécifique.
En même temps, Pierre Gisel poussa à la reformulation des fondements épistémologiques de l’enseignement jusque-là consacré principalement au champ d’étude des christianismes qui en distribuait les savoirs disciplinaires. Il plaida pour une recherche articulée à ce qu’il appelle, faute de mieux, « la scène religieuse », désignant par là « un lieu où une pluralité de réalités et d’acteurs vient se dire et où se font voir des réalités sociales et anthropologiques » plus larges, sans exclusive (p. 31). Dès lors, tout en admettant la diversité des modèles de formation et d’enseignement dans ce champ, il devint prioritaire à Lausanne de défendre un enseignement universitaire abordant « toutes les constructions sociales et discursives » ayant pour moteur le religieux « en dehors de la conscience de leurs agents » (p. 49). Il en découla un conflit ouvert; les théologiens allèrent jusqu’à voter la destitution de l’auteur de la présidence de la section théologie de la Faculté et sa chaire de « dogmatique et théologie fondamentale », rebaptisée chaire d' »histoire des théologies, des institutions et des imaginaires chrétiens », fut rattachée à la section sciences des religions. La division du travail se déclina dès lors en deux unités de recherches indépendantes, éventuellement articulées.
Sans pouvoir rendre compte ici de la densité du processus et de l’analyse du projet, il convient encore de souligner l’enjeu ultime de la démarche soutenue. Contre la dérive de la compartimentation des savoirs et des champs réduisant la recherche au cumul de travaux limités, Pierre Gisel revendique au contraire une mise en jeu réflexive de l’ensemble des disciplines traitant de la scène religieuse, en restituant à la systématique (devenue « problématologie ») la tâche « d’ouvrir un pensé renouvelé et assumé comme tel par-delà de seules connaissances descriptives » (p. 163). Se profile ainsi l’enjeu de la reprise du rapport transcendance-subjectivité dans un enseignement à même d’interroger, par l’étude de la généalogie de la scène religieuse, la question du sens du religieux dans une société sécularisée où le christianisme a perdu tout monopole. En d’autres termes, pour l’auteur, une généalogie non linéaire cherchant à faire voir les réalités anthropologiques du religieux appelle une problématologie de « ce qui pour l’humain est en excès » (p. 167). Il y a là une tentative prometteuse d’ouvrir « une orientation constructiviste non essentialiste » (p. 119) er de saisir la nécessaire interdisciplinarité de la connaissance en matière religieuse. Une initiative qui fait de ce livre un instrument de réflexion incontournable pour tous ceux qui veulent penser la place et la finalité à l’Université de l’enseignement religieux et de la recherche qui lui est liée.
Jean-Pierre Bastian, Études théologiques et religieuses, 2015/1, pp. 138-140
et dans Revue d’histoire et de Philosophie Religieuses, Tome 95, No 1, 2015, pp. 113-114.
Dans la revue Studies in Religion / Sciences Religieuses
Ce petit ouvrage tient à la fois du journal personnel, de la chronique institutionnelle et du manifeste académique sur les tâches émergentes de la théologie et des sciences des religions. Il suit à la trace les événements et les débats qui, en 2007 et en 2008, ont agité et déchiré les milieux universitaires de théologie protestante de la Suisse romande.
Pierre Gisel a entrepris de relater, parfois avec plus de détails qu’il n’en faudrait vraiment, les faits et dits entourant le projet de restructuration des facultés de théologie protestante de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Le récit rappelle les percées de Lausanne en sciences des religions, des percées conformes à ce que l’auteur en a exposé plus longuement et plus systématiquement dans des ouvrages récents. On ne simplifiera sans doute pas exagérément les choses en disant d’emblée que la Faculté de théologie et de Sciences des religions de Lausanne, qui s’était progressivement affirmée en sciences des religions, largement sous l’inspiration de Gisel lui-même, considérait qu’elle avait beaucoup à perdre dans la nouvelle « fédération » promue par la direction de l’université et impliquant les facultés de Genève et de Neuchâtel: ne risquait-elle pas d’y être happée et mise en minorité par les perspectives théologiques de Genève et, dans une moindre mesure, par celles de la théologie pratique développée à Neuchâtel?
Les tenants des sciences des religions, Gisel en tête, souhaitaient plutôt pour Lausanne un engagement non confessionnel qui aurait étudié le Christianisme comme un des acteurs de la « scène religieuse », selon l’appellation retenue pour désigner le vaste terrain de la vie sociale où interviennent, parmi et avec d’autres mouvements de convictions, les diverses traditions religieuses. Leur projet sera très vite perçu comme une opération conduisant au repli et à la relativisation du Christianisme, voire à un éloignement de la théologie universitaire, déjà jugée « dangereuse » par certains protagonistes, par rapport aux communautés croyantes désireuses de maintenir des liens confessionnels entre elles et « leurs » facultés de théologie, notamment en vue d’assurer la formation des pasteurs. Ni les croyants « ordinaires », ni les théologiens « traditionnels », pour qui la théologie est essentiellement « positionnelle » et articulée à une communauté de foi, ne se reconnaissaient dans cette innovation. D’un investissement en sciences des religions déployé – sans trop d’oppositions, d’ailleurs – à l’intérieur d’une faculté de théologie et des sciences des religions, les adversaires estimaient qu’on passerait à une absorption des études théologiques dans une mouvance qui, bien qu’intelligente et solidement étayée, n’allouerait que sa portion congrue à l’étude du Christianisme. Là où Gisel et ses partisans voyaient un « déplacement » opportun et nécessaire, d’autres, à l’intérieur comme à l’extérieur de la faculté et de l’université, estimaient détecter une « rupture » aussi aventureuse qu’inacceptable.
Le « déplacement » préconisé, l’ouvrage de Gisel a le mérite de le camper succinctement et nettement, en citant notamment des textes de rapports ou de manifestes éclairants difficilement accessibles autrement; le sixième et dernier chapitre y est aussi consacré. L’ensemble du propos illustre fort bien ce qui, en théologie, est peut-être irréductible, c’est-à-dire son lien à une foi particulière et sa posture confessionnelle ou, à tout le moins, « convictionnelle » – ce qui, il est vrai, ne nous change guère des sciences humaines « engagées » qui foisonnent. Le projet avorté voulait adopter d’emblée une autre posture: étudier le Christianisme comme contributeur « objectivable » et « comparable » sur une scène où, elles-mêmes « symptomatiques » d’enjeux liés à l’existence humaine, s’expriment des réalités sociales et anthropologiques qui le dépassent et l’englobent.
Par-delà les malentendus, les suspicions, voire les « coups bas » dont les milieux institutionnels semblent avoir le secret, deux approches et deux lignes d’argumentation se dessinent et parcourent le débat et son récit. D’un côté, la formulation « scientifique » de considérations historiques, épistémologiques et théoriques qui s’attaquent de front au fossé grandissant observé entre la pratique théologique et les exigences de la nouvelle « scène religieuse » de nos sociétés sécularisées. De l’autre, la levée d’une coalition d’opinion – collègues, administrations, églises, média – soucieuse de ne pas trop bousculer une pratique théologique familière et de maintenir un lien fonctionnel et opérant avec la communauté croyante protestante. Entre ces deux discours et ces deux projets, le courant n’est manifestement pas passé et les « conversions » ne se sont pas faites. D’où la crise racontée.
Ce n’est pas juger les choses de loin et de haut que de voir un peu de naïveté et de candeur politiques – praxéologiques, à tout le moins – à penser ainsi que des arguments principiels et théoriques pourraient réussir à inverser la trajectoire des traditions théologiques, des conforts institutionnels et des intérêts communautaires. Cela eût été évident en milieu catholique, où les facultés de théologie – celles de la Francophonie outre-atlantique, par exemple – ont parfois réussi à changer leur nom – au fait, comme Lausanne l’a fait en 2006 – et à s’engager à pas feutrés en sciences des religions, mais sans que ne soit touchés l’ombre d’un iota de leur statut « canonique » et encore moins l’exercice des pouvoirs des autorités ecclésiastiques, notamment quant à l’orthodoxie doctrinale et quant à la nomination et à la titularisation des professeurs. À la faculté « concordataire » de Fribourg, un tel débat aurait d’ailleurs été difficilement pensable – en tout cas, il aurait duré moins longtemps! Le récit de ce qui s’est passé à Lausanne enseigne à tout le moins que, même notablement moins direct et plus poreux, le contrôle des églises protestantes suisses sur les facultés de théologie n’en est pas moins contraignant: les attentes des communautés croyantes, les pratiques universitaires, l’opinion publique et même l’accès aux bénéfices d’une fondation – celle de Genève, en l’occurrence – opèrent parfois aussi efficacement que les protections juridiques à la romaine.
À la Faculté de théologie et de Sciences des religions de Lausanne, on a finalement fait contre mauvaise fortune bon coeur et on continuera, en « partenariat » souhaité avec les deux autres facultés de théologie et avec d’autres pôles d’études sur le fait religieux, à y développer les sciences des religions au sein d’une faculté où la théologie demeure un vecteur institutionnel important. Au vu de la fécondité des acquis, il faut d’ailleurs souhaiter la poursuite de ces engagements en sciences des religions. En tout cas, au-delà de l’échec essuyé, le débat aura permis d’expliciter les enjeux et les perspectives, ce qui n’est pas rien, même si l’évocation finale d’une « panne », d’une « crise » et d’une « sectarisation » « historiques » du Christianisme a quelque chose de l’effet de toge.
Le lecteur est amené à constater que, à Lausanne comme ailleurs, le déploiement d’un arsenal théorique suffit rarement à faire oeuvre nouvelle et à vaincre les résistances. Il se pourrait même que les pouvoirs établis ne comprennent guère autre chose que le langage des « ruptures » portées sur le terrain réel par des forces culturelles, sociales et politiques irrépressibles, et non sur celui des principes et des « déplacements » purement épistémologiques. Il en faudrait décidément beaucoup plus pour ébranler les colonnes du temple et pour changer les mouvements d’eaux du Lac Léman. À cet égard, le récit de Gisel, lourd de vérité et souvent touchant de sincérité et de transparence, a bien des traits de la « chronique d’une fin annoncée ».
Pierre Lucier, Studies in Religion / Sciences Religieuses, No. 43-1, 2014, pp. 195-197.
Dans le Bulletin Bibliographique de la revue Archives de sciences sociales des religions
Il arrive encore dans la vieille Europe sécularisée que la grande presse s’intéresse à ce qui reste de l’ancien conflit des facultés entre théologie et philosophie. Ce fut le cas en Suisse romande dans les années 2007-2008 quand un projet de réorganisation de l’enseignement conjoint de la théologie dans les facultés de Lausanne, de Genève et de Neuchâtel suscita une dispute universitaire mémorable. Pierre Gisel, professeur de théologie protestante connu pour ses thèses libérales et principal acteur des événements, nous livre ici une chronique de cet épisode mouvementé. Un témoignage de première main à la fois documenté, réflexif et engagé sur un conflit académique local dont les lignes de force et de fuite dépassent le seul cas suisse.
Rappelons quelques chiffres pour planter le décor: à la fin des années 1970, la faculté de théologie de Lausanne accueillait chaque année près d’une vingtaine d’étudiants dans une petite unité logée au sein d’une université multidisciplinaire de quatre milles inscrits; vingt ans plus tard, elle en devient encore plus minuscule en n’accueillant qu’une dizaine d’étudiants au mieux dans une université dont les effectifs ont triplé. Les facultés protestantes de théologie forment depuis l’origine ses étudiants à la profession de pasteur en délivrant une solide formation biblique dans les langues sources et en inculquant la maîtrise de la doctrine et de la mission chrétiennes. Mais la crise des vocations pastorales étonnamment concomitante de la résurgence des questions religieuses dans le monde infléchit depuis quelques années la demande de formation universitaire dans le sens des sciences humaines. Celles-ci prennent le fait religieux comme un phénomène observable et objectif n’engageant plus nécessairement le sujet de la connaissance de façon existentielle. Dans ce contexte, l’impératif gestionnaire d’adaptation des moyens aux missions universitaires nouvelles est à Lausanne comme ailleurs à l’origine de réformes récurrentes. Il en fut ainsi du transfert des sciences exactes (physique, chimie, mathématiques) à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et du renforcement en retour de l’université en matière de sciences criminelles, de biotechnologies médicales ou de sciences de l’environnement. L’économie de moyens dans le « Triangle Azur » (universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel) rapproche également les filières d’enseignement de la théologie selon des conventions entre facultés qui ne tardent pas à faire ressortir les spécialités respectives. Lausanne apparaît ainsi pilote en matière d’ouverture ou d’association de la théologie aux sciences des religions fondées sur l’histoire, la sociologie et l’anthropologie. Regroupement scientifique autour d’un objet commun qui ne cesse de se développer à la marge des universités littéraires d’Europe depuis le XIXe siècle. La section de « sciences religieuses » de l’École pratique des hautes études en France en fournit ainsi un exemple d’érudition et de souci comparatiste entre les multiples traditions spirituelles du monde.
La chronique lausannoise commence par le rappel des étapes de cette association locale entre théologie et sciences des religions, notamment l’appellation officielle de « Faculté de théologie et de sciences des religions » en 2006 après plusieurs années de négociations au sein du corps enseignant. Une faculté qui fait cohabiter en clair trois sections: les sciences bibliques, les sciences des religions et un observatoire sociologique de la modernité religieuse. Les choses se tendent un an plus tard lorsque le rectorat épris de rigueur budgétaire échafaude des scénarios divers où la théologie se trouve regroupée à Genève et les sciences des religions à Lausanne ou bien ces dernières placées sous la dépendance théologique du Triangle Azur. Notre auteur, alors professeur de théologie à Lausanne, saisit là l’occasion pour engager un débat sur le fond de ce que peut être un enseignement de la théologie chrétienne au temps des sciences des religions renaissantes et du dialogue progressif entre traditions croyantes du monde globalisé. Il avance l’idée de « scène religieuse » comme objet de connaissance se référant à une pluralité d’énoncés et d’acteurs. Sur cette scène, la théologie ne figure plus comme discipline rectrice du rapport avec l’ultime, mais comme tradition de pensée dont les contours et les développements suivent le cours particulier de la civilisation occidentale. Cette dernière, de sources gréco-judéo-romano-chrétiennes, a précisément inventé le mot « religion » à la différence d’autres cadres de pensée qui ne l’ont pas toujours distingué. Poser la scène religieuse comme objet justiciable d’une approche généalogique attentive autant aux ruptures qu’aux continuités conduit à remettre en question les catégories héritées, telles que les oppositions dualistes entre science et théologie, sacré et profane, tradition et modernité. La distinction monothéiste entre une transcendance unitaire et une immanence plurielle se trouve ainsi déconstruite en chaos conjuré pour le judaïsme, en mystère habité pour le christianisme ou en illusion révoquée pour l’athéisme, « vie nue » (Giorgio Agamben) livrée aux « biopouvoirs » (Michel Foucault). Pour Gisel, « l’humain » en sa propension à la symbolisation absolue de l’être au monde s’avère plus que le divin l’horizon d’attente actuel de l’intelligence de la foi. Telle hypothèse ne va pas, on s’en doute, sans conséquence programmatique au plan universitaire: la théologie chrétienne ne peut plus dès lors rester le cadre impensé et invariable d’une relation datée au divin. L’auteur tend ainsi à « désanctuariser » le savoir théologique en le réinsérant dans l’histoire culturelle des sociétés. La déconstruction des textes canoniques qui retrace leur pluralité constitutive et leurs compromis négociés, non seulement désacralise la collection biblique, mais déstabilise aussi le privilège accordé à tels livres au détriment de ceux que les conciles ont décrété apocryphes.
La réaction de ses collègues théologiens ne s’est pas faite attendre. Denis Müller, par exemple, ne se satisfait pas de cette relégation du potentiel critique de la théologie protestante au musée de la pensée occidentale. Pour lui, « La théologie universitaire a pour tâche de problématiser l’usage du mot « Dieu » et de rendre palpable la querelle incessante des dieux et des idoles qui anime le temps présent. Solidaire de toute recherche libre et de tout savoir critique, elle fait et dit autre chose que la philosophie, les sciences sociales et historiques ou les sciences des religions, ne cessant d’interroger radicalement la société sur les questions de vie et de mort, de mal radical, de justice, d’amour et d’espérance » (p.85, citation d’un article paru dans le quotidien genevois Le Temps en mars 2008). Pour les tenants des sciences des religions, une telle prise de position publique fait craindre pour l’indépendance de l’histoire ou de la philosophie en régime de faculté théologique. La réaction en chaîne se poursuit. Ces enseignants-chercheurs menacent ainsi de quitter la faculté lausannoise pour rejoindre les facultés littéraires ou de sciences politiques. L’une d’entre eux est d’ailleurs passée à l’acte.
Lancée en 2007, la controverse universitaire a ainsi trouvé écho dans la grande presse en 2008. L’auteur nous livre son épais dossier. Son commentaire vise le dépassement nécessaire des antagonismes exposés au grand jour. Lui-même en tant qu’acteur central propose une sorte de compromis en avançant l’idée d’une double polarisation des savoirs dans le Triangle Azur: à Genève l’étude du christianisme, à Lausanne celle de la scène religieuse universelle, à Neuchâtel la formation proprement pastorale et missionnaire. Et pour joindre le geste à l’intention, le théologien demande son rattachement direct à la section de sciences des religions de la faculté lausannoise. Vœu peu après accordé par ses pairs avec un changement d’intitulé de la chaire qui est significatif: on passe ainsi de l’enseignement de la « Dogmatique et théologie fondamentale » à celui d' »Histoire des théologies, des institutions et des imaginaires chrétiens ». Comme on le devine, la double polarisation préconisée entre Lausanne et Genève ne va pas de soi dans la mesure où les compétences des deux côtés demeurent largement structurées par l’histoire de la formation théologique avec ses trois niveaux plus ou moins emboîtés entre eux: les sciences bibliques, la théologie systématique et la théologie pastorale. De plus, dans ce pays de laïcité concordataire les intérêts ecclésiaux interfèrent avec les intérêts universitaires (l’université de Genève est liée à une fondation confessionnelle; la hiérarchie protestante a droit de regard sur les programmes théologiques et la nomination de leurs enseignants). Au terme de débats publics et de négociations universitaires mettant aux prises les logiques gestionnaires, ecclésiales, épistémologiques, disciplinaires et personnelles s’esquisse une forme de compromis à l’automne 2008: le pôle théologique lausannois voit son association avec les sciences des religions renforcée et celui de Genève conforté dans son orientation fondamentale et systématique. Si la séparation entre théologie et sciences des religions n’est plus à l’ordre du jour, les frontières programmatiques ont cependant bougé. Ainsi se crée à Lausanne, outre la chaire de notre théologien, un Institut « Religions, cultures, modernité », pôle de recherche tourné vers la diversité des acteurs de la scène religieuse dans le monde contemporain qu’il s’agisse d’autres traditions que le christianisme ou de la transformation actuelle de chacune d’entre elles dans un contexte d’interférences culturelles accrues. Les recrutements à la marge d’enseignants-chercheurs et de doctorants suivent cette extension du domaine savant qui vient ainsi compenser celui propre à une formation pastorale sur le déclin et dont une partie d’ailleurs est directement assurée par les dénominations respectives (tendances évangéliques) hors de l’enceinte académique.
Tirant le bilan de ces modifications, l’auteur conclut à ce qu’il appelle un « projet avorté », celui de la refondation des disciplines nouvelles et anciennes autour d’un objet commun, la fameuse scène religieuse. Son idéalisme transparaît quand il déplore que ses propositions n’aient pu trouver leur justification dans un débat partagé et argumenté sur le fond. On peut cependant supposer qu’il n’est pas dupe des contingences et obstacles mentaux, existentiels et institutionnels que ses thèses ont rencontrés malgré le bout de chemin engagé à Lausanne. À la balkanisation mondiale du christianisme (essor évangélique au Sud, repli et médiatisation catholique, spiritualisme flottant au Nord) correspondrait en écho local la cote mal taillée de la réforme suisse: les sciences bibliques campant résolument dans les intervalles entre philologie, histoire et herméneutique; les sciences des religions s’affranchissant de leur matrice chrétienne occidentale; la théologie protestante oscillant entre critique radicale de la modernité et idéologie missionnaire.
Ce témoignage de première main sur un moment et un lieu universitaire particuliers s’avère doublement précieux: d’abord par la mise en ordre ou en intrigue d’un ensemble de discours éclatés et plus ou moins publics, ensuite par la portée que ce conflit contemporain des facultés a plus généralement pour qui s’intéresse au traitement universitaire des phénomènes que l’on rassemble sous le terme contesté de religions. Il a également le mérite de mettre au grand jour ce qui relève souvent de l’implicite sinon du secret des cercles d’initiés. La qualité littéraire du récit dût-elle d’ailleurs en souffrir: l’auteur abuse un peu du verbe « gérer », des expressions familières du type « à l’interne/à l’externe » ou des chevilles lourdes telles que « tant quant à… »). Mais la matière brute et déjà semi-traitée est bien au rendez-vous. L’engagement personnel de l’auteur dans sa chronique enrichit de surcroît sa valeur et paradoxalement d’ailleurs sa portée générale. On souhaiterait que d’autres témoignages de conflits significatifs puissent de la sorte éclairer le destin des disciplines savantes, théologie comprise, qui tournent autour de faits éminemment problématiques.
Pierre Lassave, Archives de sciences sociales des religions, no. 160, 2012.
Sur Traiter du religieux à l’Université et Les constellations du croire (Genève: Labor et Fides, 2009)
Pas de croyance qui ne s’enkyste dans son vocabulaire. Ni de théologie qui ne s’égare dans les sables mouvants de mots laissés là pour solde de tout compte. Et dans le fourre-tout dogmatique desquels ne s’accumulent les débris d’une intelligence tiraillée par une crise identitaire entre fuite en avant et exorcisme à l’ancienne-entre sécularisme et fondamentalisme: deux emblèmes d’un même monstre d’autant plus désinstitutionnalisé qu’il en oublie qu’un langage ne dure qu’en se délocalisant, s’il faut qu’en soit renouvelé tout vocabulaire qu’il ne peut que puiser « ailleurs »-par outsourcing; et dont l’effet, d’un ressourcement au suivant, consiste à rappeler à la foi comme à la raison qu’en ce monde il n’y a pas davantage de solution finale en politique qu’il n’y a de « vocabulaire final » en matière de religion, chrétienne en particulier. Non plus qu’en sciences. Pour lesquelles Dieu n’est pas une donnée, et qui ne sont en soi pas plus athées que, pour la même raison, ne l’est la foi.
En sorte que Heidegger dira du langage qu’il ne parle pas-sauf à franchir un mur du silence: ce corps que fût-ce du bout des lèvres il transforme en parole. Qui, ressourcée, en transfigure la portée.
Invention grecque de la métaphore, la théologie n’en est pas moins science du ressourcement de la langue sans quoi n ‘y aurait que langage qui ne parle pas. Dont les Grecs avait conscience: les mythes étaient d’autant plus célébrés qu’on n’y croyait pas. En revanche on doit à la célébration du culte liturgique l’essor d’une théologie chrétienne, sous forme de déclaration de foi, puis d’adhésion à telle ou telle expression particulière de croyances qui aboutiront à l’éclosion d’une dogmatique aussi épineuse que belle.
Il faut lire, dans les Constellations, les pages qui, sous la direction de Gisel, sont consacrées à la différence entre croire et croyance, à une théologie qui doit encore capter le croire à une source qui lui est à la fois homogène et hétérogène; qu’elle trouve moins dans l’Eglise ou le monde, qu’au travers du langage; qu’elle doit se garder de monopoliser. Sinon l’Occident en perdrait ce goût de la transcendance que lui vaut l’usage d’un langage grâce auquel le croire est devenu « la question centrale de l’Occident », quoique de nos jours « on trouve du religieux [ … ] sans le moment d’un croire, comme on trouve du religieux sans l’allégation d’un Dieu ». Durkheim pouvait dire: « Nous ne rencontrons pas dans l’histoire, de religion sans Eglise »: nous assistons aujourd’hui à l’expression d’un religieux diffus et désinstitutionnalisé et qui se démarque de « tout appel à du croire ». Même en régime dictatorial, la plus commune des croyances n’est jamais tout à fait commune à tous. S’ensuit que l’acte de croire, conscient et assumé, n’est jamais un « acte pur ». Et si, pour l’Antiquité gréco-romaine, « la question du croire n’est pas pertinente » (Jean Pouillon, Paul Veyne) et, plutôt qu’à la croyance, se résout au rite, en va-t-il autrement avec le judaïsme? Où, pour Gisel, « la Loi n’est ni à comprendre ni à s’approprier, mais à appliquer »; ni n’entraîne, comme en christianisme, « une dramatique de l’âme », quoique Abraham doive quitter sa terre natale pour aller Dieu sait où et n’ait qu’un mot à la bouche: « Me voici » ! Sans parler de Jacob qui, dans sa lutte avec l’ange, se mesure ou plutôt mesure l’homme à la seule mesure qui convienne-Dieu. Voire à l’idole qu’on s’en fait, en qui le diable ne croit pas davantage qu’il ne croit en Dieu, ce Dieu dont, supposant qu’il existe, dit-il à Jésus, on ne saura jamais à l’avance s’il sera là quand on en aura vraiment besoin.
Serait-ce parce que leurs mythes étaient encore « parlants » que les Grecs n’avaient pas besoin d’y croire? Et que leur langage n’était pas emmuselé par les mots qui le véhiculaient-en comparaison du nôtre et pour peu qu’on écoute le pseudo-fondamentalisme des uns ou le pseudo-sécularisme des autres, ces jumeaux d’une modernité qui n’a pas viré sa cuti?
Et donc en appelle à une transcendance dont il nous faut d’abord réviser notre entendement (Zizek). En vue de quoi s’est insurgé Gisel-au sein d’une université dont la théologie, d’inspiration protestante, est réputée pour l’excellence de son champ d’étude et de recherche: les sciences bibliques. Et non sans rappeler l’autre boutade de Nietzsche, constatant qu’après des siècles de christianisme, n’en restait trace de son passage-sauf la Bible.
Et que Gisel a voulu désenclaver, libérer de l’ostensoir ou sacristie qu’autour d’elle ont formé des disciplines qui, échaudées par leur émancipation au XVIIIe siècle, sont intimidées par l’audace dont, de nos jours, elles devraient faire preuve pour éviter tout clivage entre croire et penser-éviter que Jésus, l’homme tout court, ne soit occulté au motif que, le voyant, on y a vu Dieu.
J’escamote les péripéties qui ont jalonné une discussion qui, couvée depuis longtemps en Suisse, se solde tant par la satisfaction que par l’insatisfaction de tous (à preuve, ce dualisme aux pieds d’argile qu’est une Faculté de théologie et de sciences des religions). Y compris Gisel, qui tient sa promesse de présenter au lecteur « une photographie limitée d’un moment du contemporain et sans que soit dit un dernier mot ».
G. Vahanian, Revue d’histoire et de philosophie religieuses, t.92, N°2 / 2012, pp. 291-369.
La faculté face au religieux
Dans son dernier livre, le professeur Pierre Gisel revient sur la crise qui a ébranlé les facultés romandes de théologie en 2007-2008 et tente d’en dégager les enjeux, sur fond de redéploiement du religieux.
Des mouvements religieux récents à l’éclatement de la notion même de religion, comment redéfinir l’enseignement de la théologie? La crise qui agitait les facultés romandes de théologie en 2007 et 2008 s’est fait l’écho de ces questions qu’il s’agit d’approfondir: c’est le postulat du professeur Pierre Gisel. Tout en relatant les évènements, le doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne tente d’en démêler les enjeux dans Traiter du religieux à l’université (éditions Antipodes). La crise dépasserait l’opposition entre théologie et sciences des religions, à laquelle elle a été parfois résumée, et mettrait notamment en jeu des réflexes identitaires.
Pourquoi revenir sur la crise traversée par les facultés de théologie romandes? Ce livre veut-il justifier une position?
Pierre Gisel: Aujourd’hui, la situation est pacifiée et j’occupe depuis une année le poste de doyen de la faculté lausannoise. Il est vrai que j’ai eu envie d’objectiver et de documenter cet épisode au cours duquel j’ai été passablement critiqué et considéré par les théologiens comme un hérétique trahissant la cause. Mais je ne crois pas que ce livre puisse être réduit à une entreprise d’autojustification: il s’agissait surtout de reprendre des questions de fond, qui demeurent.
Quelles réactions ce livre a-t-il suscitées?
Il en a suscité plus que tous mes autres ouvrages (sourire). Mais assez peu auprès de ceux qui ont été directement acteurs des événements et pourraient se trouver un peu mécontents. Parmi les lecteurs, qu’ils soient issus des facultés de théologie, lettres ou sciences sociales par exemple, beaucoup ont jugé le débat utile et plus complexe qu’ils ne l’avaient perçu alors.
Vous déplorez en effet que les questions de fond n’aient pas été abordées. Lesquelles?
D’abord, qu’entend-on par religion? Et qu’en est-il de son rapport au social? Jusqu’où la réflexion doit-elle porter, sachant que le religieux est aujourd’hui pris dans des recompositions qui en modifient les frontières? On parlera ainsi, par exemple, de spiritualités athées. Ensuite, faut-il développer – et lesquelles – des approches transversales au lieu de simples considérations sur des traditions juxtaposées (judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme) ou d’autres mouvements (scientologie, raéliens)? Comment traiter du christianisme dans ce champ d’ensemble?
De quoi témoigne cette crise, selon vous?
De la difficulté des agents du christianisme à dépasser la pure défense de leurs biens propres, traditionnels, pour les resituer en fonction d’axes plus larges. De la difficulté à reprendre, approfondir et penser leur « identité ».
Vous sous-titrez votre ouvrage « Une dispute socialement révélatrice ». C’est-à-dire?
Le religieux est une « scène » sur laquelle s’expriment des déplacements socioculturels plus larges qui touchent par exemple la notion même de religion, dont la circonscription n’a pas toujours ni partout été identique. Dans les différentes religions africaines ou amérindiennes, par exemple, cette notion ne correspond pas à ce que le terme implique aujourd’hui en Occident.
Pour s’adapter à cette nouvelle donne, l’enseignement de la théologie doit-il être déconfessionnalisé? Vos détracteurs vous accusent d’ailleurs de le souhaiter.
Mes détracteurs sont divers. Le thème de la déconfessionnalisation s’est imposé au cur de la dispute. Tel quel, il ne vient pas de moi, mais il ne peut être simplement évacué. Comme d’autres, il doit être repris, différencié et travaillé sur des exemples concrets: le canon biblique, les phénomènes d’institutionnalisation, etc. Ceux-ci montrent très vite que le questionnement est plus complexe et différencié que prévu. Cela dit, oui, bien sûr que l’enseignement doit être déconfessionnalisé. Mais la théologie y prétendait déjà, au moins pour une part…
Selon vous, la différence d’approche entre sciences des religions (qui revendiquent une neutralité d’observation) et théologie (liée à son objet d’étude) n’est pas en jeu.
Ce point est bien en jeu, mais il faut aussi le dépasser. D’ailleurs, qu’est-ce qu’une observation neutre et qu’est-ce qu’être lié? Toutes les disciplines ont une histoire et des angles d’approches déterminés, instructifs en tant que tels. Pour sa part, la théologie a, historiquement, été porteuse d’un ordre de réflexion original et fort, qui n’a en principe rien à voir avec une défense et une dépendance de dogmes donnés, même si elle doit, comme toute tradition de pensée, être toujours à nouveau problématisée, et qu’elle est aujourd’hui particulièrement mise en cause. Notamment parce que la notion d’absolu, à laquelle elle est adossée, n’est plus considérée comme déterminante.
Quel défi pose aux facultés de théologie l’accroissement actuel de l’intérêt pour le fait religieux?
Pour les facultés de théologie, comme pour le christianisme globalement, le défi ne s’exprime pas simplement en termes de perte – tandis que d’autres religions seraient gagnantes -, mais en termes de déplacements et de balisage très différent du terrain socioculturel. Cela demande à être interprété et, d’une certaine manière, honoré, ce qui n’implique pas d’être repris sans critique ni problématisation.
Vous militiez pour un modèle articulé à la scène religieuse globale plutôt que – d’abord – au christianisme.
C’est globalement le modèle que nous avons aujourd’hui à Lausanne. La faculté n’est plus organisée en fonction du christianisme. Sur ce point, on peut dire qu’elle a basculé dans un autre paradigme. Reste à rendre celui-ci fructueux. Cela passera notamment par la remise à plat engagée des différents cursus de formation en sciences des religions. Pour le christianisme, cela a – ou doit avoir – aussi des effets, j’ai essayé de dire en quoi. Nous verrons si c’est le cas ou si se mettront plutôt en place une sorte de repli identitaire d’un côté, une pure rupture de l’autre, faible réponse dans l’interrogation de ce dont nous provenons et ce qui nous arrive.
Les rectorats ambitionnaient de développer, au niveau européen, un pôle fort de théologie et de sciences des religions: où en sommes-nous aujourd’hui?
Nous avons un dispositif d’ensemble enviable, et envié! Le modèle n’est pas celui visé, heureusement à mon sens; et il n’est pas non plus ce que j’aurais pu espérer. Mais il est riche de potentialités et exploitable pour le meilleur de chacun, université et société.
Dominique Hartmann, Le Courrier, samedi 3 décembre 2011.
La religion à l’Université
En 2007 et en 2008, la Faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne a traversé une crise importante. Le professeur Pierre Gisel recapitule et analyse les événements
En 2007 et en 2008, la Faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne a traversé une crise importante, qui a donné lieu à un large débat public. L’un de ses protagonistes – le professeur Pierre Gisel, qui vient de recevoir un doctorat honoris causa de l’Université de Sherbrooke – l’a jugée assez révélatrice d’un point de vue social pour lui consacrer un livre. Comment traiter du religieux à l’Université? Tel est l’enjeu de cet ouvrage, qui propose pour l’essentiel une récapitulation de ces événements, ainsi qu’une analyse personnelle de l’auteur.
A la veille des « événements », la Faculté ne présente plus le même visage: depuis 2006, elle est constituée de deux sections, théologie et sciences des religions, qui se perçoivent volontiers comme rivales. Au plan romand, depuis 2004, une Fédération des facultés de théologie a été mise sur pied afin de permettre l’introduction du master en théologie à la suite de la réforme de Bologne. La convention qui chapeautait la fédération devait être renouvelée. C’est dans ce contexte que s’inscrit la dispute.
Les rectorats des trois facultés souhaitaient, à cette occasion, obtenir une collaboration renforcée à des fins de rationalisation. Mais, selon Pierre Gisel, le projet rectoral, qui portait principalement sur une homogénéisation des ressources de Genève et Lausanne, n’a pas suffisamment tenu compte des données institutionnelles.
Contrairement à la faculté de Lausanne, qui ne dépend que de l’Université, celle de Genève dépend d’une fondation semi-publique dont le conseil est formé à 50% de membres de l’Eglise protestante. Du coup, estime l’auteur, « tout allait se passer comme si l’on proposait aux représentants des sciences des religions de la faculté de Lausanne, qui avaient l’impression d’avoir acquis péniblement et récemment la moitié du pouvoir dans leur société et de s’être ainsi autonomisés, tout au moins en partie, d’entrer dans une holding avec participation de l’Eglise où ils n’auraient qu’environ un cinquième des parts ». Une donne qui empêchera la logique lancée d’aller jusqu’au but fixé.
Pierre Gisel regrette que le projet ait été élaboré sans vision et débats théoriques. « La discussion n’a pas été réellement ouverte sur ce qu’entendait et réclamait une étude universitaire du religieux, ni sur les modèles institutionnels que cela pouvait commander », écrit-il. Les savoirs ont été considérés comme atomisés et juxtaposés, réduits à du quantitatif.
« La scène religieuse »
L’auteur a milité pour une faculté qui ne soit plus organisée en fonction du christianisme, mais articulée à ce qu’il appelle « la scène religieuse », faite de réalités anthropologiques et sociales, où le christianisme n’est plus qu’une tradition parmi d’autres. Une Faculté qui serait, en somme, déconfessionnalisée, qui ne serait plus ni pensée ni organisée en fonction de la gestion d’une unique tradition religieuse. Cette proposition a suscité l’opposition des tenants de la « confessionnalisation » de la Faculté.
Au final, Pierre Gisel a vu dans ce malaise les symptômes d’une crise du christianisme, qui n’arrive plus à penser son rapport à la société.
Patricia Briel, Le Temps, 8 novembre 2011.
« La crise qu’a connue la faculté de Lausanne est symptomatique d’un christianisme qui n’arrive plus à penser sa relation à la société »
A neuf mois de sa retraite académique, le doyen Pierre Gisel publie un ouvrage où il revient sur les événements qui ont secoué la Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR) de l’Unil en 2007-2008. Une mise en perspective qui n’épargne pas les acteurs d’alors, mais soulève des questions de fond. Interview.
ProtestInfo: Dans Traiter du religieux à l’Université, vous débutez le récit des événements à l’hiver 2007, moment où les rectorats des Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel suggèrent aux facultés concernées une restructuration de leur partenariat. Que s’est-il alors passé?
Pierre Gisel: Il n’y a pas eu de réflexion de fond sur ce que sont des études en sciences des religions. Tout s’est passé comme si l’institution avait eu peur d’ouvrir la discussion. Les questions de fond – c’est quoi « traiter du religieux aujourd’hui » – connaissent des déplacements importants et pas toujours aperçus, qui traversent autant les champs traditionnellement occupés par la théologie que ceux des sciences des religions. Au niveau stratégique, les positionnements respectifs que les facultés de Genève et de Lausanne, et accessoirement de Neuchâtel, auraient pu occuper dans un dispositif à inventer n’ont pas été empoignés non plus.
P: Il n’était alors donc pas simplement question de renouveler la convention qui liait les trois facultés pour la formation en théologie…
PG: Non, cela dépassait la question de la Fédération des facultés de théologie et touchait d’autres facultés, concernées à des degrés divers par l’explosion du nombre d’étudiants en sciences des religions. Et il aurait notamment fallu, à mon sens, différencier plus fortement les facultés de Genève et de Lausanne. Or les autorités académiques visaient plutôt une « fusion ». De mon point de vue, on tenait une opportunité unique de mettre toutes les cartes sur la table et d’imaginer un projet original, à Lausanne en particulier.
P: Or le projet échoue et vous parlez d' »un pari raté ». Pourquoi?
PG: Je m’empresse de le préciser: le modèle actuel est un modèle habitable et prometteur. Sans quoi je n’aurais pas accepté le poste de doyen l’an dernier. Mais ce modèle, personne ne l’a voulu sous cette forme. Par exemple, les rectorats, soutenus par le décanat de Lausanne, auraient voulu que tous les biblistes (ndlr: qui travaillent sur les textes) soient rattachés à la Faculté de Lausanne et les systématiciens (ndlr : qui pensent la théologie comme un système) à celle de Genève. Or, ce modèle-là, la Faculté autonome de théologie protestante de Genève n’en a pas voulu (ndlr: cette dernière, contrairement à la fac lausannoise pleinement intégrée à l’université, dépend d’une fondation en partie liée à l’Eglise protestante de Genève). Avec un tel modèle, on aurait de fait fragilisé la fac de Genève et la théologie, sans pour autant permettre un développement fécond des sciences des religions, ni une restructuration inventive de la fac de Lausanne.
P: Et votre modèle, quel était-il?
PG: Il aurait notamment fait place à un vrai traitement, réflexif et problématisant, tant de notre société présente que de l’histoire dont nous provenons, dont le christianisme, vus sous un angle de sciences des religions. Or, aujourd’hui, le risque est d’en rester à des spécialisations juxtaposées. Des éléments de ce qu’a pu porter la théologie auraient aussi pu être repris, modifiés bien sûr, dans ce nouveau champ. Mais la guerre des clans qui a éclaté à la rentrée 2007 a polarisé les fronts. Et un renouvellement en profondeur n’a plus été possible.
P: Mais l’opposition entre sciences des religions et théologie existait déjà, non?
PG: Bien sûr. Elle est d’ailleurs latente, présente dans l’ensemble du monde. Mais on aurait pu décentrer un certain nombre de choses. Ce qui m’a le plus surpris, c’est que le camp des théologiens se soit, tout à coup, raidi, ce que je ne m’explique pas. Le groupe, peut-être inconsciemment, s’est senti attaqué dans son identité et, en trois jours, ça a tourné. J’étais devenu l’hérétique. Du côté des sciences des religions, on en est du coup resté aux réflexes anti-théologiques, sans déplacement non plus.
P: De quoi est-ce symptomatique?
PG: Ce n’est pas un très bon point pour le christianisme, qui n’arrive plus à penser sa relation à la société globale. Chacun sent que l’identité est fragile, en perte de vitesse. Et la réponse, comme si on n’arrivait pas à inventer autre chose, est la réaffirmation identitaire et le repli sur soi. Que ce soit sur le mode évangélique, celui de la politique de Benoît XVI ou du repli sur la boutique Eglise.
P: Votre livre évoque les conflits lourds qui ont miné la FTSR. Une manière de régler vos comptes avec les personnes en place à l’époque?
PG: Ce n’est pas ainsi qu’il faut le lire, même si, après trois ans de guerre un peu lourde, j’ai bien sûr quelques affects. Je n’aurais pas fait paraître le livre il y a une année. Mais les choses me paraissaient aujourd’hui suffisamment apaisées pour que l’on puisse reprendre les questions de fond.
P: Vous venez de recevoir un doctorat honoris causa de l’université de Sherbrooke, au Canada, via sa Faculté catholique de théologie et d’études religieuses. Vous êtes boudé par les protestants?
PG: Sur le fond, je crois que les catholiques comprennent mieux le sens de ma démarche intellectuelle, depuis longtemps. C’est une faculté semblable à celle de Lausanne. J’ai été plutôt rejeté en Suisse romande, et là-bas c’est le contraire. Pas reconnu chez soi et reconnu ailleurs, c’est classique. Mais ce titre reste honorifique.
P: Savez-vous ce que vous ferez dès le 1er août 2012, premier jour de votre vie de retraité?
PG: Je ne vais pas manquer d’invitations, en théologie comme en sciences des religions. Mais, pour l’instant, je suis pleinement investi dans ma tâche de doyen. Où, à côté de la filière de théologie pour les futurs pasteurs, il y a à repenser ou à construire l’ensemble des cursus de sciences des religions. Pour les futurs enseignants en sciences des religions et d’autres. Et c’est un beau défi.
Propos recueillis par Samuel Ramuz, ProtestInfo, 10 octobre 2011.