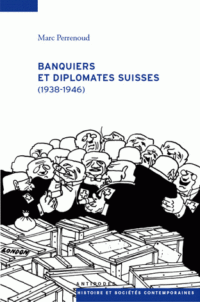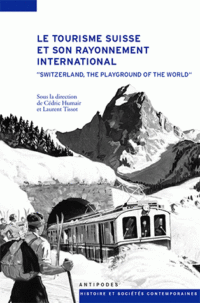Taylorisme et management en Suisse romande, 1917-1950
Leimgruber, Matthieu,
2001, 184 pages, 16 €, ISBN:2-940146-19-5
Le rendement, la flexibilité et les restructurations d’entreprises, publiques ou privées, sont aujourd’hui à l’ordre du jour. Quotidiennement, le « reengineering », la « qualité totale », le « juste à temps » ou encore le « salaire au mérite » sont présentés comme des adaptations nécessaires, voire inévitables. Sans des mesures de rationalisation drastiques, nous répètent à satiété leurs partisans, comment, en effet, faire face à la mondialisation, à l’exacerbation de la concurrence, ou encore à la crise?
Description
Le rendement, la flexibilité et les restructurations d’entreprises, publiques ou privées, sont aujourd’hui à l’ordre du jour. Quotidiennement, le « reengineering », la « qualité totale », le « juste à temps » ou encore le « salaire au mérite » sont présentés comme des adaptations nécessaires, voire inévitables. Sans des mesures de rationalisation drastiques, nous répètent à satiété leurs partisans, comment, en effet, faire face à la mondialisation, à l’exacerbation de la concurrence, ou encore à la crise?
Les restructurations provoquent une intensification importante de l’exploitation du travail. La réduction des coûts et la restauration du profit-facteurs essentiels en temps de crise-font partie des logiques qui sous-tendent ces rationalisations. Les méthodes managériales et d’organisation de la production mises en œuvre aujourd’hui ne sont pourtant pas apparues brusquement il y a une quinzaine d’années. Un retour sur le passé témoigne au contraire des similitudes qui existent entre la situation actuelle et une autre période troublée de l’histoire sociale et économique.
Presse
Dans la lignée des travaux de Patrick Fridenson et d’Aimé Moutet, Matthieu Leimgruber s’intéresse à la diffusion des concepts tayloriens d’organisation scientifique du travail dans l’Europe de l’entre deux-guerres. Cet ouvrage se démarque des études antérieures à double titre. Tout d’abord, l’auteur pose son regard sur la Suisse romande, un espace industriel périphérique à la fois dans le contexte européen et national. Ensuite, il élargit la perspective traditionnelle en prolongeant l’analyse des conditions de ce transfert scientifique au-delà des années trente, afin de démontrer le lien étroit entre l’organisation scientifique du travail prônée par l’ingénieur américain et l’essor du management au cours des Trente Glorieuses en Europe. Soucieux de comprendre les mécanismes de ce transfert scientifique, M. Leimgruber procède à une sociologie des savoirs en scrutant les travaux des associations patronales et professionnelles qui militent pour une rationalisation de la gestion du travail au sein du monde industriel.
Dans une première partie, l’auteur souligne la lenteur du « tournant » taylorien en Suisse romande. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la diffusion des préceptes de l’organisation scientifique du travail demeure très éparse et incomplète. Seules quelques industries pionnières mettent à profit les circonstances exceptionnelles du conflit pour amorcer ce processus de rationalisation. Des associations internationales, notamment l’International Management lnstitute localisé à Genève, familiarisent le patronat et les ingénieurs suisses avec le taylorisme. À l’instar de l’Institut Jean-Jacques Rousseau, le développement l’enseignement de la techno-psychologie dans des centres de formation participe de cette prise de conscience de l’existence de nouvelles, modalités de gestion du travail. En 1928. la constitution d’une Commission romande de rationalisation (CRR) marque une étape cruciale dans le processus de diffusion. Organisé autour d’un quatuor taylorien composé de deux industriels, un banquier et un ingénieur, la CRR devient alors à espace de sociabilité patronale et le centre de gravité clé la diffusion des concepts du taylorisme. Composée de plusieurs sous-sections, la CRR tente de promouvoir le taylorisme à l’intérieur de l’ensemble des secteurs économiques de la Suisse romande et s’ingénie à vaincre les résistances des syndicats et l’anxiété de la classe moyenne. Pilier de l’ensemble, la section Industrie regroupe les entreprises de tailles diverses et représente l’ensemble des secteurs industriels locaux.
Néanmoins, l’influence de la CRR demeure fragile et circonscrite à la Seule région romande. De Plus, la crise économique affaiblit la commission en provoquant des pratiques au sein de cette organisation collective et le retour à des pratiques individuelles d’action. À l’image d’autres pays européens, le taylorisme s’impose donc en Suisse romande comme une réponse rationnelle au marasme économique.
A l’issue de cette première partie centrée sur la sociabilité patronale, l’auteur s’attache à saisir la composante professionnelle de cette recherche de rationalisation au cours des années trente. En s’appuyant sur le cadre analytique proposé par Luc Boltanski dans son travail séminal sur les cadres, M. Leimgruber analyse l’émergence de deux nouvelles professions dans les entreprises romandes : l’expert-comptable et le publicitaire. Ces deux professions se structurent au cours de cette décennie et posent les bases du triomphe du management à la manière américaine d’après-guerre. La CRR peine à trouver des relais au sein de ces nouvelles professions qui possèdent leur propre réseau de sociabilité. Peu à peu, le discours rationnel des cadres prolonge et amplifie celui des industriels à l’origine de la création de la CRR. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce renouveau, générationnel et économique prend un visage autoritaire et technocratique dans la lignée du planisme économique commun à de nombreuses nations européennes. Au lendemain du conflit, la gestion des entreprises de Suisse romande retrouve un caractère plus démocratique. Des clubs d’efficience recentrent les projets de formation et de gestion autour des notions de productivité et de rendement individuel. Dans l’immédiat après-guerre, le management devient l’aboutissement logique du processus de rationalisation enclenché en Suisse romande depuis les années 1910.
Afin de mener à bien cette démonstration des mutations du taylorisme, M. Leimgruber. jeune historien suisse, prend le parti de s’intéresser aux seuls travaux des réseaux de sociabilité patronale et professionnelle dans la Suisse romande. Cette posture le conduit à adopter une position surplombante sur le processus de diffusion du tayIorisme et à dissocier les lieux de production du savoir et les espaces de déploiement de cette nouvelle science du travail : les entreprises. Même si elle constitue la force de l’ouvrage, cette hauteur intellectuelle lui fait perdre de vue la totalité de la chaîne de pratiques qui conduit des réflexions en amont autour de la modernisation à l’adoption finale en aval de ces pratiques dans les entreprises. À ce titre, on peut regretter l’absence de prolongation des trois études de cas liminaires d’entreprises romandes (Dubied, Sécheron et les Cableries de Cossonay) pour montrer les conditions de maturation et de développement des concepts de rationalisation et de management dans la Suisse romande au cours de l’entre-deux-guerres. Cet élargissement de perspective aurait enrichi la compréhension des mécanismes d’helvétisation du taylorisme et du management pendant cette première moitié du XXe siècle européen.
Romain Huret, Annales, juin 2001
La fascination du modèle américain
Dans les années trente, quelques capitaines d’industrie ont succombé aux charmes du « consulting » et du « management » à l’américaine.
Nous pensons tous que les théories du management, les consultants et la fascination pour le modèle d’entreprise américain sont une mode de ces trente dernières années. Et bien pas du tout. On trouve tout cela dans la période d’entre-deux-guerres, chez nous, en Suisse romande. Tout commence en 1918 lorsque l’économiste américain de Genève, William Rappard, organise un voyage d’études aux Etats-Unis avec des industriels et deux journalistes. La Gazette de Lausanne décrira avec enthousiasme « l’organisation scientifique du travail », autrement dit le taylorisme tel qu’il fonctionne de l’autre côté de l’Atlantique.
La commission romande de rationalisation
Les ingénieurs sont à la pointe du mouvement. Le meneur sera René de Vallière, un Neuchâtelois qui dirige le service technique de Dubied de 1924 à 1931 avant de prendre la tête de l’institut d’organisation industrielle de l’EPFZ, le fameux BWI. René de Vallière multipliera voyages aux Etats-Unis, articles et conférences où il parle du shop management, déjà un anglicisme. Après Dubied, Sécheron à Genève, Cossonay et l’horlogerie jurassienne suivront le mouvement. En étant le promoteur, avec quelques années d’avance, sur les pays voisins des méthodes américaines, l’ingénieur neuchâtelois, inconnu des livres d’histoire, est certainement un des artisans de la prospérité helvétique et un des hommes-clé de notre XXe siècle.
En même temps et à côté de l’action de René de Vallière, apparaît l’organisme qui jouera un rôle décisif dans la modernisation de l’économie romande, ou du moins dans sa composante orientée vers le grand large : la commission romande de rationalisation (CRR), créée en 1928 et qui va fonctionner jusqu’à la guerre. Elle est créée par un quatuor de grande envergure: Aloys Hentsch, écarté par ses frères de la banque familiale et qui va se passionner pour les problèmes d’organisation d’entreprise, Henri Muret, un rejeton de l’illustre famille vaudoise qui fonda le comptoir suisse, Pierre Dubied qui dirige l’entreprise du même nom et Adrien Brandt, patron d’Oméga, la plus grande entreprise horlogère de l’époque. A eux quatre, ils connaissent tout le petit monde de l’économie romande.
L’opposition radicale au management
La CRR s’appliquera à diffuser les théories du management, le mot apparaît à l’époque, dans les entreprises romandes. L’opposition viendra des syndicats, mais surtout du parti radical à travers son organe, La Revue-pas encore nouvelle-qui en bon défenseur des artisans et du petit commerce tirera à boulets rouges sur ce qui est qualifié « d’embrigadement général » ou de « caporalisme industriel ». La CRR agira avant tout à travers sa « section industrie » qui abattra une grande quantité de travail jusqu’en 1934, à travers commissions, brochures, notes et réunions diverses. L’aggravation de la crise des années trente mettra fin aux activités de cette section. Le départ progressif des fondateurs entraînera un déclin de la CRR.
L’histoire économique suisse à découvrir
Les membres de la CRR seront fascinés, non pas par le nazisme, mais parce qu’ils croient être un nouveau modèle efficace d’organisation venu d’Allemagne. La revue de la CRR, Organisation et rendement, change de nom en 1941 pour s’appeler, ça ne s’invente pas, Le chef avant de devenir Chefs avec un pluriel plus prudent, en 1942. Elle subsistera sous ce nom jusqu’en 1981. Cet épisode inédit de notre histoire est raconté par Matthieu Leimgruber dans un ouvrage publié par Claude Pahud aux éditions Antipodes qui poursuivent un travail d’excellente qualité. Ainsi pendant quelques brèves années, au tournant des années trente, les entreprises romandes adopteront des modes anglo-saxonnes avec des consultants portant la bonne nouvelle et un sabir américano-français; tout ce que l’on retrouvera quarante ans plus tard et qui sera alors perçu comme entièrement nouveau. Il est certain que l’histoire économique a un immense territoire à explorer en Suisse, d’autant que peu de pays sont aussi dépendants que le nôtre des grandes entreprises, comme des épisodes récents nous l’ont rudement enseigné.
Jacques Guyaz, Domaine Public, N° 1489, 12 octobre 2001
Les nouveaux visages du taylorisme
Les restructurations d’entreprises privées et publiques des années 90 sous l’égide de la flexibilité et de la réduction des coûts présentent de nombreuses similitudes avec les rationalisations drastiques mises en œuvre durant la première moitié du XXe siècle. Dans son ouvrage consacré à l’introduction des méthodes de l’organisation scientifique du travail (OST), Matthieu Leimgruber, historien à l’Université de Lausanne, nous fait revivre les succès et les difficultés des pionniers de la rationalisation en Suisse romande. Le « système Taylor », c’est-à-dire le strict partage des tâches de conception et d’exécution, la décomposition du travail en tâches parcellaires et répétitives, la lutte contre la flânerie ouvrière, est introduit dès le début du siècle dans les grandes entreprises industrielles alémaniques. En Suisse romande, l’engouement pour les « méthodes américaines » a plus de peine à s’affirmer. Il doit son essor à quelques ingénieurs et industriels d’exception, tel René de Vallière. Sa rencontre avec l’industriel Pierre Dubied sera déterminante. L’usine de machines textile de Couvet (Neuchâtel) sera la première en Suisse romande à appliquer systématiquement le taylorisme dès 1917. D’autres entreprises seront influencées par le mouvement, tel Sécheron à Genève ou les Câbleries de Cossonay. La fondation de la Commission romande de rationalisation en 1928, animée notamment par le benjamin d’une célèbre famille de banquiers genevois, Aloys Hentsch, vulgarisera l’OST auprès du patronat romand, mais ses succès seront mitigés. Les « tayloristes » rêvent de généraliser leur méthode à l’ensemble des activités économiques. Les réticences sont vives, surtout dans le milieu des artisans, commerçants et petits industriels qui constituent l’essentiel du tissu économique en Suisse romande.
Au cours des années 30, le mouvement se diversifie. C’est à cette époque qu’émergent de nouvelles professions imprégnées de l’idée de l’organisation scientifique du travail. Apparaît la figure de l’expert-comptable avec l’essor des sociétés fiduciaires attachées au perfectionnement des méthodes comptables des entreprises. C’est le début des publicitaires et de l’étude de marché systématique. L’OST va de pair avec le mouvement psychotechnique au service de la « conduite des ateliers », de la politique de recrutement et de la formation du personnel. C’est l’ancêtre de la gestion des « ressources humaines ». L’ensemble de ces développements fera surgir un nouveau personnage sur la scène commerciale et industrielle: le cadre.
Le mouvement « tayloriste » sera fortement influencé par les idéologies qui dominent cette époque troublée. Ainsi, dans les années 30, le héros « tayloriste » sera le « chef » omniscient, le « gagnant », admirateur du militarisme prussien. Après la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle vague de diffusion du taylorisme sera influencée par le management « libéral » de l’Amérique du plan « Marshall ».
Une constante du taylorisme traverse toutes ces époques: la marginalisation des organisations syndicales. La rétribution proportionnelle au rendement serait déterminée scientifiquement et le travailleur échapperait ainsi à la tyrannie patronale autant qu’à la « surenchère des syndicats », que les patrons « tayloristes » s’efforcent obstinément de tenir à distance.
Pierre-Yves Oppikofer, Le Temps, 16.11.2001
Dans Histoire et sociétés
Cet ouvrage bref, dense et clair, vient enrichir la connaissance que l’on a des adaptations nationales européennes de la rationalisation à l’américaine dans la première moitié du XXe siècle. À lire Matthieu Leimgruber, on ne perçoit pas en Suisse d’influence majeure venue de l’Allemagne, ni de la rationalisation à la française telle qu’on peut la suivre dans la thèse d’Aimée Moutet et les rationalisateurs suisses ont eu un écho limité en France et en Allemagne, même si l’on note ici ou là la participation à telle conférence. Comme souvent avec les vents venus d’outre-Atlantique, le cas de la Suisse romande illustre bien le fait que les influences intra-européennes ont été limitées, ce qui renforce les caractères nationaux des adaptations. Ceci est vrai pour la Suisse romande, en prise directe avec l’influence américaine, parfois via le Bureau international du travail (BIT), dont le siège est à Genève. Tel industriel américain, comme Henri S. Dennison, fabriquant d’emballages cartonnés, est visité en 1923 par un des principaux ingénieurs tayloriens suisses, René de Vallière; et Dennison, en tournée en Suisse en 1927, joue un rôle important dans la structuration du mouvement suisse de l’organisation scientifique. Certes, un homme comme Vallière a travaillé à Hanovre dans une fabrique de moteurs de sous-marins, puis a dû se former aux méthodes tayloriennes en 1913-1914 en Hollande. Mais il se consacre ensuite à une « helvétisation » du taylorisme.
Les traits que l’on retrouve ailleurs sont bien entendu nombreux, à commencer par le rôle pionnier joué par des ingénieurs qui voient dans le taylorisme une reconnaissance de leur place au centre du système productif, mais aussi une reconnaissance de leur rôle social: l’organisation scientifique du travail bien comprise doit arbitrer les conflits du travail. Aussi le fer de lance de la propagande taylorienne est-il dans un premier temps la Société suisse des ingénieurs et architectes, qui lance en 1921 un cycle de conférences patronnées par le BIT sur le thème de « l’organisation économique du travail ». Mais l’influence fordiste pousse à une rationalisation globale de l’entreprise et de son adéquation avec le marché. Dans cette optique, les ingénieurs n’ont plus qu’une partition-certes centrale-à jouer dans un ensemble dirigé par les entrepreneurs: ce sont eux qui animent la « Commission romande de rationalisation » entre 1928 et 1934, regroupant surtout des dirigeants de grandes entreprises (Dubied, Bally, Omega, grands magasins Globus, etc.). Enfin, autre trait souvent rencontré en Europe, la transformation de la rationalisation avec la crise : présentée d’abord comme un moyen d’augmenter la productivité au profit de toute la communauté-entreprise, en permettant de meilleures rémunérations et une politique sociale patronale active, la rationalisation des années 1930 se transforme en un moyen d’augmenter la productivité sans contrepartie, dans un contexte de baisse de la production et de concurrence accrue. Mais ici comme ailleurs, la majorité du mouvement ouvrier suisse n’a pas attendu le tournant de la crise pour dénoncer l’utilisation pro-patronale de l’organisation scientifique du travail
Quelques traits semblent cependant particulièrement marqués en Suisse: l’importance de la psychotechnique et de la formation sociale des cadres, sous l’influence de l’institut Jean-Jacques Rousseau, puis surtout de l’Institut psychotechnique de Zürich, fondé par Alfred Carrard; le souci de rationaliser aussi la gestion, avec la montée du rôle de l’expert-comptable, ainsi que la vente, avec l’émergence du marketing et de la publicité; la vivacité de la résistance du petit patronat, qui voit dans la standardisation un moyen de condamner la production de qualité en petites séries et d’assurer la domination des grosses entreprises; la réponse de certains rationalisateurs, qui tentent de fier organisation scientifique, corporatisme et lutte contre les gaspillages de l’État, dans une dérive fascisante.
Quant à la période de l’après-guerre, Matthieu Leimgruber retrouve en Suisse ce que Luc Boltanski notait dans son étude sur les cadres pour la France: la reconversion des rationalisateurs séduits par le corporatisme durant la guerre dans un productivisme à l’américaine, où les techniques des « relations humaines » permettent de réduire les tensions sociales. On retrouve alors le rôle clé initial de la rationalisation pensée comme facteur de paix sociale, dominant en Suisse après la grève générale qui frappa le pays en novembre 1918.
Gérard Vindt, Histoire et Sociétés (Revue européenne d’histoire sociale) no 9, janvier 2004
Dans Solidarités
Le rendement, la flexibilité et les restructurations d’entreprises publiques ou privées sont aujourd’hui à l’ordre du jour. Quotidiennement, le « reengineering », la « qualité totale », le « juste à temps » ou le « salaire au mérite » sont presentés comme des adaptations nécessaires. Sans des mesures de rationalisation drastiques, comment pourrait-on faire face à la mondialisation, à l’exacerbation de la concurrence, ou encore à la crise?
Les restructurations provoquent une intensification de l’exploitation du travail. La réduction des coûts et la restauration du profit font partie des logiques qui sous-tendent ces rationalisations. Les méthodes manageriales et d’organisation de la production mises en oeuvre aujourdíhui ne sont pourtant pas apparues brusquement il y a une quinzaine d’années. Un retour sur le passé témoigne au contraire de certaines similitudes entre la période actuelle et l’entre-deux-guerres.
Solidarités, N° 134 (ancienne série), 29 septembre 2001, p. 25