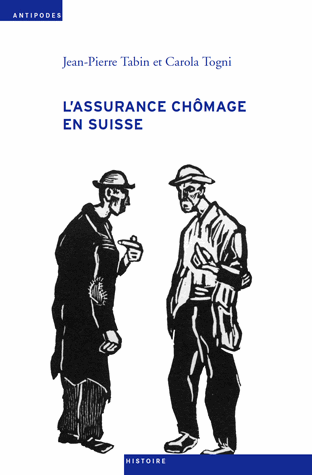Assurance chômage en Suisse (L’)
Une sociohistoire (1924-1982)
Tabin, Jean-Pierre, Togni, Carola,
2013, 229 pages, 23 €, ISBN:978-2-88901-077-6
Qu’est-ce que chômer? Pourquoi introduire une assurance chômage? En quoi la participation des caisses syndicales à la gestion de l’assurance influence-t-elle la politique fédérale? Quels sont les intérêts du patronat à soutenir le principe d’une assurance chômage? Quels sont les impensés de l’assurance chômage, notamment ce qui concerne le travail féminin? Voici quelques-unes des questions auquel ce livre répond. Premier ouvrage complet sur l’histoire de l’assurance chômage en Suisse, il permet de comprendre son organisation actuelle, à travers l’analyse du rôle qu’ont joué les organisations syndicales et patronales dans son développement.
Description
L’histoire de l’assurance chômage débute peu après la fin de la Première Guerre mondiale. La structure choisie en 1924, encore pérenne près d’un siècle plus tard, se caractérise par une gestion décentralisée et partiellement privatisée de l’assurance. À l’époque, les caisses syndicales, largement majoritaires, sont acculées financièrement et acceptent un subventionnement de l’État qui leur est particulièrement défavorable. Entre 1924 et 1977, l’assurance reste facultative et seul·e·s les salarié·e·s cotisent. La loi actuelle sur l’assurance chômage et insolvabilité est quant à elle introduite en 1982.
Le livre analyse le rôle qu’ont joué les organisations syndicales et patronales dans le développement de l’assurance chômage. Il montre les conséquences de la participation syndicale à la gestion de l’assurance et les enjeux politiques et sociaux liés à chacune des réformes de l’assurance.
Les chapitres qui composent ce livre permettent de se faire une idée précise des conflits qui ont émaillé l’histoire de cette assurance comme des consensus qui ont soutenu son développement, notamment celui sur la centralité de l’emploi et celui sur qui est responsable de l’indemnisation de la perte d’emploi.
Premier ouvrage complet sur l’histoire de l’assurance chômage en Suisse, ce livre basé sur une riche documentation comble une lacune et est appelé à devenir rapidement un livre de référence.
Table des matières
Introduction
I. La production d’un risque nouveau: le chômage (la loi fédérale de 1924)
- Différencier chômage et pauvreté
- Un processus international
- L’organisation choisie en 1924
- Le consensus autour de la nouvelle catégorie
- Conclusion
II. Une catégorie qui s’impose (1928-1938)
- Ce que donne à voir la statistique du chômage
- Une appréhension contrastée du risque chômage dans les cantons
- La constance de la politique fédérale
- L’imposition par l’État de la logique d’assurance
- Conclusions
III. La normalisation de l’assurance (1939-1945)
- La stabilité statistique
- Le partenariat social à l’agenda politique
- La normativité de l’assurance
- Conclusion
IV. L’institutionnalisation de l’assurance chômage (1946-1973)
- Une nouvelle institution, l’assurance chômage (1951)
- Une assurance sans chômage
- La diminution du nombre de personnes assurées
- Conclusion
V. L’avènement de l’assurance sociale (1974-1982)
- Un seul agenda, mais des objectifs différents
- La question de la citoyenneté sociale
- Les caractéristiques d’une assurance sociale
- Les principes de la loi
- Conclusion
Conclusions
Presse
Dans la Revue belge de philologie et d’histoire
La Suisse et la Belgique, deux petits pays multilingues situés à cheval sur les mondes latin et germanique, pourraient faire l’objet d’intéressantes comparaisons historiques. En quoi leurs cheminements économiques, sociaux et institutionnels sont-ils semblables ou divergents? Parmi les nombreux champs de comparaison possibles figure sans aucun doute l’assurance chômage. Tant la Suisse que la Belgique ont joué un rôle pionnier dans la mise au point des premières institutions de soutien aux chômeurs; la première avec ses caisses municipales d’aide aux sans-travail, la seconde avec le fameux « système de Gand », un mécanisme de soutien financier public des caisses de chômage libres.
Jean-Pierre Tabin, professeur à l’Université de Lausanne, et Carola Togni, doctorante à l’Université de Berne, ont eu l’heureuse idée de consacrer un livre à l’évolution de cette importante branche de la protection sociale en Suisse. Leur ouvrage ne sera pas seulement utile aux lecteurs helvétiques, mais également aux chercheurs étrangers, qui disposent dorénavant d’une étude fouillée et bien écrite sur le sujet. Les auteurs ne se sont pas contentés de consulter les sources officielles publiées; ils ont en outre largement puisé dans les archives de plusieurs organisations patronales et syndicales. Saluons, au passage, la vigueur éditoriale des éditions Antipodes, qui ont construit un beau catalogue d’ouvrages relatifs à l’histoire sociale suisse. Le présent livre y fait belle figure.
Nos propres travaux sur l’histoire de l’assurance chômage en Belgique1 nous incitent à comparer quelques aspects de l’évolution dudit système dans les deux pays. Après l’échec des expériences de caisses municipales lancées par Berne, Saint-Gall et Bâle à la fin du XIXe siècle, le système instauré à Gand en 1900 sous l’impulsion de l’avocat libéral Louis Varlez, semblait promis à un bel avenir. Dans cette industrieuse ville flamande, les autorités municipales encourageaient financièrement l’effort de prévoyance librement consenti par les membres de caisses de chômage privées,
essentiellement d’origine syndicale. En 1920, avec la création du Fonds national de Crise, l’État belge avait étendu ce système à l’échelle nationale. Lorsque le Parlement suisse s’est penché sur la question du chômage, au début des années vingt, il s’est largement inspiré de l’exemple belge (sans le reprendre intégralement). Mais malgré cette base commune – une variante du système de Gand – les trajectoires belge et suisse ont divergé à plusieurs égards.
Premièrement: en Suisse, l’essentiel du cadre légal (lois de 1924 et 1982) a été élaboré sous l’égide du Parlement. En Belgique, par contre, les décisions cruciales (y compris l’instauration du régime général de la sécurité sociale réformant l’assurance chômage), ont été prises sous l’empire de pouvoirs spéciaux qui permettaient au gouvernement de décider sans consulter les Chambres législatives. On peut légitimement supposer que cette différence a joué un rôle dans le contraste évoqué dans le point suivant. Aux moments cruciaux (1920 et 1944), les partis ouvriers et syndicats belges ont su marquer des points décisifs grâce à leur action sur et dans le gouvernement.
Deuxièmement: le système en vigueur en Belgique dès le début des années 1920 a conduit à un quasi-monopole des syndicats dans le domaine de l’assurance chômage – tandis qu’en Suisse, d’autres types de caisses (publiques et paritaires) ont réussi à s’imposer en tant qu’acteurs importants de cette assurance. Ce développement a été imposé au mouvement ouvrier par les forces conservatrices et patronales bien représentées au Parlement et au gouvernement. Les caisses syndicales helvétiques ne contrôlaient donc qu’une partie de l’assurance chômage. Bref: un même mécanisme de protection sociale – le système de Gand – a abouti, dans les deux cas, à des résultats fort différents. En Belgique, il a mené à l’instauration d’une véritable hégémonie syndicale sur l’assurance chômage et donc à un renforcement notable du mouvement ouvrier dans la société belge en général; tandis qu’en Suisse, il a engendré une compétition beaucoup plus ouverte entre les différentes forces sociales. Notons – ironie de l’histoire – que cette dernière formule était précisément celle qu’avait souhaitée Louis Varlez, le « père » du système de Gand. En bon libéral, il souhaitait en effet que d’autres acteurs sociaux, plus particulièrement les employeurs, s’engageassent également dans la voie de l’assurance chômage. Son idée originelle a, pour ainsi dire, été « détournée » au bénéfice quasi exclusif des syndicats ouvriers – et ceci dans son propre pays!
Troisièmement: en Suisse, le passage du régime facultatif au régime obligatoire s’est fait très tardivement. Ce pas décisif n’a été franchi qu’en 1982. Les salariés belges, quant à eux, ont été soumis à l’obligation dès 1944, lors de l’instauration du système général de sécurité sociale que nous venons de mentionner. La plupart des assurés (obligatoires) ont toutefois opté pour le syndicat comme organisme de payement des indemnités. En Belgique, la forte présence syndicale s’est donc maintenue après l’instauration de l’assurance généralisée. Notons toutefois que la Suisse permettait aux cantons de décréter l’obligation; certains d’entre eux l’ont effectivement fait avant la réforme de 1982. Ce pays a donc développé un système de protection sociale différenciée au niveau régional – une situation qui, de nos jours, fait précisément l’objet d’une vive discussion en Belgique, pays en transition permanente vers un fédéralisme toujours plus prononcé…
L’importance de la main-d’oeuvre immigrée en Suisse est un autre facteur spécifique qui permet d’expliquer la dynamique spécifique de l’assurance chômage helvétique. En effet, les crises économiques pouvaient (et peuvent) être affrontées en renvoyant les travailleurs étrangers et en réservant l’emploi restant aux nationaux. Cette « soupape de sécurité » du marché du travail rendait donc moins « indispensable » la mise au point d’un système complet et robuste d’assurance chômage. Ceci explique évidemment le caractère quelque peu « accessoire » de l’assurance chômage en Suisse et sa généralisation tardive.
Nous terminerons ce bref compte rendu en mentionnant, tout d’abord, un autre acquis positif du livre; puis en exprimant un regret. Acquis positif: l’attention portée par les auteurs à la dimension de genre. Ils éclairent de façon systématique la façon dont les femmes ont été discriminées par les mesures successives en la matière. Le fait que la co-auteure, Carola Togni, prépare une thèse de doctorat sur ce sujet n’y est évidemment pas étranger. Voici enfin un (léger) regret: quelques explications supplémentaires sur le contexte économique, institutionnel et politique de la Suisse
auraient permis aux lecteurs étrangers de mieux saisir le cadre général dans lequel se sont déroulés les débats concernant le chômage. Ajoutons immédiatement que ce regret représente bien peu de choses au regard du plaisir intellectuel suscité par la lecture de ce beau travail.
Guy Vanthemsche, Revue belge de philologie et d’histoire, tome 91, fasc. 4, 2013; Histoire médiévale, moderne et
contemporaine Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis, pp. 1368-1369; http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2013_num_91_4_8492_t16_1368_0000_1 (document généré le 15.07.2016).
1. Entre autres Le chômage en Belgique, 1929-1940, Bruxelles, Labor, 1994 et, plus récemment, un article sur l’origine du système de Gand dans cette revue (RBPH, t. 89, 2011, n° 3, p. 889-917).
Dans le Mouvement social
À la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle, les pays industrialisés sont le lieu d’émergence d’une catégorie nouvelle, à la fois statistique, juridique et sociale: c’est « la naissance du chômeur » (Christian Topalov) ou « l’invention du chômage » (Robert Salais). La figure du travailleur involontairement privé d’emploi se détache de celles du pauvre, du vagabond ou du handicapé. L’origine du phénomène n’est plus située dans les caractéristiques morales ou physiques des individus, mais dans les mécanismes économiques. Dès lors, la question se pose des justifications et des formes d’une éventuelle intervention sociale, qu’il s’agisse d’aider au placement des chômeurs ou de leur assurer un revenu de substitution. Dans le second domaine, les choix à opérer sont multiples: faut-il privilégier l’assistance ou l’assurance; l’assistance relève-t-elle de la responsabilité de l’État ou de celle des collectivités territoriales; l’assurance doit-elle être volontaire ou obligatoire; qui doit en assurer le financement et la gestion? De nombreux travaux ont illustré la grande diversité, selon les pays, des réponses qui ont été données à ces questions. L’ouvrage de Jean-Pierre Tabin et Carola Togni est le premier à proposer une vision d’ensemble de l’histoire du système d’assurance chômage dans le cas de la Suisse. Il s’appuie sur une exploitation approfondie de fonds d’archives publics, patronaux et syndicaux. Il est directement utile puisqu’il comble une lacune, mais il présente surtout l’intérêt de décrypter une configuration nationale très particulière des stratégies d’acteurs et de leurs évolutions. Ainsi, il enrichit notre connaissance de la palette des solutions institutionnelles qui ont été mises en œuvre pour l’indemnisation des chômeurs.
La création de l’assurance chômage par une loi de 1924 est la conséquence d’une crise économique qui frappe le pays au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour y faire face, un mécanisme d’assistance avait été créé en 1919 par les pouvoirs publics, avec une faible contribution financière patronale. Par ailleurs, il existait, comme dans de nombreux autres pays, des caisses privées d’assurance (presque exclusivement syndicales). Elles étaient financées par les cotisations de leurs membres, complétées par des subventions publiques. Elles ne couvraient qu’une faible fraction des salariés. L’ouvrage met en évidence l’ampleur surprenante du consensus qui se construit, face aux lacunes de ces dispositifs, entre les pouvoirs publics, le patronat et les syndicats dans la définition d’un nouveau dispositif malgré des intérêts divergents. Les syndicats veulent préserver et si possible développer leurs caisses qui sont, par suite de la crise économique, en grande difficulté financière. Ils soutiennent donc le principe de caisses autonomes subventionnées avec liberté d’adhésion. Le patronat ne veut pas payer. Il se méfie des caisses syndicales, mais, quoique divisé sur ce point, il renonce finalement au projet d’imposer des caisses paritaires, ce qui aurait supposé des cotisations des employeurs. Pour des raisons symétriques, les syndicats n’insistent pas sur une participation financière des employeurs qui impliquerait la présence de ces derniers dans la gestion des caisses. Enfin, les syndicats, pour préserver leurs caisses, ainsi que le patronat, pour des raisons doctrinales, sont hostiles à la création d’une institution publique d’assurance. S’il existe des conflits secondaires, l’architecture globale est acceptée par tous : liberté d’adhésion à des caisses autonomes qui sont subventionnées par l’État moyennant un contrôle de l’usage de leurs ressources. La création éventuelle d’une obligation d’adhésion relève de la décision des cantons ; elle s’étendra progressivement tout en ne concernant qu’une fraction des salariés (en général, les bas salaires). La crise économique des années trente provoque un durcissement du régime (conditions d’ouverture des droits, niveau des prestations, contrôle de la recherche d’emploi…) sans modification de son architecture.
Il est intéressant de noter que lorsqu’une réforme de l’assurance chômage est discutée entre 1940 et 1942 le patronat change de position et revendique la généralisation de caisses paritaires. Il est donc prêt à participer au financement dans l’objectif d’éliminer les caisses syndicales et de réduire le rôle dominant du financement public. Il doit cependant y renoncer face à la double opposition des syndicats et des cantons qui entendent conserver la maîtrise de leurs propres caisses. La réforme de 1942 confirme les principes de 1924 avec seulement l’adjonction d’un fonds de solidarité entre les caisses.
Parallèlement, les auteur(e)s mettent l’accent sur le caractère sexué de l’assurance chômage tout au long de cette histoire. Le modèle de référence est celui de l’homme « gagne pain », ce qui se traduit par des niveaux d’indemnisation inférieurs pour les femmes, par des niveaux supérieurs pour les chômeurs chargés de famille, ainsi que par la non couverture de certaines professions et des emplois à faibles durées de travail où se concentrent les femmes salariées. L’autre forme de discrimination frappe les travailleurs étrangers de manière continue selon des modalités variables.
L’adoption d’une nouvelle loi en 1951 reflète le maintien du consensus sur les principes du système, même si des conflits sont apparus sur certains points : indemnisation du chômage en cas de grève, indemnisation du chômage pour intempéries dans le bâtiment… Finalement, la loi n’introduit que quelques améliorations mineures qui sont élargies par diverses mesures additionnelles adoptées jusqu’en 1973, notamment en faveur des travailleurs qualifiés. Le fait que, dans cette période, le taux de chômage global soit très faible contribue à expliquer l’absence de conflit autour d’une politique qui se borne à des ajustements à la marge. Pour la même raison, malgré la baisse des cotisations et l’amélioration des prestations, le nombre des assurés (dans un système d’assurance volontaire) baisse, lentement mais continûment, à partir de 1968: « le risque paraît plus théorique que réel ». En 1973, les assurés représentent moins de 16% de la population active; quelques centaines de chômeurs seulement sont indemnisés. Pour ses adversaires, l’assurance chômage est décrite « comme un anachronisme »; selon les auteur(e)s de l’ouvrage, elle est devenue « l’assurance sans chômage ».
Il faudra la crise économique mondiale, qui touche la Suisse à partir de 1975, pour que le compromis historique entre syndicats, patronat, Confédération et cantons soit profondément mis en cause. En 1976, une révision constitutionnelle introduit l’assurance obligatoire. Elle est financée à parts égales par les salariés et les employeurs. Les cotisations sont perçues par un organisme confédéral. Si les caisses syndicales subsistent, aux côtés des caisses publiques et des caisses paritaires, elles se bornent désormais à verser des prestations selon des normes communes fixées par la Confédération. Plusieurs révisions ultérieures, jusqu’en 2012, modifient les différents paramètres du régime sans toucher à sa nouvelle structure.
L’un des intérêts majeurs de l’ouvrage réside dans la mise en évidence du contraste entre les stratégies des organisations patronales et syndicales. Les premières se révèlent constamment divisées entre les intérêts et les objectifs contradictoires de leurs membres: l’assurance chômage constitue-t-elle un risque de désincitation au travail ou peut-elle constituer un instrument de stabilisation d’une fraction de la main-d’œuvre; faut-il combattre les caisses syndicales au nom d’une gestion paritaire ou refuser les cotisations patronales; doit-on défendre le principe du volontariat ou tirer parti de la mutualisation des coûts assurée par l’obligation? En revanche, si des débats existent aussi au sein du mouvement syndical, ils semblent s’effacer devant l’impératif de défense de l’autonomie des caisses syndicales. Elles sont perçues à la fois comme facteur d’adhésion des salariés et comme moyen de légitimation face au patronat et aux pouvoirs publics. Cette priorité exige que les syndicats démontrent leurs compétences de gestionnaires et leur sens des responsabilités. Elle les conduit, pour protéger l’équilibre financier, à adopter une attitude prudente quant à l’extension des droits des chômeurs ou quant à un élargissement de l’adhésion qui bénéficierait à de « mauvais risques ». De même, l’objectif d’autonomie conduit à ne pas revendiquer de cotisations patronales et à ne chercher que dans les subventions publiques les nécessaires financements complémentaires. Ainsi se dessinent les bases d’un compromis implicite et durable, régulièrement validé par un pouvoir politique conservateur peu porté à élargir les responsabilités publiques. Seule la gravité de la crise économique de la décennie 1970 contraint à un changement de logique. Elle se traduit, en 1976, par la mise en place d’une assurance obligatoire dont les financements, les prestations, ainsi que les conditions d’ouverture et de maintien des droits sont fixées au niveau confédéral avec une simple délégation de gestion pour des caisses qui ne restent que formellement autonomes. À nouveau, mais cette fois sous la pression de contraintes exogènes, un consensus émerge; il fait disparaître une spécificité longtemps préservée.
Jacques Freyssinet, Le Mouvement social, n° 251, 2015/2
Dans la Revue suisse de sociologie
L’entrée en vigueur d’une assurance chômage obligatoire est l’aboutissement d’un processus long et complexe. Les auteurs proposent d’en établir une « socio-histoire » basée « sur le dépouillement systématique de sources et sur l’interprétation sociologique de ce qu’elles révèlent » (p.14). Leur thèse peut être résumée ainsi: la création d’une assurance chômage institutionnalise l’émergence d’une nouvelle catégorie sociale, le chômage, située à mi-chemin entre la pauvreté et l’emploi. Ils estiment qu’un double consensus caractérise la période étudiée (1924–1982): d’une part, l’emploi est perçu comme « le seul moyen de distribuer la richesse en société » (p.12) et, d’autre part, les coûts liés à l’indemnisation des chômeurs doivent être pris en charge « au sein d’un collectif » (p.13). Le propos des auteurs est structuré autour de cinq chapitres dont chacun se rapporte à une période historique bien délimitée. Le premier chapitre focalise son attention sur les années qui suivent la Première Guerre mondiale, le deuxième sur la Grande Dépression des années 1930, le troisième sur les années de la Seconde Guerre mondiale, le quatrième sur la période de forte croissance économique des Trente Glorieuses et le cinquième sur la crise économique associée au choc pétrolier de 1973–74.
La Loi fédérale sur l’assurance chômage de 1924, premier jalon de ce long parcours, introduit la participation de l’Etat fédéral au financement des caisses. Il s’agit par là d’assurer la survie des caisses syndicales dont la situation financière se dégrade avec la hausse du chômage qui sévit durant la Première Guerre mondiale. Ces subventions sont allouées en contrepartie d’une limitation du droit de grève et d’une gestion comptable clairement séparée des autres activités syndicales. L’Etat fédéral dispose ainsi des leviers nécessaires à une première forme de contrôle des syndicats dans la gestion du chômage. Les subventions favorisent les caisses publiques et paritaires sur le long terme, au détriment de celles syndicales qui voient la proportion d’assurés (comparativement à l’ensemble des caisses) diminuer de 94% à 30% entre 1924 et 1975.
La révision constitutionnelle de 1947 permet de consolider les dispositions en vigueur tout en abrogeant un arrêté que le Conseil fédéral avait édicté en 1942, lorsqu’il disposait des pleins pouvoirs. D’après Tabin et Togni, le processus de « normalisation » de l’assurance se traduit à ce moment-là par l’adoption de quatre principes: le caractère facultatif de l’assurance, le financement par l’impôt et les cotisations salariales, la concurrence entre caisses et l’imposition de règles uniformes pour l’octroi des indemnités. Cette nouvelle base légale répond à la volonté de consolider la paix du travail et d’assurer une main-d’œuvre qualifiée sur le marché du travail. C’est pourquoi « l’accent (…) n’est plus mis sur l’indemnisation, mais sur la possibilité de changer les qualifications ou de renforcer la mobilité du travail » (p.112). Le statut du chômeur connaît néanmoins une amélioration, en particulier pour les ouvriers masculins qualifiés.
Le pays connaît une crise économique d’envergure au milieu des années 1970, mais le taux de chômage officiel n’augmente pas pour autant de manière significative. Parmi les explications proposées figurent le retrait des femmes du marché de l’emploi, le retour des étrangers dans leurs pays d’origine et l’exclusion des personnes non assurées des statistiques. Un nombre croissant de salariés décide néanmoins de s’affilier auprès d’une caisse de chômage. Quant au gouvernement et aux partis politiques, ils considèrent tous qu’une révision de l’assurance chômage est nécessaire et urgente. En 1976, l’adoption d’un nouvel article constitutionnel introduit un régime de financement paritaire et consacre le caractère obligatoire de l’assurance pour les travailleurs tout en précisant que la loi peut prévoir plusieurs exceptions. Un arrêté fédéral d’une validité de cinq ans exclut toutefois le patronat du financement durant la période transitoire.
Le Parlement engage une procédure législative qui aboutit à l’adoption d’une nouvelle Loi fédérale sur l’assurance chômage (LACI) en 1982. D’après les auteurs, les débats sont marqués par quatre initiatives xénophobes qui rendent omniprésente la question de l’abus et « justifi[ent] sur la base de la rhétorique du juste milieu une politique restrictive en matière d’immigration » (p.159). Le droit légal à des prestations de chômage comporte par conséquent de nombreuses exceptions qui s’appliquent à la population non résidente, comme c’est par exemple le cas des travailleurs frontaliers ou saisonniers. La LACI entérine également quatre nouveautés majeures, en partie déjà en vigueur durant la période transitoire: l’introduction d’une cotisation patronale dans le financement de l’assurance, le plafonnement du salaire assuré, la limitation de la participation financière des autorités à des circonstances exceptionnelles, la séparation entre encaissement et distribution (le premier étant pris en charge par les caisses de l’Assurance vieillesse et survivants – AVS – et le deuxième par les caisses de chômage). Le caractère involontaire de l’absence d’emploi, l’obligation d’accepter un travail convenable et le montant de l’indemnisation inférieur au salaire assuré caractérisent, dans la loi, cette nouvelle catégorie sociale du chômeur. Les auteurs ne précisent toutefois pas que cette catégorie repose aussi sur les sanctions prévues à l’encontre des chômeurs qui ne respectent pas les directives des offices cantonaux de l’emploi.
L’ouvrage est particulièrement riche dans la description des débats et l’analyse des changements législatifs. Tabin et Togni parviennent à démontrer que la mise en place d’une assurance chômage découle d’un compromis entre acteurs sociaux, dont les termes sont façonnés au cours d’une période historique longue, caractérisée à la fois par des bouleversements et des continuités. Les auteurs apportent ainsi des éléments précieux pour une meilleure compréhension du fondement des politiques sociales. La lecture de leur ouvrage se révèle également intéressante pour saisir l’un des mécanismes – la gestion du chômage – œuvrant à l’intégration du mouvement ouvrier dans le corporatisme suisse. L’analyse proposée ne met toutefois pas en relation l’essor de l’assurance chômage avec le fait qu’à la différence d’autres pays européens, aucun système de sécurité sociale cohérent ne voit le jour en Suisse après la Seconde Guerre mondiale, ce qui aurait impliqué une autre conception des droits sociaux. De plus, l’institution d’une assurance chômage obligatoire est très tardive. Ce manque de perspective globale amène les auteurs à définir le caractère « social » de l’assurance chômage sur la base de critères restrictifs.
Une discussion plus approfondie aurait été enfin souhaitable lorsque Tabin et Togni estiment que le caractère obligatoire de l’assurance « fait porter sur les victimes le prix du chômage et en dédouane totalement le patronat sinon par la fiction de la cotisation ‘patronale’ qui n’est rien d’autre qu’un salaire socialisé »(p.179). En effet, si la création d’une assurance chômage obligatoire participe effectivement au processus de socialisation du salaire (les cotisations permettent le financement des prestations sociales), il n’en demeure pas moins qu’elle renchérit le coût du travail pour toutes les entreprises, indépendamment du fait qu’elles licencient ou pas. On regrettera enfin que des chiffres erronés concernant la cotisation dite de solidarité (confusion entre 1% et 1‰) aient pu amener les auteurs à considérer le montant en question comme étant « dérisoire » (p.195).
Nicola Cianferoni, Revue suisse de sociologie, vol. 40/1, 2014, pp.593-595
Dans la Swiss Political Science Review
Le présent ouvrage arrive à point nommé. Jusqu’alors, tout chercheur intéressé par l’assurance chômage helvétique se voyait confronté à l’absence d’études historiques et réduit à mobiliser quelques références (Degen 1993; 2005) néanmoins limitées pour se faire une idée précise quant aux origines de cette politique publique. Si « l’histoire sociale du phénomène (chômage) reste presque entièrement à faire » (Duvanel 2002; 43), l’histoire de son traitement public l’était sans doute encore plus. C’est désormais chose faite avec l’ouvrage de Tabin et Togni.
Dans cet ouvrage, les auteurs adoptent une démarche socio-historique de l’assurance chômage, dont la périodisation choisie va de 1924 (adoption de la première loi fédérale) jusqu’à 1982 (adoption de la Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ou LACI). Le questionnement de recherche porte sur le rôle joué par les partenaires sociaux – syndicats, patronat – dans la mise en place de l’assurance, en focalisant l’analyse sur les intérêts des acteurs en présence. La recherche se base sur le dépouillement d’archives syndicales, patronales et étatiques. L’ouvrage se subdivise en cinq chapitres qui suivent une perspective chronologique allant de 1924 à 1982.
Le chapitre 1 porte sur la première législation fédérale de 1924, laquelle traduit un changement de conception d’un système d’assistance financière aux personnes sans emploi à un système d’assurance. Une différenciation plus nette entre « pauvreté » et « chômage » s’effectue: le manque de travail n’est plus considéré comme un phénomène exceptionnel et passager, mais comme une caractéristique du marché du travail et un risque extérieur à la volonté individuelle des travailleurs. Si l’emploi constitue la norme, le chômage garde un statut dévalorisé par rapport au travail, ce qui se traduit par des indemnités inférieures au salaire et temporellement limitées. Au niveau politique, cette loi de subventionnement des caisses existantes trouve le soutien de la droite car le maintien d’une affiliation volontaire à l’assurance favorise la prévoyance individuelle, principe idéologiquement compatible avec celui de responsabilité individuelle. Le passage à l’assurance s’avère conforme aux intérêts du patronat, ce dernier étant dispensé d’y contribuer financièrement. Du côté syndical, l’absence de cotisation patronale ne sera pas contestée, notamment parce que les syndicats souhaitent éviter tout risque de référendum patronal qui menacerait une réforme leur garantissant des subventions étatiques. Si la nouvelle loi se caractérise par un subventionnement inégal défavorable aux syndicats, ces derniers s’y soumettent par « nécessité économique » (p. 31). Enfin, les décisions de 1924 évacuent l’idée d’une seule institution publique nationale pour gérer l’assurance chômage, le patronat s’inquiétant des coûts d’une telle mesure et les syndicats cherchant à préserver l’existence de leurs caisses.
Si la loi de 1924 contribue à normaliser le chômage comme nouvelle catégorie, c’est surtout la période 1928-1938 qui en précise les contours (chapitre 2). Les auteurs y évoquent la naissance du recensement statistique fédéral du chômage à partir des années 1920, statistiques ayant pour effet de construire le chômage « dans une réalité à la fois physique (via des chiffres) et temporel (via des séries) » (p. 65) même si elles souffrent d’un double biais (minimisation du niveau réel de chômage et du sous-emploi féminin). Le chapitre montre aussi la variation des politiques cantonales en fonction des conséquences différenciées de la crise économique (traitement traditionnel de la pauvreté dans les cantons peu touchés, mise en place d’une assurance chômage obligatoire dans les cantons industriels). Si la politique fédérale reste stable lors des années 1930, l’Etat contribue néanmoins à imposer la logique d’assurance au travers de plusieurs ordonnances qui précisent « ce que doivent être et ce que doivent faire les caisses de chômage » (p. 79). La logique d’assurance s’est donc installée et la participation du mouvement syndical à sa gestion s’est intensifiée.
Cette normalisation de l’assurance continue lors de la Deuxième guerre mondiale, en particulier avec la révision législative de 1942 (chapitre 3). A l’époque, l’Office fédéral du travail soutient l’idée d’une assurance obligatoire pour les travailleurs et d’un fonds de compensation entre caisses. Si le patronat souhaite une réorganisation complète du système (mise en place de caisses paritaires uniquement avec cotisation patronale en échange de la suppression des caisses publiques et syndicales), les cantons s’y opposent tout comme les syndicats, lesquels souhaitent le maintien du système existant et un fonds de compensation. La solution retenue en 1942 est un compromis: maintien du système de subvention aux caisses mais suppression de l’inégal subventionnement, mise en place d’un fonds de compensation alimenté par les caisses et les pouvoirs publics mais sans participation patronale, abandon de l’obligation d’assurance mais délégation de cette compétence aux cantons. La période s’avère plutôt positive pour les syndicats où la ligne réformiste se renforce à mesure qu’ils sont associés à la gestion nationale du chômage, même si le rapport de forces reste structurellement favorable au patronat.
Le quatrième chapitre analyse l’institutionnalisation de l’assurance lors des « Trente Glorieuses » (1946-1973). L’adoption des articles constitutionnels dits « économiques » en juillet 1947 formalise la consultation des groupes d’intérêts lors des élaborations législatives tout comme elle grave dans le marbre le principe que l’assurance chômage incombe aux caisses publiques et privées. L’institutionnalisation passe également par l’adoption d’une nouvelle loi fédérale en 1951, caractérisée par plusieurs principes: caractère toujours facultatif de l’assurance, financement sans participation patronale, concurrence entre caisses, amélioration du statut du chômage et mesures de stabilisation du salariat. Même si elle s’institutionnalise entre 1950 et 1970, il s’agit surtout d’une « assurance sans chômage » au vu du quasi plein emploi dès 1951. La question n’est donc guère à l’agenda politique pendant plusieurs années et le nombre de personnes assurées va même fortement diminuer au niveau national (baisse de 13% entre 1951 et 1972), le risque de chômage étant devenu plus théorique que réel (seulement 20% des salariés suisses sont assurés à l’aube de la crise économique de 1973). L’OFIAMT propose certes un projet de révision de loi en 1970 (suppression des caisses de chômage et remplacement par une caisse centrale avec généralisation de l’obligation d’assurance) mais il est enterré en 1972 tant les oppositions sont fortes lors de la consultation.
La crise économique des années 1970 modifie la situation et provoque l’avènement de l’assurance chômage comme une assurance sociale entre 1974 et 1982 (chapitre 5). La crise agit comme un révélateur de l’insuffisance de la couverture offerte par le système existant. L’agenda réformiste ne fait alors plus débat, l’urgence étant même de mise puisqu’il ne faut que deux années (1974-1976) pour que soit adoptée la révision constitutionnelle rendant l’assurance chômage obligatoire pour les salariés. Deux aspects sont alors au coeur des débats entre partenaires sociaux: le principe d’obligation d’assurance et l’association des employeurs à son financement. Concernant le premier aspect, l’OFIAMT y est favorable depuis plusieurs années. Du côté syndical, l’obligation permet de protéger l’ensemble du salariat et de généraliser la solidarité. Du côté patronal, une majorité finit par se rallier au principe car il permet d’élargir la compensation des risques et de socialiser les coûts du chômage sur l’ensemble de la population salariée. Concernant la cotisation patronale, les syndicats en font une condition sine qua non de leur soutien à l’assurance obligatoire. Du côté patronal, on considère cette contribution comme un « mal nécessaire, politiquement inévitable » (p. 165) pour éviter des dispositifs étatiques de protection contre les licenciements plus contraignants. Le patronat fait alors cette concession. Concernant la nouvelle organisation du système, les caisses existantes continueront d’indemniser les personnes mais la récolte des cotisations sera désormais gérée par un organe fédéral. D’où l’idée avancée par les auteurs d’une « étatisation » des caisses (p. 171), celles-ci n’ayant plus qu’une fonction de redistribution des prestations.
En conclusion, les auteurs soulignent les accords implicites fondamentaux entre partenaires sociaux: la durée maximale d’indemnisation a toujours été pensée comme limitée, le financement de l’assurance passe par des cotisations sur les salaires avec la « fiction » d’une répartition égale des charges entre employeurs et employés, les personnes qui reçoivent des indemnités de chômage doivent accepter un emploi s’il s’en présente un et le chômage des jeunes sortant de formation ne doit être que partiellement couvert par l’assurance.
Après ce résumé de l’ouvrage, examinons celui-ci sous un angle plus critique. Signalons tout d’abord les principaux apports de la publication.
Sa première force est qu’elle vient combler le vide historiographique de cette importante assurance sociale. L’ouvrage s’avère ainsi précieux pour comprendre les caractéristiques du modèle d’assurance chômage ayant prévalu jusqu’à l’adoption de la LACI (1924-1982), par exemple l’absence de contribution patronale au financement ou la logique d’assurance décentralisée avec affiliation volontaire longtemps privilégiée à un modèle étatique centralisé et obligatoire. Soulignons ici la richesse et la rigueur de l’analyse empirique, laquelle permet de suivre l’évolution du dispositif et des débats entre une pluralité d’acteurs et ce sur une longue période temporelle (60 ans).
Deuxièmement, la perspective sociohistorique est utile tant elle fait apparaître la forte continuité historique entre les dispositifs inventés dès les années 1920 (et la logique normative de ceux-ci) et la période actuelle. Ici, nous pensons à plusieurs aspects toujours centraux dans l’assurance chômage helvétique tels que la nette distinction entre chômage involontaire et volontaire, la centralité des sanctions financières, la rhétorique des abus ou le renforcement constant des contrôles fédéraux à l’encontre des caisses. Sur ce dernier point, les observations des auteurs raisonnent de manière directe avec le contexte récent ayant vu l’introduction des contrats de prestations entre Confédération et caisses dès les années 2000 (Pasquier & Larpin 2008; Buffat 2011).
Un troisième intérêt de la réflexion renvoie à l’analyse des catégories de l’assurance chômage en termes de genre, une orientation encore sous-développée dans l’analyse des politiques publiques (Jacquot et Mazur 2010). A plusieurs reprises et de manière convaincante, l’ouvrage montre en quoi les catégories étatiques construites sont structurellement défavorables aux femmes car reposant sur une vision très sexuée du travail. Plus largement, la publication montre tout l’intérêt d’analyser ce que les catégories étatiques révèlent de l’orientation normative des politiques publiques adoptées.
Quatrièmement, l’ouvrage propose une réflexion bienvenue sur un aspect peu étudié de la mise en oeuvre de l’action publique par délégation au secteur privé ou associatif, à savoir ce que cette même délégation sous contrôle fait aux organisations syndicales concernées. En ce sens, l’ouvrage montre combien les caisses syndicales changent lorsqu’elles deviennent des « organes d’exécution » de la LACI à la fin des années 1970: plus les syndicats participent à la gestion étatique de l’assurance, plus leurs caisses de chômage se technocratisent, se procéduralisent et se professionnalisent, et plus le gestionnaire l’emporte sur le révolutionnaire. Il y aurait là un lien intéressant à effectuer avec d’autres études en cours visant à comprendre ce que la collaboration avec l’Etat – notamment sous la forme actuelle de la contractualisation – fait au secteur associatif, à son identité et à ses valeurs (voir notamment Battaglini et al. 2013).
Notre lecture s’avère par contre plus critique sur certains éléments. Tout d’abord, on regrettera le manque d’élaboration voire d’ambition théorique de l’ouvrage. Concernant la démarche sociohistorique, la définition mobilisée – « le dépouillement systématique de sources et (…) l’interprétation sociologique de ce qu’elles révèlent » (p. 15) – est insuffisamment développée pour faire justice à la force heuristique de cette approche. Dans la sociologie contemporaine de l’action publique, il existe pourtant de fructueux développements conceptuels sur les apports d’une perspective historicisante (Laborier et Trom 2003) que les auteurs auraient gagné à mobiliser davantage. De plus, si nous souscrivons à la pertinence d’une interrogation sur la place des partenaires sociaux dans le développement de la politique publique, on peut toutefois déplorer que l’analyse n’élabore pas plus avant ce que le cas d’espèce permet de dire in fine d’enjeux plus généraux tels que l’évolution de l’influence des arrangements néo-corporatistes dans la production des décisions politiques ou l’étude des processus décisionnels en matière d’Etat social: le « noyau décisionnel » dans la politique suisse d’assurance chômage est-il le même aux différentes périodes étudiées par les auteurs? Est-il similaire ou différent de celui observé pour d’autres assurances sociales Comment évoluent les rapports de force entre syndicats et patronat au fil du temps? Et que dire des conditions contextuelles favorables ou défavorables à l’influence du mouvement ouvrier dans la construction de l’assurance? Quid des ressources nécessaires pour cela? Sur ces points, il est dommage que les auteurs ne conceptualisent pas plus leur objet au-delà des ancrages théoriques mobilisés: Bourdieu (2012) est certes pertinent pour comprendre comment se délimite le champ du possible des acteurs mais il reste limité pour traiter plus en profondeur du questionnement de recherche. Au minimum, une mise en perspective critique du cas ou une discussion avec d’autres courants de la littérature portant sur l’étude des processus politiques et de l’action publique en Suisse aurait fait sens. En l’état, la conclusion du livre s’avère décevante tant elle peine à aller au-delà du constat, certes pertinent, qu’il existe des accords implicites entre partenaires sociaux.
Un point de désaccord concerne la critique d’une approche néo-institutionnaliste de « dépendance au sentier »: « l’histoire de l’assurance chômage en Suisse depuis 1924 ne se résume pas aux décisions prises au début du processus » (p. 200). Cette critique s’avère peu pertinente car l’approche de Pierson (2000) ne peut se réduire à l’idée simpliste que les décisions prises au début du processus conditionnent tout le reste. L’argument piersonien est plus complexe: ce sont les rendements croissants (increasing returns) et les dynamiques auto-renforçantes (positive feedbacks) – ignorés par Tabin et Togni – qui permettent d’expliquer la difficulté d’emprunter un sentier différent (les coûts du changement deviennent plus importants pour les acteurs au vu des coûts d’installation initiaux, des effets d’apprentissage et de coordination engendrés et des anticipations adaptatives des acteurs). A partir de cette perspective re-spécifiée, on peut même proposer une interprétation très « path dependentist » de l’évolution de l’assurance chômage entre 1924 et 1982, en particulier pour comprendre l’impossibilité constante – du moins aux yeux des partenaires sociaux – d’adopter ce qui aurait alors constitué un véritable changement de sentier, à savoir la voie d’une caisse fédérale unique (proposée à plusieurs reprises par l’administration fédérale). Or c’est bien parce que les coûts d’un tel changement ont toujours été perçus comme trop importants par et pour les acteurs retirant des « avantages » des structures existantes que cette solution a été constamment repoussée par les syndicats et par le patronat. Sur ce point aussi, l’analyse aurait gagné à un travail préalable d’élaboration conceptuelle et théorique plus consistant.
Un dernier point critique concerne l’acteur administratif au niveau fédéral. Le lecteur restera quelque peu sur sa faim concernant l’influence exercée par l’administration dans l’évolution historique dépeinte. On aimerait en savoir bien plus sur le rôle effectif que les auteurs attribuent à l’OFIAMT: est-ce un acteur influent dans le jeu, et si oui sur quel(s) plan(s) exactement? Quel rôle joue-t-il entre les partenaires sociaux: se contente-t-il d’animer les débats entre les groupes d’intérêt ou exerce-t-il une influence croisée sur les positions des uns et des autres? Et comment ce rôle évolue-t-il lors des 60 années étudiées? Va-t-il croissant, décroissant, les ressources mobilisées par l’administration évoluent-elles? S’il y là matière à de futures recherches approfondies dans les archives de l’époque, l’ouvrage laisse penser que l’office fédéral n’a pas fonctionnée en tant que simple « caisse enregistreuse » des négociations entre groupes d’intérêts, mais qu’il a probablement joué un rôle de médiateur de politique publique au sens de Sabatier (2007) au travers de sa capacité à produire du compromis entre les coalitions rivales. En l’état, on peut regretter que l’ouvrage ne contienne pas plus de pistes théoriques à ce propos.
Si ce dernier point ne fait que renforcer plus largement la nécessité d’une sociologie politique des acteurs administratifs suisses et de leur rôle dans la formulation des décisions, l’ouvrage indique également l’intérêt d’investiguer plus avant la problématique des pratiques – administratives, mais pas seulement – de mise en oeuvre de l’assurance chômage sur le terrain. A cet égard, d’intéressants parallèles émergent entre nos propres recherches sur la question et le présent ouvrage, par exemple lorsque les auteurs évoquent la probable « marge de manoeuvre d’interprétation » (p. 48) des employés des caisses pour juger du chômage fautif. Lorsqu’on s’intéresse de près au pouvoir discrétionnaire des taxateurs d’une caisse publique de chômage (Buffat 2011: 255-318), c’est en effet dans le domaine de l’application des sanctions que la marge de manoeuvre est la plus forte.
de l’application des sanctions que la marge de manoeuvre est la plus forte.
Dès lors, une suggestion pour de futures recherches consisterait à investiguer comment les employés des caisses ont effectivement mis en oeuvre l’assurance chômage entre 1924 et 1982, c’est-à-dire avec quelle(s) marge(s) de manoeuvre et quels résultats. Tant la variation des contextes cantonaux (en termes socio-économiques) et organisationnels (types de caisses publiques, syndicales ou paritaires) fournit un contexte propice à la comparaison des pratiques discrétionnaires. On pourrait alors investiguer comment le personnel des caisses assumait concrètement son « rôle répressif, mais également éducatif » (p. 187) ou encore dans quelle mesure les hiérarchisations normatives décrites dans l’ouvrage sont localement appropriées: les agents reproduisent-ils stricto sensu ce sens normativement hiérarchisé de la politique publique, le durcissent-ils ou au contraire l’adoucissent-ils? Quid de la variation de pratiques au sein d’une caisse, au sein d’un même canton, au sein de différents types de caisses? Il y aurait là un bel agenda de recherche à poursuivre, au croisement d’une approche en termes de mise en oeuvre (Hupe & Hill 2009), de street-level bureaucracy (Lipsky 2010) et, d’un point de vue méthodologique, d’un travail sur archives.
On le voit donc, malgré ses limites notamment théoriques, l’ouvrage de Tabin et Togni constitue une lecture particulièrement riche et passionnante. Elle s’avère incontournable pour tout chercheur intéressé par l’évolution des assurances sociales en Suisse, l’analyse de l’action publique ou la sociohistoire. Hors académie, l’ouvrage trouvera un public attentif auprès des acteurs même de l’assurance chômage et, osons-le dire, auprès de toute personne qui, ayant eu l’occasion heureuse ou malheureuse d’avoir à faire avec cette assurance, s’interroge quant à ses origines profondes.
Aurélien Buffat, Swiss Political Science Review, Vol. 19(4)/2013, pp. 581–587
Dans la revue en ligne Lectures / Liens Socio
Les travaux de Christian Topalov1 – à la suite de ceux de Robert Salais, Nicolas Baverez et Bénédicte Reynaud2 – ont mis en évidence la construction de la catégorie « chômage » et de la figure du chômeur dans les politiques sociales nationales, à travers l’exemple de la France, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Plusieurs recherches ont examiné cette construction dans divers pays européens3. Une lacune subsistait toutefois pour la Suisse, que vient combler cet ouvrage de Jean-Pierre Tabin et Carola Togni sur l’assurance chômage helvétique.
De la mise en place d’une assurance chômage en Suisse en 1924 au vote de la Loi sur l’Assurance Chômage et l’Insolvabilité en cas d’Insolvabilité (LACI) en 1982, les auteurs ont donc interrogé les principes sous-tendant la mise en place de l’assurance-chômage suisse, et les prises de positions des différents acteurs. Suivant les travaux de Topalov, et pour se démarquer d’une historiographie téléologique, ils ont privilégié une approche socio-historique. Au-delà du double consensus qui semble exister à la fois au sujet de la centralité de l’emploi et de la responsabilité des travailleurs dans l’indemnisation de la perte d’emploi, ils entendent ainsi analyser les débats au prisme des intérêts des partenaires sociaux. Dans le même temps, ils veulent montrer que les évolutions de la conception de l’assurance chômage en Suisse ne découlent pas d’une « path dependency » (un déterminisme lié aux solutions mises en place dès l’origine) ni de simples calculs coûts-bénéfices mais de l’évolution des rapports sociaux – notamment de sexe4 – et de la conception du rôle de l’Etat. Leur étude est basée sur des archives fédérales – notamment les procès-verbaux de séances du Conseil des Etats et du Conseil national, le fonds de l’Office fédéral de l’industrie, des arts, des métiers et du travail, les procès-verbaux de commissions d’experts – ainsi que sur plusieurs fonds d’organisations syndicales et patronales.
L’analyse, en cinq chapitres, reste très chronologique. Elle insiste à la fois sur les motivations et les implications sociologiques des choix opérés par les acteurs, et sur la catégorie chômage et la figure du chômeur que cette mise en place de l’assurance chômage suisse dessine.
Les auteurs expliquent d’abord comment la logique de l’assurance chômage s’est imposée face à celle, préexistante, de l’assistance aux pauvres, à mesure que se construisait la catégorie « chômage ». La circulation des modèles d’assurance chômage lors de la Conférence internationale du chômage en 1910 et lors des Conférences internationales du travail alimente la réflexion. Avant la loi de 1924, des caisses syndicales, paritaires et publiques existent déjà – les premières étant majoritaires – mais avec un financement public limité. En outre, le consensus se fait rapidement entre les différents acteurs pour rejeter un système centralisé sous l’égide de l’Etat. Les syndicats, notamment, entendent conserver leurs caisses. L’étude montre que le patronat, de son côté, préfère les caisses paritaires mais rechigne à verser une contribution.La stratégie suivie est alors de limiter le développement des caisses syndicales, en réduisant le montant des subventions pour celles-ci. En revanche, un consensus existe entre tous les acteurs sur la définition du chômage comme un état inférieur à l’emploi, transitoire (le montant et la durée des indemnités étant limités) et qui comporte un caractère sexué, puisque les trajectoires linéaires masculines sont favorisées.
Avec la crise de la fin des années 1920, l’assurance chômage se diffuse, notamment dans les cantons industriels. Les caisses s’institutionnalisent face à l’afflux d’assurés et l’Etat fédéral est contraint d’intervenir pour aider les caisses les plus touchées. La logique d’assurance est renforcée, tout en maintenant une rhétorique de la faute qui stigmatise les chômeurs ne respectant pas les règles de l’assurance. Les syndicats, en revanche, voient leur rôle de partenaire renforcé et cette association va de pair avec un réformisme accru.
La fin de la crise et le second conflit mondial rejettent d’abord l’assurance chômage au second plan par rapport à d’autres préoccupations plus urgentes comme celle de l’instauration d’une caisse de compensation pour les militaires mobilisés. Devant le risque de montée du chômage à la fin des hostilités, l’Etat fédéral décide de légiférer en 1942. Chacun des partenaires sociaux présente un projet: l’OFIAMT veut instaurer une obligation d’assurance et intégrer l’assurance chômage et les caisses de compensation pour militaires dans un système; le patronat veut un système paritaire; les syndicats ne veulent pas voir disparaître leurs caisses. Un compromis est trouvé qui maintient les caisses existantes, avec un fonds de compensation entre elles, et une égalité de subvention quel que soit le type de caisse. L’obligation de cotisation est écartée. Le patronat obtient encore d’être largement dispensé du financement des caisses. Les obligations de comportement, les limites d’âge pour obtenir une indemnisation, les discriminations envers les femmes, moins indemnisées, sont maintenues. Ces dernières sont d’autant plus visées que se pose la question du retour au travail des hommes mobilisés.
Le système hybride public-privé est inscrit dans la Constitution en 1947, entérinant le rôle des partenaires sociaux. La loi qui traduit les dispositions de 1942 écarte les différences de traitement envers les femmes, mais celles-ci restent désavantagées par le mode de calcul. Les syndicats adoptent une position désormais plus ambivalente : si leur rôle de défense des travailleurs les conduit à soutenir une hausse des indemnités, leur responsabilité dans la gestion des caisses les amène à refuser ou modérer celle-ci. Les auteurs montrent néanmoins que les conditions économiques des années 1950 et 1960 en font une « assurance sans chômage » (p.134), ce qui provoque le désengagement d’une partie des assurés, faute de risque.
La dégradation des conditions économiques à la fin des années 1960 précipite la réforme annoncée de l’assurance-chômage. Tabin et Togni soulignent que les objectifs des différents acteurs divergent: les syndicats entendent toujours améliorer la prise en charge des chômeurs tout en préservant leurs caisses; la droite s’inquiète surtout des coûts du dispositif. La question des financements est réglée dès 1976, alors que celle des prestations et des mesures préventives attend la loi de 1982. Le patronat accepte de contribuer au financement de l’assurance chômage pour écarter d’autres mesures comme le contrôle des licenciements. Cette contribution, ainsi que la généralisation de l’obligation d’assurance, font de l’assurance-chômage suisse une « assurance sociale » telle que définie par Pierre-Yves Greber5. Les caisses sont maintenues, mais ne font que distribuer les prestations: le rôle de l’Office fédéral est donc réévalué. Les syndicats insistent alors pour que leur soient confiées les mesures de formation et d’aide au placement des chômeurs prévues dans la loi de 1982. Le statut inférieur du chômage, transitoire et moins bien payé, la primauté du modèle de l’homme gagne-pain, le retrait des plus âgés du marché du travail ne font pas débat. En outre, est ajoutée une dimension nationale: une politique d’exportation du chômage et de renvoi de la main-d’œuvre étrangère est mise en place.
Ce sont ces consensus implicites de l’assurance chômage, repérés tout au long de l’étude, que les auteurs décident de mettre en évidence dans la conclusion, à travers l’examen des révisions ultérieures de la LACI: la durée d’indemnisation est limitée, elle est basée sur une cotisation sur le salaire partagée entre employé et employeur, le chômage doit être involontaire et s’effacer devant un emploi « convenable » dont la définition est cependant fluctuante.
L’étude présentée par Jean-Pierre Tabin et Carola Togni se présente donc comme une interrogation très intéressante sur deux points-clés: le jeu des acteurs autour de la définition des caractéristiques de l’assurance chômage; et la mise en évidence des discours et présupposés qui sous-tendent le choix des différentes mesures, au-delà du consensus apparent et d’une vision téléologique. Elle donne donc une analyse sociohistorique fouillée de l’assurance chômage et des concepts qui la sous-tendent. Si les différences de conceptions entre les fédérations syndicales sectorielles et l’Union Syndicale Suisse sont examinées (de même qu’entre les différentes associations patronales) on pourrait éventuellement se demander quelle était la position des syndicats chrétiens, peu mentionnés: la défense des travailleurs primait-elle sur l’engagement ultérieur de certains syndicalistes dans le parti catholique conservateur?
Aurélien Zaragori, Lectures, Les comptes rendus, 12 septembre 2013, http://lectures.revues.org/12128
Notes
1. Topalov Christian, Naissance du chômeur 1880-1910, Paris, Albin Michel, 1994.
2. Salais Robert, Baverez Nicolas, Reynaud Bénédicte, L’invention du chômage. Histoire et transformations d’une catégorie en France des années 1890 aux années 1980, Paris, PUF, 1986
3. Par exemple Zimmermann Bénédicte, La constitution du chômage en Allemagne. Entre professions et territoires, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2001
4. Ceux-ci sont au cœur de la thèse de Carola Togni, Le genre du chômage. Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse 1924-1982, Université de Berne, Faculté d’Histoire, à paraître en 2013
5. Greber Pierre-Yves, « Assurance sociale (Notion générale) » in Fragnière Jean-Pierre et Girod Roger (dir.), Dictionnaire suisse de politique sociale, Lausanne, Réalités sociales, 2002, p.37
L’assurance chômage, une protection asymétrique
L’assurance chômage en Suisse découle d’une lente évolution qui a commencé au début du XXe siècle pour aboutir à l’assurance sociale obligatoire que nous connaissons depuis 1982. Retour sur une histoire de consensus social
Comment l’assurance chômage telle que nous la connaissons a-t-elle été pensée et instaurée en Suisse? Le sociologue Jean-Pierre Tabin, de l’Université de Lausanne, et l’historienne Carola Togni, de l’Université de Berne, ont analysé cette évolution, avec, comme fil conducteur, le rôle joué par les syndicats et le patronat. L’établissement progressif de cette assurance sociale découle d’un dialogue continu où des intérêts contradictoires finissent par converger vers un consensus institutionnel.
Les quatre grandes étapes de l’assurance chômage – 1924, 1942, 1951 et 1982 – sont racontées avec minutie. On y retrouve toujours ces deux constantes fondamentales: les prestations doivent découler du caractère involontaire de l’absence d’emploi et le statut social de chômeur est reconnu comme inférieur à celui de salarié.
De la reconnaissance du statut social du chômage en 1924 – quand est créée la loi sur l’assurance chômage – jusqu’au milieu des années 1970, les syndicats et le patronat ont délibérément choisi de limiter l’accès à l’assurance chômage.
Ainsi, la loi de 1924, instaurée à la demande des syndicats dont les caisses d’assurance se trouvent dans une situation financière délicate, possède deux caractéristiques: le patronat ne participe pas à son financement et les travailleurs ne sont pas obligés d’y cotiser. Deux effets résultent de ce caractère facultatif: d’une part, un recrutement facilité dans les syndicats – les travailleurs étant contraints de se syndiquer pour bénéficier d’une caisse d’assurance chômage –; d’autre part, les caisses pouvaient refuser les mauvais risques en sélectionnant les affiliés.
Chacun y trouve son compte
Cette situation perdurera dans les grandes lignes durant un demi-siècle, le patronat ne voulant pas d’une assurance plus étendue et les syndicats désirant garder la main haute sur les bénéficiaires de leurs caisses.
A ce titre, les auteurs soulignent, tout au long de leur ouvrage, le rôle ambigu des syndicats et du patronat. Les conditions d’obtention des prestations et le montant de celles-ci ne seront que peu débattus. Et ce, même lors de l’instauration du système d’assurance chômage obligatoire de 1982.
Dès cette date – et lors de la dernière révision de 2010 –, quatre accords implicites sur le chômage se sont dégagés en Suisse: la durée maximale d’indemnisation est limitée, le financement passe par une cotisation sur les salaires, les prestataires doivent accepter un emploi « convenable » s’il s’en présente un et les jeunes sortant de formation ne doivent être que partiellement couverts. Pour Jean-Pierre Tabin et Carola Togni, ce consensus sur l’assurance chômage autorise en fin de compte « les employeurs à licencier sans en payer les conséquences ».
Simon Moreillon, Le Temps, 10 septembre 2013
« Les syndicats ont fait leur la vision étatique du chômage »
Jean-Pierre Tabin montre que, en devenant, dès les années 1920, des auxiliaires de l’Etat en matière d’indemnisation du chômage, les syndicats se sont liés les mains et n’ont pas discuté, par exemple, le principe d’une
limitation de la durée d’indemnisation ou le fait que cette dernière soit inférieure au salaire. Andreas Rieger lui répond que la création d’une assurance obligatoire a été un progrès social pour les chômeurs et qu’il y a, bel et bien, des idées pour réformer le système.
plaidoyer: Comment les syndicats en sont-ils venus à endosser ce rôle d’exécutant de l’assurance chômage face au patronat et à l’Etat?
Andreas Rieger: Tout au début du siècle, les caisses syndicales étaient autonomes, c’est-à-dire qu’elles fonctionnaient sans subventions de l’Etat, mais qu’elles étaient pauvres et rassemblaient essentiellement des travailleurs modestes, des soi-disant « mauvais risques ». Si une crise ou l’augmentation forte du chômage survenait, elles tombaient souvent en faillite. Elles coexistaient avec des caisses cantonales et paritaires, et les leaders syndicaux d’alors ont fait, à mon avis, le mauvais choix en revendiquant les subventions de l’Etat. Ils sont un peu tombés dans un piège. Leur calcul a été que cette solution permettrait d’augmenter les membres du syndicat grâce aux caisses de chômage. La bonne solution aurait été d’opter pour une assurance étatique obligatoire, système qui n’est entré en vigueur qu’en 1984. Désormais, nous ne sommes plus que des offices de paiement d’une assurance fédérale. La totalité des prestations de nos caisses est désormais financée par la Confédération. L’avantage, pour les syndicats, est de rester près de la réalité du marché du travail et de constater à temps les risques de dumping, tout en offrant à leurs membres un service proche d’une organisation de travailleurs.
Jean-Pierre Tabin: Je pense qu’il faut faire une distinction: les syndicats créés à la fin du XIXe siècle n’étaient pas unanimes. Il y avait un débat entre ceux qui voulaient être partenaires de l’Etat et ceux qui s’y refusaient, car leur but était de révolutionner le système capitaliste. Dès le début du XXe siècle, les syndicats joueront toutefois un rôle majeur dans la mise en place d’une protection contre le chômage. Ils n’ont pas d’expérience de la gestion de l’assurance (notamment des calculs actuariels) et pas assez d’assurés pour se protéger des mauvais risques. Quand, à la fin de la Première Guerre mondiale, ils peuvent profiter des subventions fédérales, quoique dans une mesure moindre que les autres caisses, il y a parmi leurs dirigeants l’envie d’être reconnus comme de bons gestionnaires et des partenaires de l’Etat, en d’autres termes comme des partenaires respectables.
plaidoyer: En Allemagne, les syndicats ont fait un autre choix en se retirant de la gestion des caisses de chômage au profit d’une caisse étatique, ce qui leur a peut-être garanti davantage d’indépendance pour discuter les choix de l’Etat en la matière?
Jean-Pierre Tabin: Le contexte allemand est tout à fait différent puisque les sociaux-démocrates ont été associés au gouvernement dès la République de Weimar, ce qui fait qu’ils ont une position tout à fait différente des syndicats suisses par rapport à l’assurance chômage blackjack mise en place en Allemagne en 1927. Cela a permis la constitution d’une politique sociale nationale. Ce n’est nullement le cas en Suisse, l’Etat aidant davantage les caisses paritaires et les caisses publiques que les caisses syndicales…
Andreas Rieger: Nos ancêtres étaient fiers de leurs caisses syndicales, mais leur taux de couverture ne dépassait pas 10% à 20% des actifs. Ce système laissait de côté toute une série de travailleurs.
Jean-Pierre Tabin: En outre, tous les syndicats suisses ne partageaient pas la même expérience du chômage. Le chômage saisonnier dans le bâtiment était ainsi mal perçu des branches connaissant une réalité différente.
plaidoyer: Jean-Pierre Tabin, dans votre livre, vous avez parlé de « mise sous tutelle », de « collaboration sous contrôle des autorités fédérales » s’agissant des contrôles étatiques que les syndicats suisses ont été forcés d’accepter sur leurs caisses en contrepartie des subventions reçues, dès les années 1930, et de l’obligation de ne pas financer avec cet argent leur activité syndicale. Ce vocabulaire vous paraît-il encore adapté à la situation actuelle?
Jean-Pierre Tabin: Aujourd’hui, les caisses syndicales font le travail de l’Etat, distribuent les indemnités de l’Etat, se chargent des contrôles incombant à l’Etat par délégation. Les caisses, quelles qu’elles soient, sont toutes équivalentes légalement, mais cette subsistance du passé nous dit quelque chose du fonctionnement de l’Etat par délégation en Suisse.
Andreas Rieger: Il n’y a plus de pseudo-autonomie de nos caisses en effet, comme à l’époque des caisses subventionnées. En réalité, ce sont essentiellement les syndicats Unia et Syna qui ont encore des caisses de chômage importantes. Les chômeurs qui s’y inscrivent sont souvent en situation précaire, dans des branches connaissant des salaires modestes (construction, services) et nourrissent une certaine méfiance vis-à-vis des institutions étatiques.
plaidoyer: Vous soutenez que ce rôle d’auxiliaire de l’Etat et la nécessité, pour les syndicats, d’être considérés comme des partenaires crédibles dans la gestion du chômage expliquent qu’ils aient fait leur la vision étatique du chômage. Ils n’ont ainsi pas discuté, dites-vous, le fait que la durée de l’indemnisation soit limitée, que son montant soit inférieur au salaire, qu’il existe un délai de carence ou une obligation d’accepter un emploi convenable.
Jean-Pierre Tabin: Ils n’ont pas seulement fait leur la vision étatique du chômage, ils ont contribué à la construire en promouvant le principe du timbrage, en ayant un discours donnant une valeur à l’emploi supérieure à celle du chômage (d’où le principe d’une indemnisation inférieure au salaire). Ce sont les associations de chômeurs, dès les années 1930, qui ont contesté cela en affichant une position révolutionnaire et différente de celle des syndicats…
Andreas Rieger: Je ne suis pas d’accord de dire que les syndicats n’ont pas voulu de réforme de l’assurance chômage. Dès le moment où l’on a disposé, en 1984, d’une assurance étatique, la question de la politique du chômage n’a plus été le fait des caisses. Depuis la grave crise de 1992-1993, nous avons été confrontés à des propositions de révision à la baisse des droits à l’assurance chômage. Nous les avons toutes combattues. Nous avons revendiqué, en même temps, des améliorations, par exemple pour les femmes qui reprennent le travail après une interruption. En 2009, les syndicalistes ont, avec d’autres voix de gauche, lancé l’idée d’une assurance générale de revenu (AGR) qui prendrait le relais dès que l’assuré subirait une perte de gain, quelle qu’en soit la raison, en versant une indemnité identique à celle de l’assurance chômage, mais sans limite de durée. Cela coûterait cependant un milliard de plus que la solution actuelle et, lorsque le comité de l’Union syndicale suisse en a débattu, toute une partie a jugé cette vision utopique. Mais on ne peut pas dire que les syndicats n’aient pas remis en discussion le modèle actuel de l’assurance chômage!
plaidoyer: Vous relevez que, »pour toucher les subventions de l’Etat, les caisses syndicales doivent mettre en pratique des mesures qui peuvent aller à l’encontre de politiques syndicales concernant le niveau des salaires dans un secteur » (acceptation de directives touchant les salaires a priori contraires à leurs intérêts). Pouvez-vous citer un exemple récent?
Jean-Pierre Tabin: La dernière révision de la LACI entrée en vigueur le 1er avril 2011 a confirmé la fixation à 3797 fr. de la limite des bas salaire; au-delà, l’indemnité de chômage ne sera que de 70% du gain assuré. Or, l’USS a fixé à 4000 fr. mensuels l’introduction d’un salaire minimum par le biais d’une initiative!
Andreas Rieger: Nous étions clairement contre une réduction des indemnités à 70% du gain assuré, car c’est nettement insuffisant dans le cas de bas salaires. L’art. 16 LACI permet désormais de considérer en outre comme convenable un travail proposant un salaire inférieur aux indemnités de chômage versées, pour peu qu’il respecte les conditions fixées par les CCT. La définition restreinte du travail convenable comporte désormais le risque d’une dégringolade du salaire finalement disponible, un risque que l’Allemagne a récemment connu.
plaidoyer: La loi sur l’assurance chômage n’a-t-elle pas contribué à discriminer l’emploi féminin? Pensons, par exemple, à l’exclusion du service domestique – dans lequel un tiers des femmes employées dans le secteur tertiaire en 1941 travaillait – du champ d’application de cette assurance, ou, aujourd’hui, de la non-reconnaissance du travail domestique non financé par l’emploi.
Jean-Pierre Tabin: Carola Togni montre bien, dans sa thèse, que la discrimination touche délibérément les femmes mariées qui ont longtemps été considérées comme devant être exclues de l’assurance chômage. Dans cette logique-là, on ne prend pas en compte le fait que, si le mari travaille, il faut bien que quelqu’un d’autre prenne soin des enfants et du ménage. Les syndicats ont très longtemps soutenu une vision sexuée de l’assurance. Pour toucher des indemnités, les femmes devaient, jusqu’au début des années 2000, prouver que le ménage avait besoin de leur travail pour subsister.
Andreas Rieger: Avant l’assurance obligatoire, certaines professions, comme les agriculteurs et les travailleurs domestiques étaient exclus de l’assurance. Ce système discriminait toutes sortes de travailleurs, et spécialement les femmes. Aujourd’hui l’assurance chômage garantit des indemnités pour les travailleurs domestiques, mais pas pour la ménagère qui reste ménagère. Dans les mouvements féministes et les syndicats, il y avait un débat sur un salaire ménager dans les années 1970-1980. Cette idée ne s’est cependant pas imposée.
plaidoyer: Certaines améliorations sont pourtant le résultat de luttes syndicales…
Andreas Rieger: Oui. On est passé d’une indemnité n’excédant pas 50% ou 60% du salaire antérieur pour les personnes ayant charge de famille dans la loi de 1924 à 80% actuellement. Les syndicats ne sont pas partisans de l’idée que les chômeurs doivent toucher moins qu’avant! Mais, depuis les années 1980, à la suite des difficultés économiques, nous avons beau faire des propositions d’amélioration des indemnités, nous ne sommes pas suivis. Le rapport de force et le contexte économique sont tels que nous sommes déjà heureux s’il n’y a pas péjoration des droits…
plaidoyer: Jean-Pierre Tabin, vous dites cependant, s’agissant des dernières révisions de la LACI, que « les faîtières syndicales suisses ont joué un rôle ambigu » dans ce processus, ayant étroitement pris part à la révision de 1995 à laquelle s’opposait l’Association genevoise de chômeurs et de chômeuses, ou ne soutenant ni le référendum de 1997 lancé par l’Association de chômeurs et de chômeuses de La Chaux-de-Fonds ni la révision. En revanche, elles ont animé en vain les campagnes référendaires de 2002 et 2010.
Jean-Pierre Tabin: Je pense que le projet des faîtières syndicales n’apparaît pas clairement dans ces révisions…
Andreas Rieger: C’est vrai, une majorité serrée a voté à l’USS, au début, contre le lancement du référendum de 1997, mais, par la suite nous avons tous mené la campagne contre la révision. Nous avons lancé les deux derniers référendums en nous battant contre les restrictions successives qu’on voulait nous imposer. Même si nous avons perdu, nous sommes parvenus à freiner les restrictions envisagées. Et nous avons lancé en 2009, je le rappelle, une discussion sur une vraie réforme, fondamentale, du système!
plaidoyer: Vous relevez aussi que la politique du chômage répond aussi aux intérêts du patronat.
Jean-Pierre Tabin: Il serait effectivement faux de ne la voir que dans l’intérêt de la classe ouvrière. Elle répond aussi aux intérêts du patronat en ayant un effet favorable sur la consommation, en permettant de stabiliser la main-d’oeuvre au même endroit et en permettant de socialiser les coûts des licenciements. Ceux qui gagnent moins que 500 fr. par mois doivent cotiser à l’assurance chômage sans pouvoir en déduire des droits, ils exercent aussi une certaine solidarité; le pour cent de solidarité perçu sur les hauts salaires dans la révision de 2010 apparaît dérisoire, un simple moyen utilisé dans la stratégie patronale pour éviter qu’on sollicite davantage leur contribution…
Andreas Rieger: Certains pays perçoivent une contribution supplémentaire de la part de l’employeur auteur du licenciement, ce qui est un bon moyen de le responsabiliser. En Suisse, une majorité la rejette. Nous sommes néanmoins satisfaits du petit progrès qui interviendra dès le 1er janvier prochain et que nous venons d’obtenir. Désormais, les cotisations de l’assurance chômage ne seront plus plafonnées, contrairement aux prestations. Nous restons cependant dans un système capitaliste, et cela m’amuse de voir comment la Confédération est habile à récupérer les prestations payées par les salariés en les faisant passer pour des mesures de politique anti crise émanant de son fait!
Propos recueillis par Sylvie Fischer, plaidoyer, 5/13
Les syndicats et la première loi sur l’assurance chômage
ÉCLAIRAGE – En 1924, au moment où est instaurée une première loi sur l’assurance chômage, la majorité du patronat ne veut pas entendre parler d’une contribution des employeurs. Et les principaux représentants du mouvement ouvrier ne contestent pas l’absence de cotisation de la part du patronat.
La première loi fédérale sur l’assurance chômage est votée le 17 octobre 1924. Cette assurance est introduite en vue de préserver la paix sociale suite à la crise économique et aux désordres sociaux liés à la Première Guerre mondiale. Il s’agit, comme l’écrit le Conseil fédéral, de supprimer « des causes de conflits entre patrons et ouvriers et [d’éviter ainsi] les troubles menaçant l’ordre public ». C’est que, comme le déclare le rapporteur de la commission du Conseil des États (le député radical soleurois Robert Schöpfer) « les personnes sans travail, et toutes celles qui sont touchées [par le chômage] […] sont exposées à toutes les excitations politiques ».
Si l’assurance est conçue comme instrument de paix sociale, c’est également une réponse à un risque précis inhérent à l’organisation capitaliste de l’emploi: le manque d’emploi lié aux changements économiques. Le mécanisme de l’assurance, avec des caisses de chômage et des offices de placement, permet non seulement de fournir un revenu aux personnes privées de salaire, mais encore de les obliger à accepter un autre emploi. L’assurance introduit également une différence fondamentale de traitement entre deux statuts, celui de pauvre et celui de chômeur. Au premier va l’aumône, au second un droit lié à cotisations.
La morale n’est pas loin, puisque le dispositif d’assurance sert également à trier les personnes sans emploi, n’indemnisant que celles qui ne sont pas considérées comme responsables de leur chômage. Le nouveau système va permettre, comme le dit en 1924 le conseiller national libéral genevois Horace Micheli, de réprimer les « abus » du « régime démoralisant » de l’assistance, car « le meilleur contrôle sera celui qui sera exercé dans les mutualités par ceux qui ont eux-mêmes versé des subventions ».
Pas de cotisation patronale
Du côté des employeurs, le président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), le conseiller national radical saint-gallois August Laurenz Schirmer, développe un argumentaire plus intéressé, puisqu’il dit en 1924 voir d’un bon œil la participation financière des salarié-e-s au financement de l’assurance, un principe également soutenu par d’autres représentants du patronat. Au début des années 1920, la majorité du patronat ne veut en effet pas entendre parler d’une contribution des employeurs jugée néfaste à l’économie. L’argument de la capacité concurrentielle est avancé, mais également celui de la responsabilité individuelle qu’aurait chaque salarié-e de cotiser pour éviter les conséquences d’un chômage.
On pourrait s’étonner du fait que les représentants du mouvement ouvrier les plus actifs dans le domaine de l’assurance chômage, les députés socialistes Konrad Ilg (Berne) et Herman Greulich (Zurich) ou le conseiller national communiste bâlois Friedrich Schneider, ne contestent pas l’absence de cotisation de la part du patronat. Mais s’ils n’insistent pas sur la responsabilité des employeurs, c’est qu’ils ont d’autres priorités: ils veulent garder l’autonomie syndicale et éviter de faire capoter l’ensemble d’une loi dont l’importance est cruciale pour la survie financière de leurs caisses de chômage. En effet, une participation patronale au financement lui permettrait d’intervenir directement dans le contrôle des caisses de chômage syndicales, donc dans les affaires internes des syndicats, ce qu’ils veulent absolument éviter. Ensuite, cette participation justifierait le développement de caisses de chômage patronales qui viendraient concurrencer les caisses syndicales existantes. Enfin, ils craignent que l’ensemble de la loi ne soit remis en question sachant que le patronat s’opposerait à une loi impliquant une contribution obligatoire des employeurs.
Le principe de l’assurance contre le chômage sans participation du patronat est donc admis. Si, auparavant, l’assistance chômage était financée par les pouvoirs publics et les employeurs, sans contribution des salarié-e-s, le passage à l’assurance est un moyen de faire participer le salariat au financement des secours et d’en dispenser le patronat: le renversement de responsabilité du patronat vers le salariat joue un rôle important dans l’adoption de la loi. C’est d’autant plus intéressant pour le patronat que la loi prévoit un article spécifique sur le chômage partiel. Grâce à ce dispositif, il peut imposer à son personnel une réduction du temps de travail et une diminution de salaire sans risquer de perdre sa main-d’œuvre. Le mode de financement de l’assurance permet que l’opération soit entièrement à charge de l’État et des salarié-e-s, ce qui délie le patronat de toute responsabilité.
Les caisses syndicales
Si la protection du nouveau risque chômage est admise, reste à trouver la forme précise que doit prendre l’assurance en regard du fait que 157 000 personnes, soit environ 8% de la population active, sont déjà assurées avant 1924 contre le chômage, pour la plupart dans une caisse syndicale.
Dès les premières discussions sur l’octroi de subventions fédérales aux caisses de chômage, le fait que les syndicats n’aient pas tous une caisse de chômage clairement séparée de leurs autres activités, en particulier de la caisse de grève, est considéré comme problématique. Les autorités fédérales posent dès lors plusieurs conditions auxquelles les caisses doivent se soumettre pour obtenir des subsides. Elles sont tenues de distinguer la gestion de l’assurance chômage de leurs autres activités et ne pas réduire leurs prestations par suite du subside fédéral. Il s’agit d’un début de mise sous tutelle des activités des caisses de chômage syndicales à laquelle elles se soumettent par nécessité économique.
L’Union syndicale suisse (USS) s’exprime dès 1920 clairement contre la création d’une institution d’assurance publique, déclarant que « la classe ouvrière s’exprime avec fermeté contre la création d’une nouvelle institution étatique, semblable à l’institution pour l’assurance accident, en vue de l’introduction d’une assurance chômage, car elle est convaincue qu’une telle institution devrait être dotée d’un énorme appareil bureaucratique, qui absorberait une grande partie des moyens. […] La classe ouvrière veut construire ses propres caisses de chômage et elle revendique pour cela l’aide publique. » Il faut savoir que les caisses de chômage occupent une place importante dans la stratégie des dirigeants ouvriers: c’est en effet un précieux instrument de recrutement.
Une fois écartée l’idée de la création d’une institution publique, le débat se focalise sur le subventionnement des caisses de chômage existantes. La complexité pour les députés bourgeois et les représentants patronaux est de trouver un système qui permette de limiter l’influence syndicale afin de ne pas subventionner des actions liées à des conflits sociaux. Le choix d’un système de subventionnement particulier va permettre d’atteindre ce but. Le système adopté en Suisse prévoit le remboursement aux caisses de chômage d’un pourcentage de l’argent versé au titre de l’indemnité de chômage. Ce remboursement ne se limite pas aux caisses syndicales, il est étendu aux caisses publiques et patronales (paritaires). Afin de diminuer l’influence syndicale, le patronat obtient que la loi prévoie un subventionnement différent des caisses syndicales: le pourcentage de subside est fixé à 30% de l’indemnité versée pour les caisses syndicales, tandis qu’il est fixé à 40% pour les caisses publiques et pour les caisses patronales.
Si au final le président du syndicat possédant la principale caisse de chômage de Suisse (la Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers), Konrad Ilg, constate que « la loi fédérale peut à divers égards nous mettre dans l’embarras, car la tendance est à encourager les caisses d’assurance chômage publiques et privées et à combattre les caisses syndicales », il ajoute que « renoncer aux subventions et nous retirer serait stupide. Pour cette raison, nous ne combattons pas les caisses bourgeoises ». L’argument de la survie des caisses syndicales, qui dépendent des subventions publiques, justifie donc une position politique pouvant a priori paraître comme contraire aux intérêts syndicaux.
Un renforcement du statut de salarié-e
La loi sur l’assurance chômage du 17 octobre 1924 est adoptée à l’unanimité des Chambres fédérales. Le chômage est considéré au plan helvétique comme un nouveau risque social contre lequel le salariat peut se prémunir et la prise d’un emploi s’accompagne d’une incitation – très libérale dans son esprit – à s’assurer. En cas de réalisation du risque, l’assurance ouvre des droits, le statut de salarié-e s’en trouve renforcé. Toutefois, en l’absence d’une obligation d’assurance, seule une minorité de salariés et encore moins de salariées sont assuré-e-s auprès d’une caisse. La protection en cas de chômage, qui concerne à cette époque surtout l’ouvrier masculin, participe ainsi à creuser les inégalités au sein du salariat.
Jean-Pierre Tabin, Carola Togni, Services publics, no 5, 28 mars 2013
L’histoire de l’assurance chômage montre syndicats et patronat là où on ne les attend pas
Les Editions Antipodes publient L’assurance chômage en Suisse. Une socio-histoire (1924-1982), fruit d’une collaboration entre un membre du PRN LIVES et une jeune chercheuse de l’Université de Berne. Co-auteur, le Prof. Jean-Pierre Tabin explique les enjeux mis à jour par cette recherche.
Professeur à la Haute-école de travail social et de la santé – EESP Lausanne et à l’Université de Lausanne et chercheur au sein de l’IP5 du Pôle de recherche national LIVES, « Surmonter la vulnérabilité: perspective du parcours de vie » (PRN LIVES), Jean-Pierre Tabin sort en ce mois de mars 2013 aux éditions Antipodes un ouvrage écrit en collaboration avec Carola Togni, doctorante à l’Université de Berne. Intitulé L’assurance chômage en Suisse. Une socio-histoire (1924-1982), ce livre est le résultat d’une recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.
Le Prof. Tabin explique: « Nous sommes partis de la question suivante: Est-ce que le mouvement syndical a joué le rôle qu’il prétend aujourd’hui avoir joué dans la mise en place de l’assurance chômage obligatoire, l’Union syndicale suisse écrivant par exemple en 2008 qu’une « grande partie du travail de l’USS au XXe siècle [a consisté] à transférer [les] institutions d’assurances liées à des syndicats particuliers dans un système étatique, valable pour tout le monde ».
Pour répondre à cette question, nous nous sommes interrogé·e·s sur le rôle des organisations (syndicales et patronales) dans la mise en place de l’assurance. Sur la base d’archives, nous montrons d’une part l’intérêt du patronat au développement d’une assurance chômage. Elle permet à la fois de promouvoir un modèle libéral d’engagement et de licenciement du personnel et de socialiser le coût des licenciements. Cet intérêt patronal au développement de la politique sociale est trop souvent oublié.
Paradoxes de l’action syndicale
D’autre part, nous étudions les logiques dans lesquelles les syndicats sont pris avec leurs caisses de chômage. Comme cette activité leur permet de recruter des membres, ils ne sont en effet guère enclins à s’en séparer. Mais ils ont besoin d’un soutien étatique, surtout en période de crise, sinon leurs caisses vont à la faillite. Cette logique amène les syndicats à s’opposer durant de nombreuses années à l’obligation d’assurance, qui mettrait fin à leur stratégie de recrutement et les obligerait à accepter dans leurs caisses tous les risques, même les mauvais. Ils sont également contraints d’accepter des contrôles étatiques sur leurs caisses en contrepartie des subventions reçues et de s’engager à ne pas financer avec cet argent leur activité syndicale, notamment en cas de grève.
Ils deviennent ainsi ce qu’ils sont aujourd’hui en matière d’indemnisation du chômage: des auxiliaires de l’État. Cette position permet aux syndicats d’être considérés comme des partenaires crédibles de la gestion publique. Ce faisant, ils font leur la vision étatique du chômage: ils ne discutent pas, par exemple, le fait que la durée du chômage soit limitée ou que l’indemnisation soit inférieure au salaire, ils ne contestent pas qu’elle ne soit financée que par l’emploi (reléguant ainsi dans le néant assurantiel le travail domestique), ni le fait que les personnes au chômage soient obligées d’accepter un emploi, contrairement à d’autres groupes, comme les associations de chômeuses et chômeurs.
Intérêts conjoncturels et sectoriels
Les débats et controverses concernant l’assurance chômage au cours de son histoire ne sont pas soutenus par des visions antagonistes de la politique sociale qui devrait être menée sur cet objet, mais par les intérêts du moment de chacun des acteurs (surtout syndicaux et patronaux) et leur capacité à les imposer. L’assurance de 1924 n’est de loin pas identique à l’assurance actuelle, mais la représentation du chômage comme temps social spécifique n’a pas fondamentalement changé. Et le consensus autour du fait que l’absence d’emploi ne doit pas découler d’une décision individuelle pour être indemnisé doit être rapporté au fait que la socialisation de l’absence d’emploi via l’assurance autorise les employeurs à licencier sans avoir à en payer les conséquences. »
Pôle de recherche national Lives, rubrique Portrait, 11 mars 2013