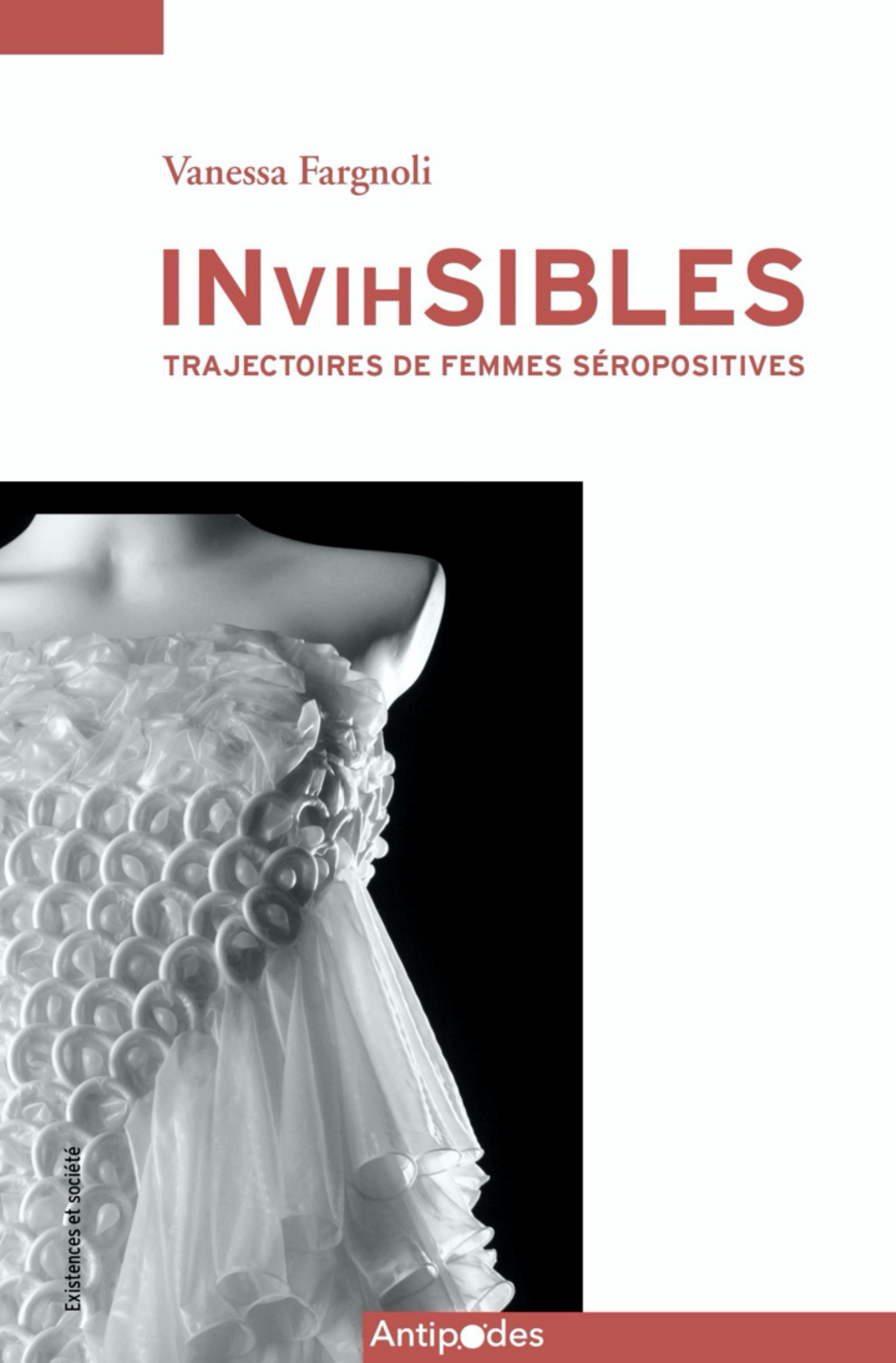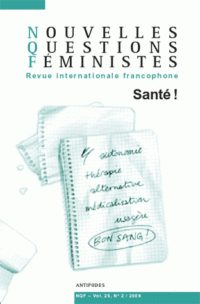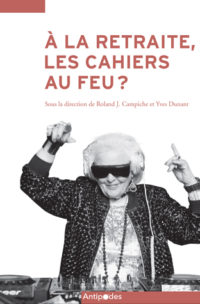InVIHsibles
Trajectoires de femmes séropositives
Fargnoli Vanessa,
ISBN: 978-2-88901-183-4, 400 pages, 29€, 2021
Que signifie «vivre avec le VIH» à long terme quand on est une femme qui n’appartient pas à un groupe cible et dont l’expérience n’a pas été problématisée dans l’histoire du sida ?
Description
Les femmes séropositives n’appartiennent pas à des groupes cibles tels que définis par l’Office fédéral de la santé publique suisse. Elles constituent donc un groupe de personnes invisibles, absentes des débats publics et médicaux, non considérées dans la littérature scientifique en général et non intégrées dans les recherches cliniques. Pour combler cette lacune, ce livre présente et analyse trente récits de vie récoltés entre 2013 et 2016 auprès de femmes hétérosexuelles séropositives en Suisse romande, qui ont été diagnostiquées positives au VIH avant l’an 2000. Ces entretiens ont permis de revisiter presque quarante ans d’histoire du VIH/sida sous un angle critique féministe.
Table des matières
REMERCIEMENTS
PRÉFACE DE CLAUDINE BURTON-JEANGROS
INTRODUCTION
1. CADRES DOMINANTS DANS LE CHAMP DU VIH/SIDA ET PROBLÉMATIQUE
2. MÉTHODOLOGIE ET CONDITIONS DE L’ÉTUDE
3. DEVENIR SÉROPOSITIVE
4. DEVENIR INDÉTECTABLE
5. DEVENIR INVISIBLE
6. DISCUSSION THÉORIQUE
7. CONCLUSION
ANNEXE : QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES
INTERVIEWÉES AU PREMIER ENTRETIEN
ABRÉVIATIONS
BIBLIOGRAPHIE
Presse
Séropositives sous chape de plomb
Société Grâce au développement des trithérapies, le VIH/sida est aujourd’hui une maladie «sous contrôle». Une enquête retrace le combat de 30 femmes séropositives entre 1986 et 2002, en soulignant leur solitude et leur invisibilité tant au sein de la société que du système médical, du fait qu’elles échappent aux grilles de lecture construites autour de la maladie.
«C’était deux médecins, un tout petit bureau et ça a duré un quart d’heure. Ils m’ont dit que j’étais gravement malade, que j’allais mourir dans les deux mois. Il ne fallait plus que je m’approche de quiconque parce qu’on ne savait pas comment ça se transmettait, qu’il fallait que je m’enferme à la maison et que j’attende. Un quart d’heure plus tard, j’étais toute seule sur le trottoir. C’est juste la fin du monde! J’attends juste de mourir et je ne sais même pas de quelle façon, je ne sais même pas comment, personne ne peut l’expliquer, je ne sais pas à qui aller demander des informations.» Zoé’ fait partie des 30 femmes séropositives au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) interrogées par Vanessa Fargnoli, chargée de cours à la Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève, dans le cadre de sa thèse de doctorat. Un travail aujourd’hui publié sous forme de livret, qui éclaire une frange de la population restée jusqu’ici dans l’invisibilité la plus totale.
Zoé, Adèle, Charlotte, Manon, Paola et les autres ont toutes été contaminées par le virus du sida entre 1986 et 2002. De nationalité suisse, blanches et hétérosexuelles, elles n’appartiennent à aucun «groupe à risque» tel que défini par l’Office fédéral de la santé publique et se pensaient donc hors d’atteinte de la menace du sida qui les a rattrapées, le plus souvent, via leur partenaire. Agées de 34 à 69 ans au moment de l’enquête, elles vivent aujourd’hui pour la plupart en couple. Un tiers sont célibataires, deux sont veuves (leur mari est mort des conséquences du sida) et 12 d’entre elles ont eu un enfant après le diagnostic. «L’évolution des traitements médicaux a permis à ces femmes de survivre au virus, explique Vanessa Fargnoli. Ensuite, elles ont dû apprendre à vivre avec lui, puis accepter l’idée de vieillir en sa compagnie. Et à chaque étape, elles ont dû faire face à la peur, au rejet, à l’isolement et au silence. Le leur, mais aussi celui des proches et de la société dans son ensemble.»
L’annonce du diagnostic constitue un choc d’une violence terrible. C’est le moment où tout bascule. L’épreuve est plus redoutable encore pour celles qui ont contracté le virus avant l’apparition des trithérapies, au milieu des années 1990. En l’absence de traitement, il équivaut en effet à une mort certaine. A cela s’ajoute encore la crainte de la déchéance physique, de la souffrance et du rejet social. Après une période de déni, la réalité de leur nouvelle condition biologique et sociale s’impose tant bien que mal. Il s’agit dès lors de donner du sens à cette réalité intolérable en élaborant un récit qui soit acceptable à la fois pour soi et pour les autres.
«Ce qui est très frappant, complète la sociologue, c’est que, dans un certain nombre de cas, l’arrivée du VIH dans l’existence de ces femmes n’apparaît pas forcément comme le pire événement de leur vie mais comme une tuile de plus dans un parcours déjà bien cabossé.» Beaucoup parmi les femmes interrogées dans le cadre de l’enquête ont en effet subi des carences affectives durant leur enfance et/ou des violences sexuelles. Habitées par un sentiment de culpabilité, elles se sentent responsables de n’avoir pu ou su échapper, qui à une relation toxique, qui à des fréquentations malsaines. A leurs yeux, le VIH n’est donc pas le fruit du hasard ou d’un accident mais le dernier acte d’une suite logique d’événements. «Il y avait quelque chose qui clochait avant», racontent certaines, tandis que d’autres vont jusqu’à affirmer qu’elles ont été «choisies» par la maladie.
«Certes, pour quelques-unes, l’infection par le virus est l’événement clé qui brise la « normalité » d’une vie paisible, mais la plupart définissent le VIH comme un événement symptomatique dans leur trajectoire de vie», poursuit la chercheuse. «En effet, l’analyse des récits révèle que le cumul de vulnérabilités antérieures (fragilité mentale, violences sexuelles, épreuves familiales) les a contraintes à se construire une identité avec le VIH a posteriori comme conséquence de ce cumul. Cet exercice de relecture du passé leur a permis d’ancrer le VIH dans leur parcours de vie et, au final, beaucoup estiment que le virus leur a, malgré tout, plus offert que pris.»
Cette prise de conscience, si terrible soit-elle, a pour mérite de provoquer une forme d’électrochoc. C’est le moment de reprendre sa vie en main, d’arrêter de tirer sur la corde, de faire le ménage dans sa vie et d’en «faire quelque chose de positif». De «sublimer» leur VIH, comme l’affirment certaines. «Certaines participantes affirment effectivement être parvenues à se dépasser grâce au VIH», ponctue Vanessa Fargnoli. «Elles ont recommencé à travailler, réussi à fonder une famille, entrepris de voyager…
C’est pour témoigner de cela que certaines ont accepté de me rencontrer. Parce qu’elles aimeraient être reconnues pour ce qu’elles sont parvenues à accomplir et pas uniquement en tant que femmes séropositives.»
Hors des groupes cibles
Avancer à visage découvert en portant un tel «fardeau» n’est cependant pas chose facile. Parmi les proches, la bienveillance et la compassion ne sont pas toujours au rendez-vous. Et celles qui ont fait le choix de la transparence doivent affronter certaines paroles et certains actes (l’éloignement des enfants, par exemple) qui trahissent une méfiance sourde mais constante, reflet de la désapprobation sociale que suscite le VIH.
Du côté du corps médical, leur discours n’est pas non plus toujours bien reçu. Dans les premières années de l’épidémie, le personnel soignant n’a en effet pas grand-chose à offrir à ces patientes. Il n’existe alors ni traitement ni structure spécialisée pour les accueillir. Pour la population concernée par l’enquête, ce vide thérapeutique est encore accentué par le fait que ces femmes échappent aux grilles de lecture construites autour de la maladie. La prise en charge et les études se concentrent en effet sur les populations dites «à risque» que constituent les hommes gays, les personnes originaires de pays à prévalence élevée (Afrique subsaharienne principalement), les toxicomanes par injection et les travailleuses du sexe. Représentant une forme d’anomalie dans ce tableau épidémiologique, les femmes séropositives qui n’entrent pas dans cette classification sont difficilement prises en compte par les professionnels de la santé. Pire, elles sont souvent suspectées de comportements irresponsables ou légers.
«La non-prise en compte des femmes séropositives par le système médical conduit à un manque de connaissances dans certains domaines», complète Vanessa Fargnoli. «Leur absence des essais thérapeutiques laisse un vide important sur les effets secondaires des traitements et les empêche également de se raccrocher à un cadre de référence, à un récit collectif de la maladie et donc de partager leur vécu.» Cette mise à l’écart se retrouve dans les milieux associatifs, largement dominés par une population – les hommes homosexuels – avec qui les participantes de l’étude ne se sentent pas beaucoup de points communs.
Pour briser la chape de plomb qui les entoure, environ un tiers des personnes interrogées font le choix de témoigner à visage découvert. Parfois dans les médias, le plus souvent dans le cadre de campagnes de prévention menées auprès du jeune public. Elles restent toutefois incapables d’agir collectivement et donc de peser au niveau institutionnel.
L’apparition des trithérapies à partir de 1996 en Suisse modifie cependant la donne. Progressivement, le VIH passe d’un fléau conduisant irrémédiablement à la mort à une maladie chronique, ensuite considérée comme «sous contrôle». Pour la majorité des femmes concernées par l’enquête de Vanessa Fargnoli, cette évolution se traduit aussi par un nouveau statut: celui de «malades indétectables», ce qui signifie que leur charge virale est suffisamment basse pour éviter tout symptôme et tout risque de transmission. En soi, c’est évidemment une excellente nouvelle, puisque cela signifie non seulement que leur espérance de vie se rapproche de celle de la population non infectée au VIH. Mais cela fait également naître certaines ambiguïtés.
En effet, si le virus devient indétectable, qu’il ne semble plus exister, il reste bel et bien présent dans l’organisme et continue à susciter la peur autour d’elles. Même si officiellement, à ce stade, les risques de transmission du VIH sont inexistants, la plupart des femmes sur lesquelles Vanessa Fargnoli a enquêté préfèrent d’ailleurs continuer à avoir des rapports protégés. Comme si elles ne parvenaient pas vraiment à croire à leur innocuité.
Ce nouveau statut signifie également qu’elles ne sont plus considérées comme des malades à part entière dont il faut prendre soin. On leur fait comprendre que, puisqu’elles peuvent vivre, elles doivent en profiter. Et que si elles n’y arrivent pas, c’est leur échec, pas celui de la médecine. Enfin, même si ces femmes sont déclarées en bonne santé par le système médical, la lourdeur des traitements et la crainte des effets secondaires sur le long terme péjorent fortement leur sentiment de bien-être. «Cette situation est minimisée par les soignants, analyse Vanessa Fargnoli. Puisque les tests de virémie sont bons, ces patientes sont censées aller bien, mais leur ressenti n’est pas du tout pris en compte.»
Une certaine expertise
Face à cette absence d’écoute et à la dévalorisation de leurs connaissances expérientielles, certaines adoptent des comportements qui échappent à la logique médicale en recourant à des thérapies alternatives ou en ménageant des interruptions dans leur traitement afin de permettre à leur organisme de souffler un peu. «En s’appropriant ou en se réappropriant certaines normes médicales, ces femmes rappellent qu’elles ont une certaine expertise, une certaine agentivité (c’est-à-dire une capacité à être des agents actifs de leur propre vie) et une certaine autonomie», note Vanessa Fargnoli. «Mais là encore, ce sont des décisions qu’elles doivent prendre totalement seules puisque leur opinion ne semble avoir aucun poids et qu’aucune structure n’existe pour les assister dans cette démarche.»
Des pistes qui pourraient permettre de modifier cet état de fait existent pourtant. Selon la sociologue, une meilleure prise en compte des personnes séropositives n’appartenant pas aux groupes cibles dans les programmes de prévention réduirait leur invisibilité tout en élargissant le cercle des individus se sentant concernés par cette maladie. Un travail sur la formation du personnel soignant semble également nécessaire pour éviter tant les discriminations et les comportements hostiles vis-à-vis des personnes séropositives – qui demeurent aujourd’hui encore fréquents aux dires des femmes interrogées dans le cadre de l’enquête – que la relégation de leur parole. Enfin, sur un plan plus institutionnel, les catégories épidémiologiques devraient être affinées en vue d’intégrer plus largement la diversité des profils de femmes contaminées par le VIH en Suisse.
* Paru sous le titre «Femmes séropositives: plongée dans le monde du silence» dans Campus n°145, juin 2021, magazine de l’université de Genève.
1 Tous les prénoms sont fictifs.
2 Vanessa Fargnoli, In VIHsibles – Trajectoires de femmes séropositives, Ed. Antipodes, 404 p., 2021.
Article de Vincent Monnet, paru dans Le Courrier du 05.09.21
Intervista con Vanessa Fargnoli : INviSIBLES trajectoires de femmes séropositives
E’ un pungo nello stomaco il libro di Vanessa Fargnoli, (nella foto a sinistra), una giovane sociologa dell’Università di Ginevra. Scritto nato dalla sua tesi di laurea, tratta le storie di trenta donne siero positive della Svizzera Romanda, con testimonianze dirette raccolte tra il 2013 e il 2016. Perché la Sanità svizzera, la letteratura scientifica e le ricerche cliniche hanno escluso queste donne dai dibattiti pubblici ? che tipo di assistenza medica hanno ricevuto? davvero le cure mediche sono state idonee ?
C’è lo spiega sapientemente la Fargnoli in questa intervista, e grazie a questo libro che con un occhio critico femminista, ci fa entrare in uno spaccato di realtà crudo e realista, dove le donne curate con gli stessi farmaci usati per gli uomini qualche problema l’hanno avuto, e le stesse donne etero e lavoratrici a volte hanno dovuto usare come farmaco il silenzio, perché i pregiudizi sono ancora la matrice delle gradi discriminazioni e ghettizzazioni del nostro tempo.
Un trattato in francese, per ora, dove si affrontano le problematiche, le metodologie, la diagnosi della sieropositività, la sua accettazione fino all’invisibilità, sociale e morale.
Cosi trenta donne, ci raccontano come sono diventate invisibili da tanti punti di vista.
Può spiegare il titolo del libro?
« Vivere con l’HIV: una condizione invisibile » è il titolo originale della mia tesi di laura e volevo mantenere questo termine invisibile in cui ho inserito l’HIV.
Ci sono due spiegazioni per il titolo del libro: Invihsibles:
1) Le donne che ho incontrato e intervistato sono particolarmente invisibili: nella ricerca clinica, nella letteratura medica e negli studi di scienze sociali. In effetti, sono stati fatti pochi studi su di loro. Nel libro, nell’introduzione, spiego che il posto delle donne nella storia ufficiale dell’HIV / AIDS non è stato solo una minoranza numerica, ma anche una minoranza dal punto di vista medico e sociale. E quando gli studi sono specificatamente dedicati alle donne sieropositive, si tratta di donne considerate “a rischio” di trasmettere il virus, cioè madri sieropositive, lavoratrici del sesso, donne provenienti da paesi ad alta prevalenza di HIV. Tuttavia, le donne che ho intervistato non rientrano in queste categorie epidemiologiche e non si identificano con esse.
2) Per vivere una vita il più « normale » possibile, la maggior parte di loro deve nascondere il proprio HIV, perché la paura del rifiuto e della discriminazione è ancora molto presente nei loro conti, anche trenta dopo una diagnosi di HIV +. Un capitolo tratta questo « diventare invisibile » e l’intero problema del « dire » o
« Taci » il suo stato di sieropositività e le conseguenze.
Infine, « traiettorie di donne sieropositive » perché attraverso tre capitoli empirici, ripercorro le loro traiettorie di vita con l’HIV: identità, medicina e sociale
La copertina del libro presenta un abito haute couture realizzato con i preservativi dall’artista brasiliana Adriana Bertini, impegnata nella lotta contro l’HIV / AIDS (il suo lavoro è straordinario e l’avevo incontrata a Durban, in Sud Africa durante la Conferenza Internazionale sull’AIDS)
Le donne sieropositive non sono state incluse nella ricerca clinica, perché?
In effetti, le donne sieropositive sono ancora troppo poco incluse negli studi terapeutici per due ragioni principali:
1) la letteratura spiega la loro esclusione con il pretesto che le donne non sono state in grado di evitare la gravidanza durante un processo (come se tutte le donne volessero essere incinte o non potessero evitare la gravidanza). Questo pretesto è ancora attuale secondo alcuni specialisti dell’HIV / AIDS che ho intervistato nel 2015.
2) La loro assenza era giustificata anche dal fatto che si pensava che il virus funzionasse allo stesso modo in entrambi i sessi. Questa convinzione – che possiamo curare una donna come un uomo – persiste e qualunque sia la condizione, non è solo per l’HIV.
Le conseguenze sono una mancanza di conoscenza e informazione sulle loro specificità. Fa anche parte di una delle loro richieste, che i trattamenti siano adattati alla loro morfologia e specificità.
È stato facile intervistare le trenta donne sieropositive?
Intervistarle sì, ma trovarli no. Infatti, essendo ben integrate socialmente, non fanno parte di associazioni (tranne due o tre), è stato necessario moltiplicare le modalità di reclutamento per trovarli. È stato principalmente attraverso medici e unità specializzate contro l’HIV / AIDS che ho potuto reclutare queste donne. Quindi ho dovuto passare attraverso un comitato etico e poi convincere i medici della rilevanza di questa ricerca qualitativa, che non è stata facile all’inizio. Mi hanno aiutato anche alcune associazioni specializzate. Fondamentalmente, si trattava di distribuire una newsletter sullo studio e se erano disposti a partecipare, potevano contattarmi direttamente.
Le interviste sono storie di vita, quindi lunghe interviste e le ho incontrate due volte all’anno, quindi ho passato molto tempo con loro, in totale dalle 3 alle 4 ore ad intervista. Con alcune, le discussioni sono continuate, per telefono, in un bar o tramite e-mail. Continuo a essere in contatto con alcune di loro che continuano a parlarmi delle loro vite e dei loro problemi con l’HIV.
Si tratta di interviste approfondite e quindi ricche. Dovevamo guadagnarci la loro fiducia, hanno accettato di condividere con me la loro storia della loro vita con l’HIV, per farmi entrare nella loro intimità, qualcosa che è stato costruito durante le discussioni e nel tempo. Questa è la ricchezza di uno studio qualitativo, usciamo sul campo per parlare con le persone, passiamo del tempo con loro per capire come si vive a lungo termine con una malattia incurabile (oggi).
A quale domanda non hanno risposto volontariamente?
Non ho fatto un’intervista in stile questionario a cui dovevano rispondere sì o no, o rispondere a domande specifiche.
Le mie domande sono domande generali, aperte e poi ho lasciato che mi raccontassero la loro storia.
Quanto tempo ci è voluto per scrivere il libro?
Questo libro è la mia tesi di laurea pubblicata nel 2019 all’Università di Ginevra e la stesura della mia tesi qualitativa ha richiesto un anno. Per il libro non ho cambiato lo sfondo o la struttura, ho solo fatto delle modifiche rispetto agli standard della casa editrice, cambi “cosmetici”, ma ci vuole anche molto tempo. Ho anche dovuto trovare i fondi per pubblicare il libro, quindi ho passato molti fine settimana e notti insonni a riformulare e riscrivere parti del libro, non ho contato quanto ho lavorato ma è stato davvero tanto lavoro.
Perché la sanità pubblica svizzera ha trascurato le donne sieropositive?
Non ha dimenticato tutte le donne sieropositive, alcune sono state prese di mira come ho accennato alla domanda uno. Queste sono le donne che escono dalle categorie epidemiologiche che sono state « dimenticate » perché, come mi ha detto un’esperta.:
“Non rappresentano un rischio epidemiologico, hanno cure, per loro va tutto bene, quindi che senso ha studiarli! « . Inoltre, statisticamente, non so quante ce ne siano in Svizzera.
La Sua è una forte critica femminista, cosa è cambiato ora nel 2021?
Per queste donne nulla è effettivamente cambiato, dal momento che ancora non rientrano nei quadri di riferimento, cfr. l’osservazione dell’esperto sopra. Quando sono andata dai medici per presentare loro le mie ricerche, me l’hanno detto
« Non esistono, guarda più dritto agli uomini eterosessuali, non sono stati studiati. » Il campo dell’HIV / AIDS rimane dominato da alcuni gruppi, prevenzione ecc. Non tutti si vedono in questi gruppi, motivo per cui (ai partecipanti) è piaciuto il mio studio.
Nel 2021, in Svizzera, in cura, possiamo vivere una vita « quasi normale » con l’HIV. Il successo medico ha permesso molte cose: partorire, invecchiare con l’HIV. Ma dal punto di vista sociale, siamo lontani dalla normalizzazione sociale, la discriminazione è ancora sostanziale e, come ho detto, la paura del rifiuto è significativa.
Faccio esempi di discriminazione nel libro come questa giovane adolescente che va per la prima volta da un ginecologo e che la informa dello stato di sieropositività della madre, pensando che sia una buona cosa da fare e che all’improvviso riceve la domanda: » Tua madre è una puttana? » « È successo nel 2016! persistono quindi associazioni sistematiche, tra gli operatori sanitari e le persone in generale. È difficile cambiare la mentalità e questo tipo di critica fa molti danni.
Nelle loro storie considerano ancora questa « malattia vergognosa », « sporca » e « moralizzante » da qui la difficoltà di parlarne … e quando si lasciano le rappresentazioni classiche, è anche difficile giustificare un’infezione da HIV.
Cosa vogliono le donne per il loro futuro in Svizzera?
Dovresti porre loro la domanda direttamente. Infine, diamo loro pochissima voce. Penso che già un riconoscimento – una visibilità – sia importante ed è l’obiettivo di questo lavoro, raccontare un’altra storia, una « storia », mostrare che anche loro esistono e che riguardano tutti e non le popolazioni chiave.
Come già detto, vorrebbero che i trattamenti fossero più adatti alle loro specificità e che anche i medici li considerassero esperti. Vorrebbero non essere più a rischio di essere stigmatizzati o discriminati a causa dell’HIV, che è generale per tutte le persone che vivono con l’HIV.
Temono anche la tossicità dei trattamenti a lungo termine, rimane un trattamento per tutta la vita, non può ancora essere curato e i medici tendono a banalizzare i trattamenti, ma nella vita di tutti i giorni non è così semplice. Alcuni sognerebbero di diventare di nuovo « HIV negativi » e altri si preoccupano della prevenzione e vorrebbero che si parlasse di più, si istruissero, a qualsiasi età. Alcuni dicono di sentirsi dimenticati anche dalla ricerca. Coloro che stanno invecchiando con l’HIV hanno altri problemi di salute che, insieme all’HIV, li preoccupano. Alcuni temono anche il pensionamento dei loro medici con i quali hanno una relazione di fiducia a lungo termine (se le persone con HIV invecchiano, lo fanno anche gli esperti)
Altrimenti, immagino che vogliano ciò che la maggior parte delle donne desidera: rimanere in salute, vivere una vita serena e piacevole, che i loro figli stiano bene, ecc.
Il messaggio principale rimane che vorrebbero in particolare che gli venisse mostrato quello che hanno fatto con il loro HIV. Anche se nei loro resoconti compaiono difetti, tutte le interviste mirano a dimostrare che sono riusciti a “avere successo” nella loro vita con e nonostante l’HIV, che sono riusciti a condurre una vita più o meno “normale” con l’HIV. Quindi vorrebbero che ci importasse di meno
Quale sarà la Sua prossima ricerca?
Buona domanda ! Al momento sto terminando le ricerche in corso e sto lavorando alla stesura di un capitolo per un lavoro collettivo sull’HIV. Non mancano le idee di progetto. Oggi si tratta più che altro di trovare tempo e finanziamenti. Alcuni vorrebbero trasformarlo in un film contemporaneo o in un fumetto, sarebbe fantastico, ma non ho alcuna esperienza in questo settore. Se ne avessi l’opportunità, continuerei a lavorare su questo affascinante argomento che merita ulteriore attenzione. L’HIV non è solo una storia medica, è prima di tutto una malattia relazionale, e quindi molto sociale.
Scritto da Chiara Marcon, ilgiornale.ch, Lunedì 10 Maggio 2021
Une thèse pour donner de la voix aux «InVIHsibles»
Depuis 40 ans, le sida est majoritairement associé, en Europe, à une population masculine et homosexuelle. Vanessa Fargnoli prend le contre-pied et donne la parole à trente femmes séropositives hétérosexuelles. Des témoignages forts et poignants.
« Que signifie « vivre avec le VIH » à long terme, quand on est une femme qui n’appartient pas à un groupe cible et dont l’expérience n’a pas été problématisée dans l’histoire du sida ? » C’est autour de cette question principale que Vanessa Fargnoli a orienté sa thèse de doctorat, effectuée en sciences de la société à l’Université de Genève. Le résultat de ses travaux figure dans l’ouvrage InVIHsibles : trajectoires de femmes séropositives, paru aux éditions Antipodes.
Pour trouver des réponses à sa question, l’autrice a interrogé, entre 2013 et 2016, trente femmes infectées par le VIH et n’appartenant pas à des groupes cibles tels que définis par l’OFSP [1]. Si les parcours de ces « femmes hétérosexuelles et blanches » s’avèrent complètement différents, un point commun les lie : « toutes se pensaient hors d’atteinte de la menace du VIH/sida », rapporte Vanessa Fargnoli.
« On m’a pris ma vie »
Ces témoignages révèlent la violence de l’annonce d’un diagnostic de VIH, qui implique un changement d’identité : ces femmes acquièrent soudain « une identité médicale de « séropositive ». Une fois passé le choc de l’annonce, elles font face à la colère et à la révolte, ainsi qu’à d’autres événements traumatisants : solitude, perte d’un emploi, couple et rêves brisés, angoisses à affronter, perspectives de la mort à apprivoiser. Toutes se sont également retrouvées face au choix de dire ou de taire la maladie. Certaines, comme Ingrid, contaminée par son conjoint qui se savait séropositif mais ne le lui a pas dit, choisissent de se battre devant les tribunaux pour être « reconnues » comme « personne abusée ».
Petit à petit, le processus de « redéfinition de soi » a permis à certaines de transformer le VIH en une « ressource ». Les propos de ces femmes, chargés de résilience et d’abnégation, viennent alors frapper au coeur. « Si c’est juste pour subir, ça ne vaut pas la peine, donc il faut essayer d’en faire quelque chose ! », témoigne en effet Coralie. Zoé voit l’infection au VIH comme un « cadeau » qui lui a permis de vivre différemment : « Je n’aurais jamais eu la vie que j’ai eue. (…) Surtout ça m’a fait me dépasser, ça m’a fait sublimer tout ça d’une belle manière ! Je ne sais pas si j’aurais réussi à faire aussi bien sans ! » Pour Charlotte, le virus lui a « plus offert que pris ».
Double intérêt, scientifique et social
En Suisse, un quart des 20’000 personnes vivant avec le VIH sont des femmes. Pourtant, celles-ci sont longtemps restées absentes des statistiques et des recherches. Cette invisibilité engendre « trois conséquences », selon la sociologue genevoise. « La première est que la plupart des femmes auraient intériorisé le message « ce n’est pas notre épidémie », leur donnant un faux sentiment de sécurité ». Ensuite, elles subissent de la discrimination au sujet de leur comportement, catégorisé comme « léger » et de « mauvaise vie » puisque, dans les catégories à risque figurent les prostituées. Enfin, les spécificités féminines n’ayant pas été prises en compte dans les essais cliniques, leur santé générale « en a pâti ».
Ainsi, en liant des intérêts scientifiques et sociaux, Vanessa Fargnoli permet de donner une voix à ces femmes restées jusqu’alors invisibles. En outre, l’angle critique féministe adopté par l’autrice contribue à une lecture différente de cette maladie mondiale. Enfin, dans la préface, la professeure Claudine Burton-Jeangros tire une parallèle avec la situation sanitaire actuelle : « Les constats présentés dans cet ouvrage plaident pour la nécessaire mobilisation des sciences sociales dans la gestion, collective et individuelle, des maladies infectieuses. Quels que soient les moyens médicaux et techniques disponibles, les virus et les maladies s’inscrivent au cœur des rapports sociaux. Les maladies ne doivent donc pas seulement être pensées sous l’angle des réponses médicales, mais bien comme des crises qui marquent des trajectoires individuelles, mais aussi exacerbent les rapports de force préexistants au sein de la société. »
[1] Vanessa Fargnoli rapporte, en page 14, que l’OFSP définit ainsi les groupes cibles : « Les hommes gays et les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) ; les personnes orginiaires de pays à prévalence de VIH élevée, notamment les régions subsahariennes ; les consommateurs et consommatrices de drogue par injection ; les travailleurs et travailleuses du sexe. »
Article de Céline Rochat sur le site de Reiso.org, jeudi 27 mai 2021
Vanessa Fargnoli invitée en direct à la radio dans l’émission Tribu (RTS, la Première), vendredi 21 mai de 11h à 11h30 : à écouter ici.
Des séropositives prennent la parole
Sous le titre «InVIHisibles: trajectoires de femmes séropositives», Vanessa Fargnoli publie sa thèse de sociologie aux Editions Antipodes et apporte un éclairage inédit sur la perception et le vécu du VIH. L’auteure s’est livrée à une enquête de terrain en obtenant de 2013 à 2016 trente récits de vie auprès de femmes séropositives, hétérosexuelles, suisses, vivant en Suisse romande ou en France voisine, âgées de 34 à 69 ans, et n’appartenant donc pas aux groupes cibles dits à risques habituellement étudiés jusqu’alors telles que les toxicomanes ou les travailleuses du sexe.
Dans son analyse basée sur ces entretiens, Vanessa Fargnoli met en lumière comment ces séropositives ont reçu le diagnostic de leur maladie, comment elles ont géré le VIH dans leur vie quotidienne, comment elles ont annoncé à leur entourage leur état, quels impacts leur séropositivité a eu sur leur sexualité, leur maternité, leurs relations professionnelles, ainsi que les effets liés aux traitements.
A l’annonce de leur séropositivité, certaines décident de partir voyager pour profiter des derniers instants de leur vie, ce qui a plongé certaines d’entre elles dans une spirale d’endettement. Outre la peur de mourir, d’autres angoisses les ont saisies à ce moment critique: allaient-elles rester seules, ne plus jamais pouvoir devenir mères, ou encore contaminer les autres? Des bouleversements majeurs les ont touchées: des couples ont éclaté, et des parcours professionnels se sont arrêtés, Un tiers de ces femmes ont été contraintes de cesser de travailler et se sont retrouvées dès lors à l’assurance-invalidité. Dans cet échantillon de 30 femmes, 26 ont été contaminées sexuellement par leur partenaire. Seules deux d’entre elles ont intenté un procès à leur partenaire, qu’elles ont d’ailleurs gagné.
Découverte plus surprenante, certaines femmes contaminées affirment avoir au fil des années su découvrir des aspects positifs à leur maladie. Le VIH a été pour certaines un facteur décisif pour changer de vie, travailler dans des associations, rencontrer de nouvelles personnes intéressantes, adopter une meilleure hygiène de vie, accroître leur empathie et leur ouverture aux autres, tandis que d’autres se sentent au contraire davantage isolées et rejetées. Le vécu par les femmes séropositives des traitements contre le VIH est aussi analysé par la sociologue qui constate que certaines ont même dû refuser toute invitation sociale. Outre un manque fréquent d’énergie, elles subissent des problèmes de mémoire, de concentration et souffrent de fortes migraines. Alors qu’elles rendent leur traitement responsable de ces maux, leurs médecins n’y voient pas forcément un lien de cause à effet, mettant en avant plutôt des facteurs psychologiques et les effets secondaires des trithérapies. Un tiers des interviewées sont touchées par la lipodystrophie: elles présentent un visage, des bras et des jambes amaigris, au point que certaines sont si complexées qu’elles ne se considèrent plus comme des femmes à part entière. L’étude montre enfin que ces femmes n’ont pas subi des discriminations seulement dans l’espace public, mais aussi dans leur sphère privée et intime, notamment quand leur partenaire les rabaissait en leur tenant des propos blessants: «Il m’a dit: « De toute façon avec ce que tu as, tu resteras toute ta vie avec moi! » Forcément, plus personne n’aurait envie ni de me faire l’amour ni de m’aimer avec cette maladie. Il se sentait dans sa toute-puissance !» Nous ne pouvons que recommander chaudement la lecture de cette étude particulièrement claire et structurée qui met en lumière ces femmes restées trop longtemps dans l’ombre et auxquelles elle donne enfin la parole.
Nicolas Quinche, historien, parution dans le journal La Côte, le 30 avril 2021